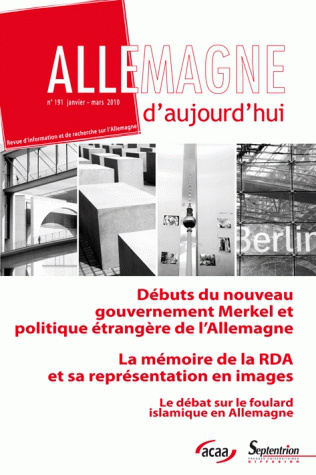Allemagne d'aujourd'hui, n°191/janvier - mars 2010
Début du nouveau gouvernement Merkel et politique étrangère de l'Allemagne
First Edition
La rencontre d'articles sollicités et de nouvelles contributions proposées à la revue permet de combiner les éléments d'un dossier sur les premiers pas du nouveau gouvernement Merkel et un autre qui éclaire différents aspects de la politique étrangère de l'Allemagne tout en permettant une appréciation plus particulière des évolutions du « couple franco-allemand » sur le long terme et dans l'actualité immédiate.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui
- Title Part
-
Numéro 191
- Author
- ,
- Journal
- Allemagne d'aujourd'hui | n° 191
- ISSN
- 00025712
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations > Germanic and Scandinavian countries
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations
- Title First Published
- 25 March 2010
- Type of Work
- Journal Issue
- Original Publication
- 2010
Paperback
- Publication Date
- 01 September 2003
- ISBN-13
- 9782913761186
- Extent
- Main content page count : 199
- Code
- 3717
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 389 grams
- List Price
- 20.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
Editorial
Grèce, Allemagne, France : quelle issue pour la zone euro ?
par H. Brodersen
Dossier
Débuts du nouveau gouvernement Merkel et politique étrangère de l'Allemagne
Présentation par J. Vaillant
H. Brodersen. – Scénarios de « sortie de crise » : le cas allemand
A. Marchetti - H. Stark – D’une coalition à l’autre : la politique étrangère de l’Allemagne
M. Schmid. – Le Bundestag et les citoyens allemands hors-jeu ?
K. D. Voigt. – Conditions à remplir par Die Linke en politique
étrangère pour entrer dans une coalition avec le SPD
D. Deschaux-Beaume. – Le coupe franco-allemand et la PESD au quotidien : mythes et réalités
B. M. Essis. – La politique africaine de l’Allemagne depuis 1990 : un regard normatif
Y. Sintomer. – Le débat sur le foulard islamique au miroir allemand
L’actualité sociale par B. Lestrade
Dossier
La mémoire de la RDA et sa représentation en images
Présentation (AA)
C. Loeser. – La Defa : un bilan critique de 60 ans d’histoire
M. Steinle – L’ennemi de classe à l’écran : la RFA vue par la RDA
R. Jessen. – La révolution est-allemande de 1989 comme
« lieu de mémoire » allemand. Iconographie et mémoire collective
L. Pelligrini. – Regards croisés : Valéry Giscard d’Estaing
vu par Die Zeit et Helmut Schmidt vu par Le Nouvel Observateur (1974-1981)
E.Catrain. – La Stasi et le monde universitaire dans les
années 1970 : l’exemple des étudiants étrangers
à l’Université de Leipzig
A. Dupeyrix – Axel Honneth. Un philosophe reconnu
A.-S. Petit-Emptaz. – Kandinsky. Vers la disparition de la figure
M. Gladieux. – Pratique mémorielle et pratique de nature :
la commémoration annuelle du Kohlberg 1949-1990
B. Pivert. – L’abbé Mugnier et l’Allemagne.
Un germanophile dans la tourmente
Comptes rendus
Notes de lecture de J-C. François
Excerpt
EDITORIAL Grèce, Allemagne, France : quelle issue pour la zone euro ?
Les hésitations allemandes face à la mise sur pied d'un plan d’aide européen en faveur de la Grèce et les critiques formulées par de hauts responsables allemands à l’égard de la politique économique et budgétaire de ce pays ont fait apparaître de profondes divergences entre la majorité des pays de la zone euro et l’Allemagne accompagnée des Pays-Bas. Ces deux pays présentent, crise ou non, d’énormes excédents dans leurs comptes des payements courants tandis que les autres pays sont, dans le même temps, affligés de déficits plus ou moins importants. Autrement dit : des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas sont considérés comme compétitifs, car capable de vendre à l’étranger plus qu’ils n’importent de l’étranger. L’Allemagne reproche donc aux autres pays de ne pas avoir fait l’effort de se restructurer à temps pour accroître leur propre compétitivité, visiblement défaillante.
La crise de confiance apparaît au grand jour en ce moment précis, parce que les pouvoirs publics des pays déficitaires se voient obligés de combattre la crise actuelle par un endettement accru et massif alors que les deux pays toujours excédentaires au niveau de leurs comptes courants présentent des budgets publics, certes déficitaires, mais somme toute dans des limites plus « raisonnables ». L’Allemagne accuse donc les pays menacés par la faillite d’Etat de ne pas avoir fait l’effort d’assainir leurs comptes publics lorsqu’il était encore temps (avant la crise) pour engranger suffisamment de « munitions » afin de pouvoir combattre la crise maintenant, sans mettre en danger leur crédibilité financière. Bref, il suffirait, selon l’Allemagne, que chaque pays fasse ses « devoirs » de son coté, sur les deux plans, pour que les choses puissent rentrer dans l’ordre.
Mais que se passerait-il, si tous les pays de la zone euro prenaient comme exemple la politique menée par l’Allemagne depuis la crise engendrée dans ce pays par une politique de réunification passablement « populaire ». La « générosité » avec laquelle l’ancienne R.F.A. avait intégré dans son modèle économique 17 millions d’Allemands de l’ex-R.D.A. provoqua l’envolée des déficits publics et baissa brusquement, via une demande privée stimulée artificiellement, l’excédent traditionnel des comptes extérieurs du pays. Depuis le milieu des années 1990, l’Allemagne cherche à restaurer sa compétitivité et ses équilibres budgétaires par deux approches : depuis 15 ans, les salaires augmentent moins vite que chez la plupart de ses partenaires de la zone euro, de l’Union européenne et des Etats-Unis ; l’introduction d’importantes réformes dans le domaine social (législation « Hartz ») à partir de 2004, l’adoption de la TVA sociale et le report de l’âge légal de la retraite de 65 à 67 ans en 2007, une forme d’écotaxe en 1999 (le produit de cette taxe permet de consolider les cotisations sociales). Ces deux approches ont eu comme effet de stimuler, par la maîtrise des coûts salariaux et des charges sociales, les exportations (et avec elles les excédents extérieurs) et ont permis, grâce à la croissance retrouvée en 2005, d’assainir les budgets publics. Le revers de la médaille de cette politique de compétitivité a été, et reste toujours, une demande intérieure beaucoup moins dynamique qu’ailleurs.
Si tous les pays déficitaires imitaient en pleine crise la politique allemande la conséquence en serait le recul relatif, comme dans cas allemand, de la demande intérieure des pays concernés. Ce recul, non compensé par l’intervention d’un Etat obligé d’assainir ses comptes (cette exigence est actuellement adressée par la Commission européenne à la Grèce, mais aussi à l’Espagne, l’Italie, la France et la Grande-Bretagne), ne pourrait que provoquer une baisse supplémentaire de la croissance dans ces pays et une crise économique endémique aux conséquences politiques imprévisibles. Le seul espoir pour ces pays de se refaire une santé résiderait, comme pour le cas allemand sommairement exposé plus haut, dans l’accroissement rapide de leur compétitivité et, par conséquence, de leurs exportations. Mais il-y-a pourtant un frein à cette stratégie : plus des deux tiers des échanges extérieurs des pays ont lieu en Europe même, dans l’Union et la zone euro. Qui seraient alors les acheteurs des productions compétitives ? Comme l’Allemagne, le reste de l’Europe, n’aurait que compétitivité et exportations en tête, et les portemonnaies relativement vides. Cette situation empêcherait l’écoulement, en Europe même, d’une grande partie des marchandises et services produits grâce à la compétitivité collective retrouvée. La zone euro, dans son ensemble, serait donc contrainte d’expédier une part toujours croissante de son P.I.B. au-delà des frontières de l’Europe. Pour finir comme la Chine, avec des excédents européens gigantesques et de plus en plus insupportables pour le reste du monde.
Une première conclusion s’impose donc : si l’Allemagne est actuellement en mesure d’appliquer son modèle économique, c’est qu’elle peut (pouvait ?) compter, premièrement, sur la capacité d’absorption des pays partenaires en Europe et, deuxièmement, sur le fait qu’elle peut (pouvait ?) cacher ses excédents nationaux dans un océan européen de déficits extérieurs fournis par ses partenaires. Autrement dit : les excédents allemands sont supportables pour le reste du monde parce qu’ils sont « compensés » par les déficits des partenaires européens. Pourtant, l’élément monétaire et la force de l’euro auraient tôt provoqué une sévère correction de la stratégie de compétitivité préconisée par l’Allemagne aux Européens. Car l’Europe n’est pas comparable à la Chine qui extrait artificiellement sa monnaie nationale des marchés monétaires. Fluctuant librement, le renminbi ou yuan gagnerait rapidement en valeur ce qui réduirait autant les excédents chinois que la croissance de ce pays, qui, on l’aura compris, se réalise actuellement en partie sur le dos des partenaires mondiaux. L’euro n’étant pas comparable à la monnaie chinoise, sa valeur s’envolerait dès la première apparition de forts excédents de la zone euro réalisés par tous avec les recettes allemandes. Une deuxième conclusion fait apparaître que la situation actuelle profite à l’Allemagne également sur le plan monétaire, car avec des comptes extérieurs de la zone euro à l’équilibre ou en léger déficit, la tension à la hausse de l’euro est moins sensible. En réalité, l’euro est actuellement sous-évalué si l’on prend en compte, de façon isolée, la compétitivité allemande. Les excédents allemands actuels sont donc aussi, partiellement au moins, le résultat d’une valeur moyenne de l’euro issue du manque de compétitivité de nombreux partenaires de l’Allemagne.
Faut-il donc ne rien faire, laisser les choses en l’état ? Ce n’est pas envisageable non plus, car il ne serait pas soutenable à terme de laisser s’accumuler ici les dettes et là les excédents. Pour revenir à la raison et dépasser les accusations stériles et pénalisantes pour tous, il conviendrait à mon avis de revenir encore une fois aux sources théoriques de la monnaie unique, pour la sauver. Le prix-Nobel Robert A. Mundell les a élaboré au milieu des années 1960 dans un article sur les espaces monétaires optimaux. Il prévoyait alors qu’une zone monétaire, pour rester viable et produire des effets bénéfiques pour tous, nécessiterait, en plus de la libre circulation des capitaux, une mobilité importante de la force de travail ou une flexibilité des salaires vers le bas ou une péréquation financière entre les régions qui composent la zone. Le mieux, pensait-il, serait l’application de l’ensemble de ces moyens d’ajustement. Pour la zone euro, les pères du traité de Maastricht ont évincé la péréquation financière, c'est-à-dire la solidarité budgétaire entre Etats-membres. La mobilité des salariés restera toujours très marginale en raison des frontières linguistiques. Il ne reste donc que la flexibilité des salaires vers le bas, c'est-à-dire la recherche de la compétitivité sur le dos des salariés. Cela reviendrait à valider les exigences allemandes actuelles par rapport à ses partenaires. Mais en même temps, nous avons vu plus haut que ce chemin était bloqué également ou, du moins, semées de fortes embuches.
La seule véritable issue serait donc : inventer un mécanisme de consultations permettant d’ajuster de façon détaillée, équilibrée et contraignante les politiques économiques, monétaires, budgétaires et fiscales – une nouvelle gouvernance économique européenne, non un gouvernement européen. Bâtir une vraie communauté d’intérêts. Une telle gouvernance permettrait de trouver des compromis sur la base d’un donnant-donnant ou d’un jeu à sommes positives. Les positions unilatérales, ce bref exposé le démontre, sont logiquement vouées à l’échec. Cette position a été défendue depuis toujours par la France. Il me semble que c’est la raison même.
Débuts du nouveau gouvernement Merkel et politique étrangère de l’Allemagne
La rencontre d'articles sollicités et de nouvelles contributions fort heureusement proposées à la revue permet de combiner les éléments d’un dossier sur les premiers pas du nouveau gouvernement Merkel et un autre qui éclaire différents aspects de la politique étrangère de l’Allemagne tout en permettant une appréciation plus particulière des évolutions du « couple franco-allemand » sur le long terme et dans l’actualité immédiate.
Angela Merkel relativise volontiers les choses quand elle rappelle les difficultés qu’a rencontrées, à ses débuts, la Grande coalition, forgée fin 2005 entre partis chrétiens-démocrates et social-démocrate. Celles que rencontre son nouveau gouvernement relèvent, sans doute, des tâtonnements habituels pour le parti libéral qui, dans l’opposition, a perdu la maîtrise de l’art de gouverner. Pourtant les difficultés sont, aujourd’hui, incomparablement plus grandes : elles sont d’abord de nature différente, celles de la Grande coalition étant liées au fait que celle-ci était imposées par le vote des électeurs à des partis qui n’en voulaient pas alors que A. Merkel ne cesse d’affirmer qu’elle a appelé de ses vœux l’actuelle coalition chrétienne-libérale ; elles sont encore révélatrices d’oppositions qui ne sont pas simplement politiques, mais aussi d’ordre personnel. Caractère et tempérament des deux leaders de l’actuelle coalition gouvernementale (ou plutôt même de ses trois leaders si l’on voit dans la CSU le troisième parti de la coalition) exacerbent ces divergences. Les dissensions portent sur la politique fiscale tant il apparaît difficilement conciliable de réduire en même temps les impôts - sous prétexte que c’est la condition du retour à la croissance - et les déficits budgétaires accumulés pour faire face à la crise mondiale. Les chrétiens-démocrates ont une vision globale de la situation économique et sociale du pays et cherchent à concilier les intérêts des différentes couches sociales; ils ont veillé à ce que les réductions d’impôts adoptées dans le contrat de gouvernement soient placées sous la réserve de leur faisabilité budgétaire. Les libéraux ont, par contre, une vision plus évidemment clientéliste (servir les professions libérales et les entreprises artisanales), mais surtout ils ont fait des réductions d’impôts le fondement même de leur identité et la preuve de leur fidélité aux engagements pris pendant la campagne électorale. La CSU bavaroise suit sur cette question les libéraux quand elle s’oppose à eux sur de nombreuses autres questions sectorielles ; elle s’oppose aussi volontiers à la chancelière à qui elle reproche de manquer d’autorité. Au total Guido Westerwelle, à la tête du FDP, et Horst Seehofer, à la tête de la CSU, se livrent entre eux et avec la chancelière un combat médiatique qui nuit à l’unité de la coalition gouvernementale.
A ces rivalités triangulaires viennent s’ajouter celles qui opposent le ministre fédéral de la Défense, Karl-Theodor zu Guttenberg, à celui qui essaie d’apparaître comme le chef de la diplomatie allemande, G. Westerwelle (cf. dans ce dossier l’article d’A. Marchetti et H. Stark). Largement critiqué pour son absence de compétences particulières en la matière et son inaptitude à quitter le registre de la campagne électorale, celui-ci en est-même venu à réclamer pour soi un traitement plus loyal quand il représente les intérêts de l’Allemagne à l’étranger. Mais les oppositions sont aussi de fond quand G. Westerwelle laisse entendre qu’il est « optimiste » sur les chances qu’a la Turquie d’entrer au sein de l’Union européenne alors que la chancelière n’a jamais caché que son objectif était de négocier avec la Turquie le statut d’un « partenariat privilégié ». Quant le ministre fédéral de l’aide au Développement, Dirk Niebel (FDP), affiche son souci de rendre son ministère, à terme, inutile, il a peut-être raison d’un point de vue rationnel – l’aide au développement devant, à terme, se rendre elle-même inutile -, l’affichage public est catastrophique et fait douter de l’engagement de l’Allemagne en faveur des pays en développement et en émergence. Sur la question de l’entrée ou non de la présidente de la Fédération des réfugiés, Erika Steinbach, dans le comité directeur de la « Fondation Fuites, Expulsions, Réconciliation », le FDP a fait preuve de constance face à une CSU qui s’est toujours présentée comme le « protecteur » des réfugiés, la chancelière, visiblement mal à l’aise dans cette affaire, cherchant à temporiser. Finalement c’est un mauvais compromis qui l’a emporté : E. Steinbach renonce mais obtient que sa fédération soit mieux représentée au sein de cette fédération qui se trouve ainsi plus fortement politisée, au plus grand dam de la Pologne.
La crise financière en Grèce menace l’entente franco-allemande, ce qui n’est peut-être pas pour surprendre si l’on fait la part du mythe et de la réalité comme le fait Delphine Deschaux-Beaumé dans son étude des rapports franco-allemands en matière de coopération militaire. Ceci étant, on peut comprendre que l’Allemagne cherche à ne pas créer de précédent puisque elle serait inévitablement la plus fortement appelée à contribuer au renflouement de la Grèce et des Etats défaillants qui pourraient suivre. Il reste que son modèle économique orienté vers la production d’excédents commerciaux (cf. outre l’éditorial de H. Brodersen dans ce même numéro, la contribution de P. Commun dans AA, No 189) se fait au détriment de ceux qui produisent des déficits en la matière. Christine Lagarde l’a redit, à la mi-mars, ajoutant que la modération vertueuse de l’Allemagne en matière salarial limitait la demande intérieure allemande et retardait le retour à la croissance pour ses partenaires (cf. « La relation franco-allemande mise à l’épreuve par la crise financière grecque » in Le Monde, 19.03.10).
La contribution de M. Essis aborde la politique africaine de l’Allemagne depuis la fin de la Guerre froide – entre le souci de promouvoir une « bonne gouvernance » et la nécessité de prendre en compte les réalités du terrain – tandis que M. Schmid nous renvoie aux déficits du débat allemand sur la politique afghane dans le contexte du bombardement de deux camions citerne volés par les Talibans dans la région de Kunduz, réalisé en septembre 2009 à la demande de la Bundeswehr. Ce qui n’est, mesuré à l’ensemble des événements dans la région, qu’un avatar de la guerre en Afghanistan a pris en Allemagne une dimension extraordinaire qui porte sur les limites du mandat donné par le Bundestag aux troupes allemandes et surtout sur la nécessité de cet engagement plus guerrier que jamais.
On fera une place à part aux réflexions que nous livrent Karsten D. Voigt sur les conditions d’une coalition du SPD avec Die Linke au niveau fédéral. En abordant ainsi la question, K.D. Voigt commence par la détabouiser : ce n’est pas une question de morale (le passé SED du parti) mais de rapport de forces politique, l’enjeu étant la reconquête du pouvoir ; il reste que, pour qu’une coalition avec Die Linke devienne possible, celui-ci devra remplir les trois conditions habituelles : que penses-tu de l’OTAN, de l’Europe et de sa politique de défense et de sécurité ? Les Verts ont évolué dans le sens de l’acceptation de ces contraintes avant d’être un partenaire acceptable pour le SPD. Le SPD lui-même a rallié, en 1958, les positions chrétiennes-démocrates sur la défense nationale, l’appartenance à l’OTAN et l’ancrage occidental de la RFA avant de devenir un parti de gouvernement, aux côtés de la CDU/CSU, dans la cadre de la première grande coalition qui a vu le jour en 1966 !
Scénarios de « sortie de crise » : le cas allemand
Abstract:
This article is set to describe the present difficulties of the German economy to overcome the most profound economic downturn experienced since the foundation of the German Federal Republic. The article analyses the consequences for the national factors of growth (consumption, investment and public spending) due to the alteration of global demand for Germany. It questions the possibility for the German economy to simply come back to the situation before the crises started, continuing with a system based specifically on exportation strengthened by strongly controlled salary costs and social expenditure – without a special concern for internationally equilibrated exchange of good and services. The article also discusses an alternative way to overcome the crises: a growth strategy based on sustainable growth defined in common by the European member states and coordinated by the European Union.
Résumé :
L'article est conçu comme la chronique des difficultés de l’économie allemande pour sortir de la plus grave crise économique depuis 60 ans. Il analyse les conséquences du recul sensible de la demande mondiale s’adressant à l’Allemagne sur les facteurs internes de la croissance : la consommation, l’investissement et la dépense publique. Il pose la question de la possibilité d’un simple retour à la situation ex ante, à savoir un modèle où la croissance est principalement tirée par les exportations sur fond de maîtrise des coûts salariaux et des dépenses sociales, sans se soucier des équilibres internationaux. L’article esquisse une voie alternative : celle de la construction d’une stratégie de croissance européenne portée par « l’investissement durable », stratégie impulsée par les Etats-membres et coordonnée par l’Union européenne.
Zusammenfassung:
Der vorliegende Artikel ist eine Analyse der derzeitigen Probleme der deutschen Volkswirtschaft und vor allem der Frage, wie die Bundesrepublik die tiefste Wirtschaftskrise seit ihrer Gründung vor 60 Jahren zu überwinden gedenkt. Er analysiert die Konsequenzen des spürbaren Rückgangs der an Deutschland gerichteten Weltnachfrage auf die internen Wachstumsfaktoren: Konsum, Investitionen und Staatsausgaben. Anschließend stellt er die Frage nach einer einfachen Rückkehr zur Situation vor der Krise, d.h. zu einem Modell, welches hauptsächlich von den Exporten auf der Grundlage gezügelter Arbeitskosten und Sozialausgaben angetrieben wird – ohne Rücksicht auf internationale Gleichgewichte. Der Artikel versucht abschließend, eine alternative Wirtschaftspolitik zu skizzieren : der Aufbau einer europäischen Wachstumsstrategie getragen von « nachhaltigen Investitionen », eine Strategie die von den europäischen Mitgliedsstaaten vorangetrieben und von der EU koordiniert wird.
D’une coalition à l’autre : la politique étrangère de l’Allemagne
Contre toute attente, le traditionnel consensus allemand en matière de politique étrangère est mis à l'épreuve au sein de la nouvelle coalition dite « bourgeoise » (alliance des chrétiens démocrates et des libéraux). La cause: des tensions structurelles et de fond entre la chancellerie, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense.
Le Bundestag et les citoyens allemands hors-jeu ? La communication gouvernementale sur l’engagement militaire en Afghanistan. Le bombardement de Kunduz ou l’illustration d’une panne de communication
En automne 2009, le débat public sur l'engagement militaire de la Bundeswehr en Afghanistan a pris un nouvel élan. Deux événements l'expliquent ; d'une part, une frappe aérienne près de Kunduz, responsable de nombreuses victimes civiles et effectuée à la demande du commandement allemand par des appareils américains ; et d'autre part, le changement de gouvernement à Berlin. Après onze années au pouvoir, le SPD s'est retrouvé dans l'opposition et est devenu plus réceptif aux réticences croissantes envers l'engagement militaire en Afghanistan de la part de l'opinion publique allemande.
Dans le contexte du bombardement, une série de ratés en matière de communication au sein du gouvernement se trouve à l'origine de plusieurs démissions et de polémiques fratricides au sein du gouvernement et de la Bundeswehr. Par la suite, une commission d'enquête du Bundestag a été chargée de démêler les circonstances du bombardement, mais aussi des pannes de communication. Cette affaire a déclenché un débat longtemps attendu mais maintes fois reporté sur la communication gouvernementale de l'opération militaire en Afghanistan, les opérations extérieures en général et le rôle de la Bundeswehr dans la société. En ce qui concerne l'engagement en Afghanistan en général, une européisation du débat publique est nécessaire.
Marginalizing the public and the Bundestag:
In autumn 2009 the public debate on the Bundeswehr's operations in Afghanistan gained new momentum. Two reasons account for this change: the bombing near Kunduz by American planes under German command, causing numerous civilian casualties; and the change of government in Berlin. After eleven years in power, the SPD found itself in the opposition and became more receptive to growing reluctance of public opinion in Germany towards military operations in Afghanistan.
In the context of the bombing, a series of failures in the Federal government’s internal and external communication strategy have led to several dismissals and resignations as well as acrimonious and well-publicized quarrels within the government and the Bundeswehr. The Bundestag has established an investigation committee to enquire the circumstances of the bombing, but also the information strategy malfunctions.
This scandal triggered a long overdue and oft-delayed debate over the information policy of the government about the operation in Afghanistan, out-of-area missions in general and the role of the Bundeswehr in society. About the military commitment in Afghanistan, a more Europeanised debate is necessary.
Bundestag und Öffentlichkeit im Abseits ?
Im Herbst 2009 bekam die öffentliche Diskussion über das Engagement der Bundeswehr in Afghanistan neue Dynamik. Dies hatte zwei Gründe. Zum einen hatte ein Bombardement unter deutschem Kommando nahe Kunduz auch zivile Opfer zur Folge. Darüber hinaus kam es in Berlin zum Regierungswechsel. Nach elf Jahren an der Macht fand sich die SPD in der Opposition wieder und zeigte sich fortan dem militärischen Engagement in Afghanistan kritischer gegenüber als noch zu Regierungszeiten, wohl auch, um von der noch kritischeren öffentlichen Meinung zu profitieren.
Im Zusammenhang des Bombardements gab es eine Reihe von Kommunikationspannen innerhalb der Bundesregierung, die mehrere Entlassungen und Rücktritte sowie gegenseitige öffentliche schuldigungen in der Öffentlichkeit zur Folge hatte. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, um die Umstände des Bombardements, aber auch der Kommunikationspannen, aufzuklären.
Diese Affäre war der Auslöser einer überfälligen Debatte über die Informationspolitik der Regierung über den Einsatz in Afghanistan, die Auslandseinsätze im Allgemeinen und die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft. Bezüglich des Engagements in Afghanistan, wäre auch eine weniger nationale und zumindest europäisch orientierte Debatte hilfreich.
Conditions à remplir par Die Linke en politique étrangère pour entrer dans une coalition avec le SPD
Au début des années 1980, de nombreux sociaux-démocrates ne pouvaient imaginer de participer à une coalition avec le Verts au niveau fédéral. La CDU/CSU, qui cherche aujourd'hui à s’allier aux Verts au sein de coalitions, ne voyait alors en eux que des ennemis de la constitution. Le passé maoïste, trotskiste ou anarchiste de nombre de leurs leaders était mis en avant comme aujourd’hui le passé communiste des représentants de « Die Linke ».
Et de fait les Verts défendaient alors tout comme « Die Linke » aujourd’hui des positions parfaitement inacceptables en politique étrangère, en politique de sécurité et en politique européenne. Aussi bien les débats actuels sur une possible coalition avec « Die Linke » au plan fédéral n’offrent-ils – tout comme en son temps ceux avec les Verts – de perspectives concrètes pour la pratique politique que si « Die Linke » fait preuve de sa capacité à changer son mode de pensée. Pour l’instant « Die Linke » défend encore dans ces domaines une position qui n’est, en vérité, rien d’autre qu’unerefus de réalité. Il n’en allait pas autrement des Verts au début.
Les Verts au début et la politique étrangère
Après l’entrée des Verts au Bundestag, je faisais partie d’un petit groupe de membres du SPD et des Verts, qui cherchait à déterminer les bases d’une future coopération gouvernementale rouge-verte. L’un des thèmes les plus difficiles de nos délibérations étaient la politique étrangère, la politique de sécurité et la politique européenne. De mon point de vue, les Verts, issus des groupes de base pacifiste n’étaient pas en mesure et n’avaient, en partie également, pas la volonté – par peur des déchirements que provoquerait à l’intérieur du parti une remise en cause de leurs positions – de réfléchir de façon rationnelle aux conditions cadre d’une politique étrangère de la RFA.
J’écrivis dans ce contexte, en 1983, un article publié dans la revue Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte où l’on pouvait lire : « [Les Verts] méconnaissent en la matière que la République fédérale, de par son histoire, sa situation, en particulier de par la situation de Berlin, a un très fort intérêt à satisfaire ses besoins de sécurité dans un système international. En raison de son histoire, parce que nos voisins européens ont eu, à plusieurs reprises au cours des cent dernières années, à souffrir des décisions unilatéralement prises au plan national au nom de la politique allemande de sécurité par le militarisme allemand… »
La situation de Berlin a fondamentalement changé, l’Allemagne est réunifiée, le conflit Est-Ouest est surmonté. Mais l’intérêt de tous nos voisins à ce que la politique de l’Allemagne demeure internationalement encadrée demeure. Qui ne tient pas compte de cet intérêt de nos voisins, se transforme pour eux en un problème de sécurité.
Les voisins de l’Allemagne ne veulent pas de cavaliers seuls
Tous nos voisins, y compris ceux qui ne font pas partie de l’Union européenne, ont un intérêt à ce que l'Allemagne ne reste pas seulement membre de l’Union européenne, mais encore qu’elle encourage les compromis entre Etats membres et les accepte également pour elle-même. Le « non » que « Die Linke » a opposé au compromis négocié pour aboutir au traité de Lisbonne est contraire à ce que l’on attend de l’Allemagne. C’est à juste titre perçu comme une renationalisation de la politique allemande, même quand « Die Linke » justifie son rejet avec des arguments internationalistes.
Tous nos voisins, y compris ceux qui ne font pas partie de l’OTAN, sont favorables à l’appartenance de l’Allemagne à cette alliance. La crainte d’une Allemagne neutre dont la sécurité relèverait de son organisation nationale a été en 1990, même pour l’Union soviétique si forte que celle-ci a fini par accepter finalement l’appartenance de l’Allemagne unifiée à l’OTAN. L’idée favorisée en 1990 par quelques-uns au sein du SPD d’un nouveau système de sécurité qui rassemblerait toute l’Europe et serait préférable à l’OTAN est plus que jamais une illusion vu que presque tous les voisins de l’Allemagne appartiennent à l’OTAN et n’envisagent nullement de la quitter.
Même des voisins tels que la Suisse, qui ne font pas partie de l’OTAN, ne seraient pas disposés à confier leur sécurité nationale à un nouveau système collectif de sécurité englobant l’ensemble de l’Europe. Il est certes important de renforcer l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), mais l’idée que celle-ci puisse se transformer en un système collectif de sécurité capable de réagir à des conflits militaires et qui pourrait remplacer l’OTAN est contraire aux intérêts de sécurité de la plupart de nos voisins. Un tel objectif ne peut donc être une vision positive, ce n’est qu’un rêve illusoire et irréaliste, pour nombre de nos voisins, c’est même un cauchemar.
Le temps des actions de l’Allemagne en cavalier seul est passé
L’Allemagne est le pays de l’Union européenne le plus peuplé, il est des Etats-membres celui qui a le plus de voisins immédiats, il exerce une plus grande influence que ses voisins de taille inférieure. Dans un document de travail réalisé en 2009 par un observateur étranger de la « Fondation Science et politique » sur la relation entre grands et petits Etats en Europe, on peut lire : « L’Allemagne est le membre le plus important de l’UE. De plus, il est celui qui est le plus centralement situé au cœur même de l’Europe. Son histoire est l’histoire de l’Europe. Aucun autre Etat n’a à ce point déterminé le destin de l’Europe comme l’Allemagne. En conséquence de quoi, tout ce qui se passe en Allemagne a un effet visible dans toute l’Europe. »
Si l’Allemagne ne veut pas être la cause de crises au sein de l’UE et de l’OTAN, elle peut encore moins que ses voisins plus petits se permettre des expériences nationales en cavalier seul. Cela signifie par exemple que l’Allemagne pourrait, à l’intérieur de l’OTAN, favoriser d’autres stratégies ou même – ce serait à mon sens, dans un avenir proche, une erreur – plaider en faveur d’un retrait d’Afghanistan. Mais une action unilatérale de l’Allemagne en matière de stratégie ou un retrait des troupes allemandes d’Afghanistan qui ne seraient pas coordonnés avec ses partenaires européens de l’OTAN seraient destructeurs.
« Die Linke » n’est pas encore capable d’assumer des responsabilités gouvernementales
Sur ces trois points, « Die Linke » poursuit une politique qui est fondée sur d’autres conceptions et est dans le détail différente. C’est pourquoi « Die Linke » n’est pas encore au plan fédéral, dans les trois domaines que sont la politiquer étrangère et de sécurité ainsi que la politique européenne, un partenaire approprié pour le SPD.
Je ne suis pas par principe opposé à une coalition avec « Die Linke », même au plan fédéral. Mais une telle coalition doit faire que l’on prenne en Allemagne en compte les problèmes internationaux et non pas que l’Allemagne devienne un problème international. C’est pourquoi les sociaux-démocrates qui souhaitent ouvrir la voie à de futures coalitions avec « Die Linke » doivent insister avec force pour que ce parti change sa façon de penser en matière de politique étrangère et de sécurité ainsi que de politique européenne. Il y va dans l’affaire autrement que dans les questions de politique intérieure. La question ne peut être ici seulement de savoir si l’opinion publique soutient un changement radical d’orientation ou si un compromis est possible entre les futurs partenaires d’une coalition gouvernementale, aussi important que soit le compromis dans une démocratie.
Empêcher la renationalisation de la politique étrangère
Pour vérifier si la politique allemande est capable de contribuer à la solution de problèmes ou bien si cette politique est perçue comme le problème, il est essentiel que tout gouvernement fédéral ait le volonté et la capacité de développer sa vision et de préciser ses intérêts dans les processus européens comme internationaux de telle sorte que la vision qu’en ont les autres et que les intérêts des partenaires de l’Allemagne soient suffisamment pris en compte. Toute autre politique conduirait, du point de vue de nos voisins, à rendre à nouveau virulente cette question allemande que vient enfin de régler, après bien des siècles, l’intégration de l’Allemagne unifiée dans l’Union européenne et dans l’OTAN.
A gauche comme à droite, on trouve en Europe des projets politiques qui reviennent, de fait, à renationaliser la politique étrangère, la politique de sécurité et la politique européenne. C’est autant regrettable qu’inquiétant. Mais dans le cas de l’Allemagne, une telle évolution ne serait être qu’une ré-orientation qui compromettrait la qualité des relations que nous entretenons aujourd’hui avec tous nos voisins. C’est pourquoi la perspective d’une coalition au niveau fédéral avec « Die Linke » ne peut être une alternative susceptible d’aboutir que si dans les trois domaines cités de la politique étrangère et de sécurité comme de la politique européenne ce parti engage un processus de clarification de ses positions et ré-oriente ensuite ses positions.
* Karsten D. VOIGT : Après avoir été porte parole du groupe parlementaire social-démocrate au Bundestag pour les Affaires étrangères, K. D. Voigt a été de 1999 à 2009, au sein du ministère fédéral des Affaires étrangères Coordinateur pour la coopération germano-américaine.
Le coupe franco-allemand et la PESD au quotidien : mythes et réalités
La coopération franco-allemande en matière de sécurité et de défense est souvent présenté comme un moteur dans la construction de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD) depuis les années 1990. C'est en effet ce que les leaders politiques des deux pays mettent en avant. Mais en réalité, lorsque l’on s’intéresse à ce moteur supposé dans les niveaux d’exécution des ministères des Affaires étrangères et de la Défense dans les capitales et surtout à Bruxelles, force est de constater que cette image de moteur semble tenir largement du mythe, et ne correspond pas au vécu des acteurs de terrain. La politique européenne de défense offre des opportunités politiques au couple franco-allemand, mais la compréhension de ce projet dans les services en charge de sa mise en œuvre au quotidien nécessite encore un apprentissage réciproque de la façon de travailler du partenaire.
Zusammenfassung
Die deutschen-französische Zusammenarbeit in Sicherheit und Verteidigung wird oft als Motor im Bau der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) seit den 90er Jahren vorgestellt. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie die politischen Vertreter beider Länder darauf aufmerksam machen. Aber in der Realität sieht man ganz klar, wenn man dieses angebliche Motor auf die Arbeitsebenen der Auswärtigen Amte und Verteidigungsministerien in den Hauptstädten und meistens in Brüssels prüft, dass dieses Motorsabbild viel mehr als Mythos scheint und nicht der Erfahrung des Akteure entspricht. Die Europäische Verteidigungspolitik bietet zwar den deutsch-französischen Zusammenarbeit politischen Gelegenheiten aber dieses Projekt braucht noch auch auf die Arbeitsebene eine gegenseitige Ausbildung, um den Partner und seine Arbeitskultur besser verstehen zu können.
Summary
The French-German partnership in security and defence is often presented as an engine in the construction of the European Security and Defense Policy (ESDP) since the 1990s. It is actually the way political leaders in both countries tend to present their cooperation. But the reality of this presumed engine seems much more to become a myth when the analyst comes to observe the way the executive services of the Foreign Affairs and defense ministries in both capitals and moreover in Brussels really work: the image of French-German motor does not match with the ground actors daily experience. The European Defence Policy offers actually political opportunities for the French-German couple but the comprehension of this project in the services dedicated to its daily implementation still needs a mutual learning of each partners working culture.
La politique africaine de l’Allemagne depuis 1990 : un regard normatif
Cet article s'est proposé d’évaluer la politique africaine de l’Allemagne depuis 1990 à l’aune des deux approches normatives concurrentes des Relations internationales que sont le communautarisme et le cosmopolitisme. Du point de vue communautariste, la politique africaine de l’Allemagne n’a de sens que dans la mesure où elle profite directement ou indirectement à l’Allemagne. L’action de l’Allemagne en vue de la promotion de la démocratie et des droits de l’homme ou encore de la bonne gouvernance n’est motivée que par la volonté de contenir les flux migratoires en provenance de l’Afrique. Les cosmopolites reconnaissent que, depuis 1990, la politique africaine de l’Allemagne a opéré une réorientation normative notable en mettant l’accent sur la promotion de la démocratie et des droits de l’homme. Cependant, ils formulent des griefs contre cette politique africaine. Il s’agit par exemple du mutisme de l’Allemagne face à la tendance néo-impérialiste de la politique africaine de certains de ses partenaires européens, du financement de groupes armés par des multinationales allemandes ou encore de l’insuffisance des efforts en vue de la réduction des émissions de gaz à effets de serre.
Kurzfassung
In diesem Artikel geht es um die Bewertung der deutschen Afrikapolitik seit 1990 im Lichte des Kommunitarismus und des Kosmopolitismus. Beide Ansätze stellen die konkurrierenden normativen Theorien der Internationalen Beziehungen dar. Aus kommunitaristischer Sicht betrachtet dient die deutsche Afrikapolitik direkt oder indirekt der Durchsetzung deutscher Interessen. Der Beitrag Deutschlands zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten zielt auf die Eindämmung der Migrationsströme aus Afrika ab. Aus kosmopolitischer Perspektive betrachtet hat die deutsche Afrikapolitik seit 1990 eine erhebliche normative Umorientierung vorgenommen, und zwar indem sie die Förderung von Demokratie und Menschenrechten zum Schwerpunkt machte. Trotz dieser positiven Entwicklung formulieren die Kosmopoliten einige Vorwürfe, die beispielsweise das Laisser-faire Deutschlands angesichts der neo-imperialistisch geprägten Afrikapolitik seiner EU-Partner, die Finanzierung bewaffneter Gruppierungen durch deutsche Konzerne in Afrika oder etwa die unzureichenden Bemühungen Deutschlands um die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen betreffen.
Le débat sur le foulard islamique au miroir allemand
A l'heure où la question de la burqa enflamme les esprits dans l’Hexagone, cet article compare les controverses sur le port du foulard islamique en France et en Allemagne. Il retrace la généalogie du débat dans les deux pays, marquée par un décalage important dans les années 1990 et une apparente convergence entre 2003 et 2008, analyse les structures juridico-institutionnelles qui ont permis de réguler la controverse et la façon dont les champs politiques ont réagi à l’épreuve, en soulignant que les transferts qui se sont opérés entre les deux côtés du Rhin sont asymétriques. Il montre que les enjeux identitaires ne sont qu’en partie semblables et que les rapports historiques, culturels et symboliques qui s’établissent entre les populations concernées par le port du voile et les pays dits « d’accueil » sont eux-aussi assez contrastés. Enfin, il souligne que les cadres normatifs qui permettent de donner sens au « problème » diffèrent eux-aussi largement, la « laïcité à la française » n’ayant guère d’équivalents dans une Allemagne où s’affrontent « sécularisme » et « modèle chrétien-occidentale ».
DOSSIER : La mémoire de la RDA et sa représentation en images
« Il ya vingt ans, la chute du Mur », ainsi s'intitulait, parmi tant d’autres manifestations consacrées en France au vingtième anniversaire de la chute du Mur, une journée d’études organisée en commun, les 8 et 9 octobre 2009 à Lille, par le Goethe-Institut de Lille, l’IEP de Lille et le Centre d’études en civilisations, langues et littératures étrangères de l’Université Charles de Gaulle - Lille 3 (CECiLLE). Le choix de la date était délibéré, la journée du 9 octobre à Leipzig ayant amorcé les événements suivants qui conduisirent à la chute du Mur et à l’unification de l’Allemagne. La première partie a été consacrée à l’étude de l’événement qu’a été la chute du mur (J. Vaillant, Lille3), à l’analyse du régime de la RDA (R. Jessen, Cologne), à la singularité de la transformation de la RDA (V. Lozac’h, Strasbourg) et au rôle de l’Allemagne unifiée en tant que puissance de médiation civile (S. Martens, Bordeaux 3). Cette première partie s’est achevée par une table rond sur l’Allemagne en Europe et dans le monde, dirigée par M. Hastings (Centre d’études de l’Europe du Nord, IEP de lIlle). Ces différentes contributions ont été publiées en tout ou partie dans le numéro spécial de la revue (No 189, La mémoire de trois fondations) ou dans J.-P. Cahn/U. Pfeil (éds), Allemagne 1974-1990. De l’Ostpolitik à l’unification, Villeneuve d’Ascq (PU du Septentrion) 2009.
La seconde partie, introduite par P. Mathiot, directeur de l’IEP de Lille, Dorothee Ulrich, directrice du Goethe-Institut de Lille, et Isabelle Terrein, responsable du cursus intégré franco-allemand de l’IEP de Lille, a porté sur « la mémoire de la RDA et sa représentation en images ». C’était une des spécificités de cette journée d’études que de recourir aux films et aux images pour faire comprendre les évolutions de la RDA, ses autoreprésentations et les perceptions qui en restent dans la mémoire collective d’aujourd’hui. Une série de films ont été présentés, en partenariat avec l’Association Plan-Séquence, au cinéma Majestic, qui ont été autant de signes avant-coureurs d’un désir de changement en RDA à la fin des années 1980 : Jadup und Boel de Rainer Simon. (1981/1988), Winter adé de Helke Misselwitz (1989), Überall ist es besser, wo wir nicht sind de Michael Klier (1989), Neues aus Wittstock de Volker Koepp (1992), Die Architekten de Peter Kahane (1990) ainsi également que Das Versprechen de Margarethe von Trotta (1994). Nous reproduisons ici trois des quatre contributions qui ont été présentées lors de cette deuxième partie, la quatrième, de Cyril Buffet, ayant été déjà publié sous le titre „RDA, mon amour. De la représentation du mur de Berlin dans le cinéma est-allemand" dans notre numéro 189.
L’ennemi de classe à l’écran : la RFA vue par la RDA
La confrontation avec la RFA était pour la RDA pendant ses 40 ans d'existence à la fois un sujet central et un problème médiatique : l’ennemi de classe servait en tant que matrice négative à légitimer la RDA présentée comme une meilleure Allemagne qui avait tiré les conséquences du passé. Mais comment dénoncer le capitalisme sans en même temps créer une certaine fascination à travers le média sensuel qu’est l’image animée ? L’article présente les thèmes les plus importants et retrace l’évolution des stratégies de représentation de la RFA vu par les productions cinématographiques et télévisuelles de la RDA de 1949 jusqu’à la chute du Mur.
The class enemy on the screen: FRG seen by GDR
For the 40 years it lasted, the GDR has seen its faceoff with the FRG as a core issue as well as a media problem. The image of the class enemy was used as a negative-foil to legitimate the GDR, then presented as a "better Germany", capable of learning the lessons from the past.
But how can you expose capitalism without fostering the public’s fascination for such an appealing (sensual) media as moving pictures? This article will present the major themes on the subject and explain how the strategies to represent the FRG evolved in time on GDR’s television and film screens from 1949 to the fall of the Berlin Wall.
Der Klassenfeind auf Leinwand und Bildschirm. Die BRD aus DDR-Sicht
Die Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik war für die DDR in den 40 Jahren ihrer Existenz ein zentrales Thema und ein mediales Problem: Diente das Feindbild BRD doch als Negativfolie zur Selbstlegitimation als das bessere Deutschland, das die Lehren aus der Vergangenheit gezogen hatte. Wie aber den Kapitalismus anprangern ohne zugleich im sinnlichen Medium des bewegten Bildes die Faszination von diesem zu befördern? Der Artikel präsentiert die zentralen Themen und verfolgt die Entwicklung der Darstellungsstrategien, mit denen die Bundesrepublik in DDR-Film- und -Fernsehproduktionen von 1949 bis zum Mauerfall dargestellt wurde.
Regards croisés : Valéry Giscard d'Estaing vu par Die Zeit et Helmut Schmidt vu par Le Nouvel Observateur (1974-1981)
Regards croisés : Valéry Giscard d'Estaing
vu par Die Zeit et Helmut Schmidt vu par Le Nouvel Observateur (1974-1981)
La Stasi et le monde universitaire dans les années 1970 : l’exemple des étudiants étrangers à l’Université de Leipzig
L'article proposé traite de la surveillance des étudiants étrangers exercée par le ministère pour la Sécurité d’Etat à l’Université Karl Marx de Leipzig dans les années 1970. Les étudiants étrangers, présents en grand nombre à l’Université de Leipzig et en particulier à l’Institut Herder, institut de formation en langue allemande, obtinrent une attention toute particulière des officiers de la Stasi. Il s’agissait de contrôler les étudiants étrangers à l’université mais également au sein de leur vie privée. Pour cela, la Stasi se reposait sur un vaste réseau d’informateurs et sur des échanges officiels avec les membres de la direction de l’université. Son réseau d’informateurs était composé à la fois d’étudiants étrangers et d’employés de l’Université Karl-Marx. Le travail du ministère pour la Sécurité d’Etat restait avant tout préventif, dans la mesure où le but principal était de recueillir un maximum d’informations sur chaque étudiant étrangers présent à l’université.
The Ministry for State Security at universities: the example of foreign students at the Karl-Marx University in Leipzig in the seventies.
This article presents the system that the Ministry for State Security set up to monitor the activities of foreign students at the Karl-Marx University in the seventies. There were a lot of foreign students at the University and particularly at the Herder Institute, where they studied German language courses. The aim was to watch the students in their private lives as well as at university. To do so, the Stasi used a large network of unofficial informers and official correspondence with the members of the university management. Its network of informers was made up of foreign students and staff of the Karl-Marx University. The work carried out was preventive, the aim being to collect as much information as possible about each foreigner studying at the university.
Die Überwachung der ausländischen Studenten durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) an der Karl-Marx Universität Leipzig in den 1970er Jahren
Im folgenden Artikel werden die Aktivitäten des MfS zur Überwachung der ausländischen Studenten an der Karl-Marx-Universität in den 1970er Jahren untersucht. Die Kontrolle dieser Zielgruppe stellte einen Schwerpunkt in der Arbeit des MfS an der Universität dar, bedingt durch die Anwesenheit zahlreicher Studenten ausländischer Herkunft insbesondere am Herder-Institut, an dem jeder ausländische Student eine sprachliche Ausbildung absolvierte. Die ausländischen Studenten wurden sowohl im Rahmen ihres Studiums als auch in ihrem Privatleben observiert. Um eine umfangreiche Kontrolle zu üben, verfügte das MfS über ein weit ausgebautes Netz an Inoffiziellen Mitarbeitern, das sowohl aus ausländischen Studenten als auch aus Mitarbeitern der Leitungsebene und des Lehrpersonals der Universität bestand. Zudem unterhielt das MfS zur Leitungsebene der Universität offizielle und regelmäßige Kontakte. In diesem Zusammenhang übte das MfS vorwiegend eine präventive Arbeit aus.
Axel Honneth, un philosophe reconnu.
Axel Honneth, né en 1949, est professeur de philosophie. Il dirige à Francfort l'Institut de recherches en sciences sociales (Institut für Sozialforschung), fondé dans les années 1920 et dirigé à partir des années 1930 par Adorno et Horkheimer. Il représente la troisième génération de ce que l’on appelle l’« École de Francfort ».
Dans la tradition de l’Institut, qui est de proposer une théorie critique de la société, Honneth travaille, depuis de nombreuses années, à identifier les « pathologies sociales » induites par le capitalisme. Partant d’une analyse des interactions concrètes, du sentiment d’injustice que les acteurs sociaux peuvent ressentir dans leur vie quotidienne, et abandonnant le point de vue surplombant d’une philosophie spéculant sur la meilleure société possible, Honneth a développé une œuvre originale dont le fil conducteur peut s’énoncer en termes de « théorie de la reconnaissance ». Cette théorie connaît en France, depuis quelques années, une réception enthousiaste et nourrit le débat sur la justice sociale et les fondements normatifs de la démocratie.
Cet article tentera de restituer les étapes du parcours intellectuel de Honneth, de discuter les apports de sa théorie de la reconnaissance et de comprendre les raisons du véritable intérêt qu’elle suscite.
Axel Honneth, A Recognized Philosopher
Axel Honneth (born in 1949) is a Professor of Philosophy. He is the Director of the Institute of Social Research (Institut für Sozialforschung) in Frankfurt, founded in the 1920s and headed by Adorno and Horkheimer from the 1930s. He is the leading figure of the third generation of the "Frankfurt School".
Following the tradition of the Institute, which aims to produce a critical theory of society, Honneth has for years been trying to identify the “social pathologies” caused by capitalism. His “theory of recognition” relies on a study of concrete interactions, on feelings of injustice social actors may experience in daily life, and refuses to adopt the overarching position of a philosophy devoted to speculation about the best possible society. This theory has, for several years now, enjoyed an enthusiastic reception in France and contributes to current discussions on social justice and the normative grounds of democracy.
In this article, we will try to reconstruct the various milestones in Honneth’s intellectual career, to assess the benefits of his theory of recognition and to analyze the reasons of its success.
Axel Honneth, ein anerkannter Philosoph
Axel Honneth (geb. 1949) ist Professor für Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt/Main. Er ist ebenfalls Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, das in den 1920er Jahren gegründet und ab den 1930er Jahren von Adorno und Horkheimer geleitet wurde. Er vertritt die dritte Generation der sog. „Frankfurter Schule“.
Honneth schließt sich der Tradition des Instituts, einer kritischen Gesellschaftstheorie, an. Er arbeitet seit Jahren daran, die vom Kapitalismus hervorgebrachten „sozialen Pathologien“ zu identifizieren. Seine „Theorie der Anerkennung“ geht von einer Analyse der konkreten Interaktionen und des Gefühls der Ungerechtigkeit aus, welche die sozialen Akteure im Alltag erleben mögen. Er verzichtet dabei auf den Blick eines über den Dingen stehenden Philosophen, der über die bestmögliche Gesellschaft spekuliert. Die Theorie Honneths wird seit einigen Jahren in Frankreich mit Begeisterung rezipiert und trägt zur Diskussion über soziale Gerechtigkeit und normative Grundlagen der Demokratie maßgeblich bei.
Ziel dieses Artikels ist es, die verschiedenen Etappen der intellektuellen Laufbahn Honneths zu rekonstruieren, die Vorzüge seiner Theorie der Anerkennung zu evaluieren und die Gründe ihres aktuellen Erfolgs zu analysieren.
L’abbé Mugnier et l’Allemagne. Un germanophile dans la tourmente
Entre 1880 et le début de la Seconde Guerre mondiale, l'abbé Mugnier fut une figure incontournable des salons parisiens. Avec une bonne dose d’esprit et de finesse psychologique, cet homme du peuple parvint à conquérir les cœurs d’écrivains de renom et de nobles lettrés. Comme il apparaît à la lecture de son journal (Journal de l’abbé Mugnier, Mercure de France), si l’abbé goûtait les pompes et les soupers fins, c’est à l’Allemagne et à la culture allemande qu’allait son amour. Rien ne pouvait rivaliser avec Goethe, Wagner, les petites villes paisibles et les forêts germaniques. Pourtant l’amour de Mugnier pour l’Allemagne fut un amour douloureux tant la haine de l’Allemagne était vivace en France depuis 1870. Dans son journal, l’abbé dépeint l’atmosphère hostile de l’époque. Nul n’est épargné, ni le clergé et sa tiédeur ni les catholiques revanchards si peu chrétiens. Les tirades haineuses des intellectuels français sont épinglées comme une trahison de l’intelligence. Au fil des années, Mugnier a de plus en plus de mal à aimer l’Allemagne d’un amour inconditionnel. La Première Guerre mondiale met cet amour à rude épreuve. Avec la montée du nazisme, le lien pourtant si fort manque de se rompre. Mugnier s’éteint en 1944 à Paris. Triste mais pas désespéré car il sait que le nazisme n’est pas l’Allemagne et que l’âme allemande est ailleurs.
The Abbé Mugnier and Germany
Between 1880 and the beginning of World War II the Abbé Mugnier was a star in the Paris salons. With his talent for wit and psychology he conquered the hearts of famous writers and cultured noblemen. Reading his diary (Journal de l’abbé Mugnier, Mercure de France) reveals that the priest enjoyed glamour, luxury and fine suppers, but above all he loved Germany and German culture. He liked nothing more than Goethe and Wagner, the peaceful small towns and German forests. However, Mugnier’s love for Germany was a painful love because since 1870 the hatred towards Germany was rampant in France. In his diary the priest depicts the hostile atmosphere of that time. He criticizes the half-hearted clergy as well as the unchristian, vindictive Catholics. In his eyes, the speeches of the French intellectuals who preached hatred were a betrayal of intelligence. As time goes by, it becomes more and more difficult for Arthur Mugnier to love Germany without reservations. After the sobering experience of World War I, his inner conflict reaches a climax with the ascent of National Socialism. Mugnier dies in 1944 in Paris: grieving but not in despair, because he knows that Nazism is neither Germany nor the true German soul.
Der Abbé Mugnier und Deutschland
Zwischen 1880 und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war der Abbé Mugnier in den Pariser Salons ein gern gesehener Gast. Mit viel Esprit und Einfühlungsvermögen eroberte dieser Mann aus dem Volk die Herzen namhafter Schriftsteller und gebildeter Adliger. Wie aus seinem Tagebuch hervorgeht (Journal de l’abbé Mugnier, Mercure de France), schätzte der Abbé den Prunk und die feinen Soupers, aber seine größte Liebe galt Deutschland und der deutschen Kultur. Ihm ging nichts über Goethe, Wagner, die beschaulichen Kleinstädte und die deutschen Wälder. Dabei war Mugniers Liebe zu Deutschland eine schmerzliche Liebe, denn in Frankreich loderte seit 1870 der Hass auf das Nachbarland. In seinem Tagebuch beschreibt der Abbé die feindselige Atmosphäre jener Zeit. Niemand wird verschont, weder der laue Klerus noch die rachsüchtigen, unchristlichen Katholiken. Die Hasstiraden der französischen Intellektuellen werden als Verrat an der Intelligenz gebrandmarkt. Mit der Zeit fällt es Mugnier aber zunehmend schwer, Deutschland vorbehaltlos zu lieben. Der Erste Weltkrieg stellt seine Liebe auf eine harte Probe. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus kommt es zur Zerreißprobe. 1944 stirbt Mugnier in Paris: betrübt, aber nicht verzweifelt, denn er weiß, dass der Nationalsozialismus nicht das wahre Gesicht Deutschlands ist.
Comptes rendus Jean-Paul Cahn, Ulrich Pfeil (éds.), Allemagne 1974-1990. De l'Ostpolitik à l'unification, vol. 3/3, Villeneuve d'Ascq (Presses universitaires du Septentrion) 2009.
Le tome 3 de l'ouvrage de J-P. Cahn et U. Pfeil est paru fin 2009 et traite de la dernière période où coexistent les deux Etats sans pour autant considérer cette dernière période 1974-1990 comme la "préhistoire de l'unification allemande". Il est consacré à "la modification plus large de la configuration internationale qui entraîna la disparition de l'un des deux blocs dont les rivalités avaient rythmé la Guerre froide". Au début de cette période, en 1975, la signature des accords d'Helsinki marqua une première évolution des rapports entre les deux Allemagne et leur présence sur la scène internationale (H. Wentker). Certes, des stratégies antagonistes persistaient, en particulier en faveur du tiers-monde, même si Berlin-Est dut y réduire ses ambitions politiques à cause de sa faillite économique (J. Thorel). En revanche, des deux côtés du Mur, des formes d’action se développèrent dans les années 1980 pour promouvoir le mouvement de la Paix (H. Miard-Delacroix).
Sur le plan économique, il n’est pas étonnant que les deux Etats allemands aient trouvé des solutions différentes pour sortir de la crise après le premier choc pétrolier de 1974, la RDA s'engluant peu à peu dans un manque de compétitivité qui ne devait se révéler qu'après son effondrement. A sa rigidité croissante correspondait en RFA un infléchissement progressif de l'économie de marché et une consolidation de sa place dans l'économie mondiale (J-F. Eck). L'économie de pénurie de la RDA, son incapacité à ouvrir un espace à une logique de la consommation eurent pour conséquence une accumulation de frustrations chez les citoyens de la RDA qui désirèrent faire voler en éclat le système de planification (P. G. Poutrus). Si l'on put constater des changements de mentalité parallèles dans les deux Etats allemands au cours des années 1970-1990, ils s'effectuèrent en RDA dans une contradiction entre les intérêts individuels et ceux prônés par les dirigeants (J. Neuheiser, A. Rödder).
La rivalité entre les deux blocs amena la RDA, jusque dans les années 1980, à accorder un certain soutien aux membres de la RAF (T. Wundschik). La télévision était devenue "l'arme et le miroir du conflit interallemand " (C. Defrance). Si – après l'affaire Biermann en 1976 – la Stasi renforça son emprise sur les studios, le Nouveau cinéma allemand tendit à l'Ouest à privilégier la confrontation avec le passé nazi et, des deux côtés, une poignée de femmes essaya de passer derrière la caméra (C. Buffet). Peut-on pour cette même période conclure à un rapprochement des champs littéraires de la RDA et de la RFA (C. Hähnel-Ménard) ? Des deux côtés, l'écrivain Stefan Heym fut accusé de ne pas être capable d'interpréter de manière cohérente l'effondrement de la RDA (S. Leverd). Entre mai et décembre 1989, à la suite d'une crise générale, la RDA cessa d'exister en tant qu'Etat des ouvriers et des paysans sous la direction du SED (J. Vaillant). L'étude du rôle des partis gouvernementaux en RFA depuis 1982 permet de mieux comprendre dans quel contexte Kohl put prendre des décisions importantes (R. Marcowitz). Leurs échos et la réception critique de l'unification au sein du SPS sont au cœur de la contribution de J-P. Cahn, tandis qu'U. Pfeil étudie l'unification vue dans un contexte international et F. Bozo l'attitude de la France. Vingt ans après l'unification allemande (A. Schmidt), l'histoire de la République fédérale et les débats auxquels elle a donné lieu doivent être appréhendés différemment : succès, échec, modernisation, occidentalisation, histoire lourde à porter sont à revoir en fonction du diagnostic du présent et des débats publics actuels.
Le danger pourrait être de ne considérer cette histoire que dans la mesure où elle peut servir à expliquer l'effondrement de la RDA. Mais dans leurs trois copieuses introductions à ces trois volumes, J-P. Cahn et U. Pfeil mettent en garde contre une telle dérive. Leur objectif est également de ne pas réduire la RDA "à l'opposition en négatif à la réussite ouest-allemande", mais plutôt de fonctionner de manière intégrative. Les contributions réussissent en général à ne pas considérer d'une part la RDA et d'autre part la RFA, mais à présenter de manière thématique les interactions entre les deux Etats. Il faut saluer cette démarche comparatiste.
- Anne-Marie CORBIN -
Marc Cluet (sous la dir. de),
Villégiatures à l'allemande. Les origines germaniques du tourisme
vert 1850-1950, Rennes (Presses
universitaires de Rennes)
2009, 388 p.
La collection « Etudes germaniques» des Presses Universitaires de Rennes (PUR) s'est fait une spécialité d'ouvrages d'histoire culturelle de l'Allemagne, abordant des sujets originaux tels que l'amour des animaux dans le monde germanique (2006) ou la fascination de l'Inde en Allemagne (2004). En 2009, cette dernière publication, également dirigée par Marc Cluet, apporte un éclairage qui renouvelle l'approche d'un fait culturel germanique connu, mais rarement présenté de façon synthétique et théorique : les séjours en villégiature, devenus au cours du XIXème siècle un rite social pour la bourgeoisie allemande, et leur importance pour l’histoire culturelle, et en particulier littéraire. C'est chose faite grâce à cet épais ouvrage qui donne la parole à des germanistes français (surtout) et à des chercheurs allemands issus de disciplines aussi variées que la géographie, la sociologie, l'histoire, l'analyse littéraire, la civilisation. Tous ont le souci d'apporter des lumières sur ce phénomène qui va de pair avec l'industrialisation des grandes nations au cours du XIXème siècle, et de l'Allemagne en particulier. Rappelons ici que l’exode rural a été plus important et plus rapide en Allemagne qu'en France pour la période étudiée. Rien d'étonnant donc à ce que le désir d'échapper à la moiteur des grandes villes et, pour certains, aux effets pervers de la civilisation industrielle, se soit traduit par un engouement pour la « Sommerfrische », terme germanique qui correspond en français à « villégiature», lui-même emprunté à l'italien. La popularité grandissante de la villégiature accompagne l'ascension de la bourgeoise cultivée qui rivalise sur ce terrain avec la bourgeoisie d'affaire (les classes laborieuses se contenteront, quant à elles, du « Schrebergarten »).
Dans un avant-propos qui fait également office de synthèse sur le sujet, Marc Cluet replace le renouveau du terme de « Sommerfrische » dans le contexte de nos sociétés contemporaines où s'est développé le tourisme de masse. Il retrace les grandes lignes du concept en insistant sur sa spécificité germanique consistant, selon lui, en l'importance accordée à la dimension sanitaire de l'entreprise (au moment où se développent tous les mouvements de « réforme de l'existence» tels le kneippisme). La villégiature à l'allemande reflète et assouplit à la fois les relations sociales de l'Allemagne de la fin du XIXème et du début du XXème siècle.Cependant, elle remplit également une fonction utopique certaine : d'une part, elle permet «d'échapper aux relations d'argent », d'autre part, elle met en scène « une économie supposée vivrière, autarcique ». Le travail d'introduction se termine par une présentation précise mais allusive de toutes les contributions au volume, ainsi clairement rattachées au sujet abordé. Elles sont regroupées en quatre parties.
La première partie, « 'Sommerfrische': une forme particulière de tourisme, ses prolongements, ses à-côtés» donne le cadre historique du sujet, elle évoque les débuts des séjours « au frais », « à la campagne », et « à la mer » qui concurrencent ou prennent le relais, pour diverses couches de la bourgeoisie, des séjours aux eaux des aristocrates. Les auteurs témoignent de la diversité d'expression de cet étouffement en ville, du désir d'échapper au carcan urbain en séjournant soit au bord de la mer, soit à la montagne. Ces transhumances estivales qui précèdent le tourisme de masse sont réservées à une élite - ou supposée telle - et les déclinaisons de la Sommerfrische induisent des nuances sociales subtiles qui marquent l'appartenance à ou l'exclusion de tel ou tel groupe social ; les lieux de villégiature reproduisent les structures sociales et les assouplissent parfois dans un cadre plus libre que celui de la vie quotidienne. Ce tour d'horizon est complété par l'analyse linguistique du terme et de son histoire. La deuxième partie aborde une problématique qui traverse 1'histoire des sociétés germaniques par le biais de la confrontation et de la ségrégation sociales dans les lieux de villégiature : « Juifs et « Sommerfrische ». La place attribuée aux juifs est vue par les yeux des intéressés eux-mêmes - c'est le cas d'une étude originale sur Kafka et le jardinage - ou bien les auteurs des contributions analysent le regard porté par d'autres écrivains sur les Juifs en villégiature. L'étude d'écrits personnels de Fontane dévoile l'antisémitisme peu étudié de cet écrivain.
La troisième partie, plus classique par son angle d'attaque, propose des analyses fouillées de l'image de la Sommerfrische chez différents auteurs de la période traitée: Stifter, Altenberg, Bertha von Suttner, Tucholsky, Storm. Marc CIuet fait une incursion dans le domaine anglophone en analysant In a German Pension de Katherine Mansfield. Toutes les contributions mettent en lumière l'ambivalence des multiples facettes de ce lieu autre que constitue la villégiature, entre idylle, utopie et fatalité. Enfin, la dernière partie rassemble des études sur « L'anti-Sommerfrische ». La contribution consacrée à Werfel souligne à quel point la Sommerfrische n'est pas émancipatrice dans Die Hoteltreppe. Les auteurs plus contemporains abordés (Franz Innerhofer, Robert Gernhardt) tournent en ridicule l'idylle parfois kitsch de la villégiature, que ce soit en Autriche ou en Toscane, avant de lui tourner délibérément le dos. Le volume s'achève par un essai de Jean-Louis Bandet, « Sommerfrische und Winterkalte, L'idylle impossible », qui insiste une dernière fois sur la permanence de ce thème dans la littérature et la culture germaniques. De par la perspective originale qu'il adopte, cet ouvrage apporte une contribution importante à l'histoire de la bourgeoisie cultivée en Allemagne, de ses pratiques et de ses usages.
- Anne-Marie PAILHÈS -
K.Hausbei, A. Lattard (éds.),
Identité(s) multiple(s), Paris,
Presses Sorbonne Nouvelle, 2008,
272 p.
A l’occasion du départ à la retraite de Gerald Stieg, professeur de littérature et civilisation allemandes et autrichiennes à l’Université de la Sorbonne-Nouvelle- Paris III, ses collègues de l’UFR d’allemand lui ont offert un recueil de mélanges qui décline, sous des aspects variés, le thème de l’identité. Identité individuelle ou collective, identités entre affirmation et procédés de défense, oppositions identitaires, autant de problématiques qui croisent les préoccupations intellectuelles et scientifiques de Gerald Stieg. Au-delà de cette thématique unificatrice, les différentes contributions vont de l’étude transversale de concepts, comme l’article d’Alain Lattard sur la sacralisation du « Beruf », à l’exploration des sujets les plus divers à différentes périodes qui vont du Moyen-âge à l’ « extrême contemporain », en passant par la « fin de siècle » et le IIIe Reich. Alors qu’Isabelle Vodoz nous livre une étude sur le demi-frère de Parzival dans le roman homonyme de Wolfram von Eschenbach, plusieurs articles sont consacrés au tournant du siècle : Cécile Leblanc s’interroge sur l’interprétation de la figure de l’impératrice Sissi par Maurice Barrès, élevée en icône de la modernité et de l’esthétique décadente, Céline Trautmann-Waller analyse les premiers travaux de recherche de l’historien de l’art autrichien Alois Riegl sur les tapis orientaux, Marc Thuret relit le dernier roman de Fontane, Der Stechlin, comme un roman résolument moderne, tant sur le plan de l’écriture que de son analyse précoce de la « mondialisation », et Gilbert Krebs présente les archives inexplorées et jusque-là inconnues des premières années de la revue Anfang.
Plusieurs articles sont consacrés au national-socialisme. Alors que Valérie Robert propose une étude des prises de position provocatrices de Karl Kraus dans le champ intellectuel de l’exil, Anne Saint-Sauveur analyse les traumatismes de l’exil et du retour de l’exil dans les œuvres autobiographiques de Lenka Reinerova à l’aide du concept de résilience. Henri Ménudier fait une lecture de l’autobiographie de Simone Veil en faisant ressortir sa portée critique sur le travail de mémoire, et Monique Travers écrit l’histoire jusqu’à aujourd’hui peu connue de l’Orchestre des Étudiants de Paris, fondé sous l’Occupation, à partir de fonds d’archives privés.
Pour la période contemporaine, on notera ensuite les articles de Gunhild Sanson sur la constitution d’un dossier de la Stasi et celui d’Elisa Goudin-Steinmann examinant l’exposition Deutschlandbilder de 1997. Catherine Fabre-Renault propose une analyse du populisme autrichien et Dieter Hentschel s’en prend aux stéréotypes franco-allemands sur la gestion du temps des managers. Si la diversité des approches et méthodologies était déjà remarquable pour les périodes précédentes, elle le devient encore davantage, plus on s’approche du présent. Deux linguistes, Anne Larrory et Irmtraud Behr, proposent des analyses d’œuvres littéraires, la première en s’intéressant à la fonction des exclamatives dans le théâtre de Thomas Bernhard, la seconde en analysant la traduction des déictiques dans les romans policiers de Wolf Haas. Avec Haas, on entre en effet dans l’ « extrême contemporain » et plusieurs articles montrent à quel point il est important que la germanistique ne perd pas de vue les évolutions les plus récentes de la société allemande. Ainsi, Kerstin Hausbei rend compte d’une nouvelle politisation du théâtre allemand qui, depuis quelques années, traite des problèmes liés à la mondialisation. Michel Kauffmann s’intéresse aux rapports de la philosophie de Peter Sloterdijk dans la conférence sur le « parc humain » avec la psychanalyse de Freud. Et Gilbert Guillard propose une analyse cinématographique du film Schultze gets the blues de Michael Schorr.
Dans l’ensemble, ce recueil traite d’un vaste éventail de sujets qui sont au cœur de la germanistique actuelle, en faisant preuve d’une interdisciplinarité résolue et d’une variété d’approches remarquable. En cela, il est le reflet de l’activité scientifique de Gerald Stieg qui n’a jamais cessé d’encourager ses étudiants et ses collègues à suivre des pistes nouvelles et inhabituelles.
- Carola HÄHNEL-MESNARD -
Contexts, The Journal of
Educational Media, Memory, and
Society, Berghahn Journals, New
York, Vol. 1, Issue 1, Spring 2009,
226 p.
Ce premier volume de la revue Contexts inaugure un partenariat prometteur entre l’éditeur universitaire américain Berghahn Journals et l’Institut Georg Eckert (GEI), centre international de recherche sur les manuels scolaires fondé à la fin des années 1950 par l’historien brunswickois. Spécialisé dans la recherche appliquée sur les médias éducatifs et possédant l’une des plus grandes bibliothèques de manuels scolaires au monde, cet institut accomplit depuis plusieurs décennies une importante œuvre de diffusion et de formation auprès des auteurs de manuels, des maisons d’édition comme des enseignants. Il se consacre de plus en plus à la réalisation de projets thématiques et d’études comparées, en collaboration avec de nombreuses organisations nationales et internationales, comme l’UNESCO et le Conseil de l’Europe. L’Institut Georg Eckert publie déjà le résultat de ses travaux de recherche et des analyses de manuels scolaires dans sa série « Studien zur internationalen Schulbuchforschung » ainsi que dans sa revue « Internationale Schulbuch-forschung/International Textbook Research ». Avec cette nouvelle publication, l’Institut élargit le spectre de ses activités de recherche comme l’exprime le titre retenu : « Contexts ». Nomen est omen : il s’agit désormais d’explorer systématiquement les différents contextes (social, culturel, institutionnel, politique, économique) qui président à l’élaboration et à la diffusion des manuels et des autres sources de transmission du savoir (multimédia, musée, centre de mémoire, film). Le lecteur appréciera en particulier l’optique comparative internationale. Le premier volume est tout à fait représentatif de la diversité à la fois thématique, méthodologique et internationale de la recherche. La revue, à paraître deux fois par an, en est à son second numéro, numéro spécial consacré à l’Europe : « Myths and Maps of Europe » sorti à l’automne 2009. On notera au passage le changement de titre de la revue, désormais identifiée par le simple acronyme : JEMMS (Journal of Educational Media, Memory, and Society).
- Hélène YÈCHE -
Les notes de lecture de Jean-Claude FRANÇOIS
München, Die große Zeit um 1900,
Kunst Leben und Kultur 1890-1920,
Dtv, N° 34540, Munich, 2009,
375 p.
Belle réussite éditoriale que cette histoire, par l'image (464reproductions) et par le texte. Elle établit, à juste titre, la capitale bavaroise comme troisième pôle de l’Allemagne des arts et lettres, au même rang que Berlin et Vienne. L’éditeur DTV avait déjà publié un fort volume sur le Berlin des années vingt (AA en avait rendu compte en 2006). Les textes sont de Rainer Metzger, le choix des images est de Christian Brandstätter.
Le miracle de la photo (alors en plein essor) nous fait remonter le temps, celui des quartiers célèbres, comme Schwabing, avec l’Odeonsplatz, ou bien le café Stefanie (nommé aussi Größenwahn). La ville que l’on apprécie encore aujourd’hui est assez moderne : Marienplatz, Nationaltheater, Hofbräuhaus semblent juste sortis de terre pour l’exposition universelle de 1908. Les grands artistes qui font la renommée de Munich en ce temps-là sont convoqués pour des photos un peu posées : les frères Mann, Wedekind, Stefan George, Karl Valentin, un grand cercle englobant le hiératique et le grotesque.
Les reproductions de tableaux (qui font courir de nos jours au Lenbachhaus) sont parfaites : Franz Marc et ses animaux fabuleux, Auguste Macke, Gabriele Münter, Jawlensky. On découvre, si on l’ignorait, que Le Cavalier bleu est de Kandinsky (1912, p. 281). Ce beau livre nous abandonne dans les remous politiques suscités par la guerre et la défaite. Hitler est au rendez-vous, perdu dans la foule. Les dirigeants de l’éphémère république des conseils sont présentés dans le dernier chapitre : Eisner, Mühsam, Landauer, Toller. Une centaine de courtes biographies réunit toute la distribution, de Karl Arnold (de l’impayable revue Simplicissimus) à Karl Wolfskehl, le poète « cosmique ».
Egon Friedell, Kulturgeschichte der
Neuzeit, Zurich, Diogenes,
collection detebe N° 23880, 2009, 1786 p.
Le grand éditeur suisse a eu la bonne idée de republier le livre-culte d’Egon Friedell, paru à la fin des années vingt, en trois volumes (1929-1931). Il fut adulé par toute une génération d’intellectuels, mais aussi présent dans un large public à Vienne. Friedell se suicida en mars 1938, pour ne pas vivre l’Anschluss. Il n’était pas nationaliste à tout crin, et le sous-titre de sa somme est « La crise de l’âme européenne de la Peste noire à la Guerre mondiale ». Son concept de Kulturgeschichte évoque le traitement synthétique des histoires : politique, militaire, littéraire, artistique, scientifique – toutes sont contemporaines. Les titres de ses grands chapitres font référence à des phénomènes européens transcendant les frontières nationales (apparition tardive de cette expression) : Renaissance und Reformation, Aufklärung und Revolution, Romantik und Liberalismus, Imperialismus und Impressionismus, etc. Le style de Friedell est celui d’un bon vulgarisateur, et l’on peut s’approcher rapidement d’un sujet grâce aux inter chapitres notés dans la marge, faire son miel au gré des préoccupations : des noms, des événements, des livres, des œuvres – en consultant le sommaire (plus de dix pages). A posséder comme une encyclopédie, sans être intimidé par la diversité – l’arbre ne cachant jamais la forêt. La postface d’Ulrich Weinzierl ramène cependant l’opus magnum aux limites de son temps.
Histoire (s) de la dernière guerre
(1939-1945 au jour le jour). Caraktère, 3120, route d’Avignon, 13090, Aix-en-Provence, 2009.
Voici une nouvelle revue dont la publication s’étendra sur plusieurs années, et qui constituera, à terme, une encyclopédie de référence sur un phénomène européen concernant encore notre présent. Conception originale : ses articles étudient la guerre du point de vue de tous les belligérants, dans leur rapport à l’Allemagne, mais pas seulement sous le seul aspect militaire. Ses collaborateurs sont tous des historiens universitaires : François Delpla (auteur de la seule biographie complète d’Adolf Hitler en langue française (Grasset, 1999), François Kersaudy (Paris I – Sorbonne), etc. Cette optique comparatiste prend en compte tous les côtés de la politique intérieure des pays en guerre pendant l’occupation et les avancées/reculs de la Wehrmacht. Le sérieux et la pertinence des contributions voisinent avec une iconographie (souvent inédite) et des repères sur les acteurs des couples bourreaux/victimes et potentats/résistants. La revue est bimestrielle, compte environ 100 p. par numéro. Le départ est donné en septembre 1939, et l’actualité est suivie avec précision. Ainsi, le n° 1 traite de la « drôle de guerre », du pacte germano-soviétique, de la campagne de Pologne et des premiers crimes de guerre. Le n° 2 évoque Mussolini, les prémices de l’univers concentrationnaire, la stratégie d’expansion soviétique.
On ne saurait trop recommander l’abonnement à cette publication, aux particuliers comme aux bibliothèques. On trouvera difficilement un équivalent, malgré la profusion d’ouvrages dédiés à cette « guerre totale ». Le prix d’achat (6,90 euros) est un atout de plus pour attirer un vaste lectorat.
Hans Magnus Enzensberger,
Hammerstein oder der Eingensinn,
Francfort, Suhrkamp, collection st N° 4095, 2009, 378 p.
Enzensberger (né en 1929) a toujours été au rendez-vous de l’histoire et de la littérature. Il nous livre, sous une forme déliée (anecdotes, interviews posthumes, rapports secrets, lettres cachées) le fruit de ses recherches sur la personnalité et l’entourage du général Kurt von Hammerstein. Destin typique de la noblesse prussienne, qui a fourni à l’armée allemande tant d’officiers de haut rang. Hammerstein était parvenu en 1932-33, au commandement suprême de la Reichswehr. Il partagea les illusions de ses semblables sur Hitler, qu’ils voulaient « dompter ». Il démissionna de son poste en 1934 (assassinat de son ami proche von Schleicher), et resta en contact avec Ruth von Mayenburg, engagée dans le KPD, informatrice du régime soviétique, grâce à ses relations « mondaines ». Deux de ses filles, Maria Theresia et Helga furent aussi engagées dans des missions de renseignement par et pour le KPD. Un livre d’aventures passionnant, avec trahisons et retournements.
Revue Text+Kritik, N° 183,
Irmgard Keun (1905-1982),
Munich, 2009, 109 p.
On a sans doute un peu oublié qu’Irmgard Keun, née à Berlin, fut une romancière célèbre en son temps, à la manière de Marieluise Fleisser comme dramaturge. Leurs vies se ressemblent. En 1932, elle connaît le succès avec Das kunstseidene Mädchen (traduit et publié dans la revue de gauche Marianne sous le titre La jeune fille en soie artificielle). Le régime nazi interdit et détruit ses œuvres. Elle prend la route de l’exil en 1936, par Ostende, et se fait éditer par les maisons des exilés, en Hollande, Albert De Lange, puis Querido. Elle partage un moment de la vie de Joseph Roth. Retour en Allemagne après la guerre, elle y retrouve Döblin et Kesten, et publie des récits réalistes et satiriques. Son roman Nach Mitternacht, de 1937, est alors adapté pour la scène et le cinéma. Elle est peu connue en France, mais a fait l’objet de nombre d’études en Allemagne, comme représentante typique de la nouvelle ironique dans le style « neusachlich » (nouvelle objectivité). Les dix études de ce numéro sont une invitation à la découverte.
Treibhaus, Jahrbuch für die
Literatur der fünfziger Jahre, n° 5 :
Das Jahr 1959 in der
deutschsprachigen Literatur,
Munich, 2009, 488 p.
Il s’agit d’une nouvelle série de la maison Text+Kritik, qui publie le plus souvent des monographies (cf. supra). Le thème est le visage d’une décennie littéraire : les années cinquante, années fondatrices, vues par une trentaine de contributeurs. Le titre de la série est inspiré de W. Koeppen. Premier groupement : les quatre auteurs sortis du rang – Böll, Celan, Johnson, Grass. Le second est plus synthétique, avec ces topoi de l’époque, Vergangenheitsbewältigung et Aufbruch, qui serviront jusqu’à nos jours. Les auteurs étudiés sont choisis en fonction de leur succès éditorial, et surtout des traces laissées. Palmarès incomplet : Ernst Bloch, Günter Eich, Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann, Peter Härtling, Carl Zuckmayer, etc. La spécificité de l’Autriche, et l’intégration du film dans la vie culturelle (Die Brücke, de Bernard Wicki) sont des éléments d’une vision globale. Un numéro qui pourra figurer dignement à côté d’histoires de la littérature estampillées comme telles.
Volker Braun, Werktage 1, 1977-1989, Arbeitsbuch, Francfort,
Suhrkamp, 2009, 994 p.
On savait que Volker Braun (né en 1939) tenait un « journal de travail » analogue à celui de Brecht, mais en moins autobiographique. Les notations sont plus nombreuses, souvent au jour le jour. Au fil des rencontres, des conversations, des projets, des mises en scène, V. Braun a connu artistes et écrivains de toutes les générations. On peut le qualifier de réformateur au sein de la RDA, jusqu’à ce que sa disparition rende caduque une telle attitude. La dernière notation est du 31.1. 1989, pour indiquer la césure dans la biographie collective de ce qu’il appelle « un vieil avenir ». V. Braun a sans doute poursuivi son journal après ce passage, mais ce livre abondant est désormais donné comme outil de référence aux historiens.
Carl Sternheim, Scènes de la vie
héroïque des bourgeois. La Culotte,
La cassette, Schippel le Bourgeois,
traduction de C. Gicquel-Bourlet,
Paris, L’Harmattan, 2009, 290 p.
Il n’existait pas de traduction complète de la trilogie de Sternheim (1878-1942). Ce qui explique que les mises en scène de son théâtre soient restées sporadiques. La situation changera peut-être en France grâce à cette traduction adaptée à la scène. On dit que le drame allemand n’a que peu d’auteurs dans le registre comique. Sternheim est pourtant un de ceux qui ont créé des situations et des personnages comiques devenus des piliers du répertoire. Dans La Culotte, le mari Masque ridiculise ses deux sous-locataires, Scarron et Mandelstam, attirés par leurs fantasmes sur la culotte de sa femme Louise, malencontreusement perdue au passage d’un défilé militaire. Les deux soupirants sont incapables d’aller au bout de leurs désirs. Par contre, le musicien d’auberge Schippel parvient à s’insinuer dans la famille bourgeoise de M. Hoquetant grâce à sa voix de ténor. Il est recruté pour combler un vide dans un quatuor, et réussit à évincer ses rivaux, impuissants révélés, en épousant Thekla, jeune sœur du digne bourgeois, qui en pinçait pourtant pour le Prince local. Cette société wilhelminienne en prend aussi pour son grade dans La Cassette, inédite en français. Le prof de Lycée Roule, que le démon de midi a conduit à épouser sa jeune belle-sœur, se fait bien sûr cocufier par un photographe se voulant artiste. Il ne trouve même pas de consolation en couchant, au sens propre, avec la cassette de tante Elsbeth, dont le contenu (des actions de l’Etat de Bavière) est légué… à l’Eglise.
Ces fables ne disent pas que le principal intérêt du théâtre de Sternheim réside dans son langage : aux antipodes de la profusion naturaliste et du pathos expressionniste, c’est une langue sèche, elliptique, avec parfois du « jargon de la culture », qui fait sont effet comique dans la bonne traduction de C. Gicquel-Bourlet. Il faut les lire (et surtout les jouer) sous cet aspect, comme celles d’un précurseur de Horváth.