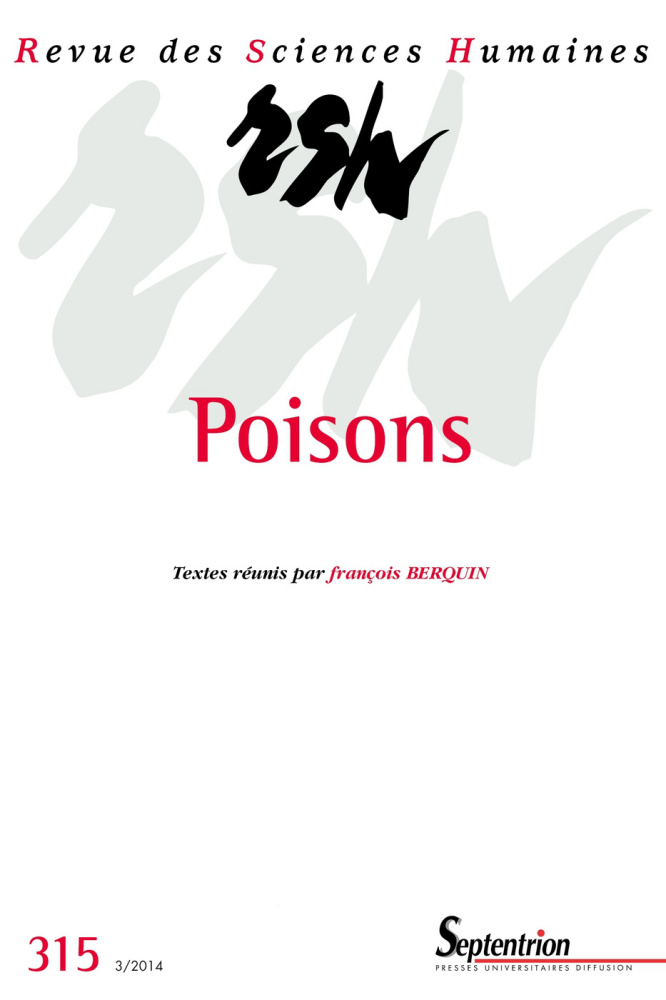Revue des Sciences Humaines, n°315/juillet - septembre 2014
Poisons
First Edition
Ce numéro de la Revue des Sciences Humaines est consacré aux poisons dans la littérature. On a pour l'essentiel privilégié la littérature française du XIXe et du XXe siècle. Plusieurs études du numéro donnent à penser que, depuis que le « crime de poison » se fait plus rare sur la scène politique, la littérature a hérité de l’ancienne... Read More
Ce numéro de la Revue des Sciences Humaines est consacré aux poisons dans la littérature. On a pour l'essentiel privilégié la littérature française du XIXe et du XXe siècle. Plusieurs études du numéro donnent à penser que, depuis que le « crime de poison » se fait plus rare sur la scène politique, la littérature a hérité de l’ancienne « science des vénéfices ». On songe ici à toutes ces œuvres qui respirent une odeur vénéneuse, des œuvres qui visent même parfois, semble-t-il, à assassiner leur lecteur… D’autres études toutefois, se plaçant sous le signe de Mithridate, montrent comment certains écrivains explorent les domaines du Mal dans le souci d’inventer à mesure une sorte de contrepoison.
Le même mot grec de pharmakos désignait à la fois le poison et le remède. C’est au fond cette ambivalence du poison (« seule la dose fait le poison », selon Paracelse) qui fait l’unité paradoxale de ce recueil.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Revue des Sciences Humaines
- Title Part
-
Numéro 315
- Edited by
- François Berquin,
- Journal
- Revue des Sciences Humaines | n° 315
- ISSN
- 00352195
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts > Literature
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts
- Title First Published
- 18 September 2014
Paperback
- Publication Date
- 18 September 2014
- ISBN-13
- 978-2-913761-62-9
- Extent
- Main content page count : 224
- Code
- 1470
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 399 grams
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3