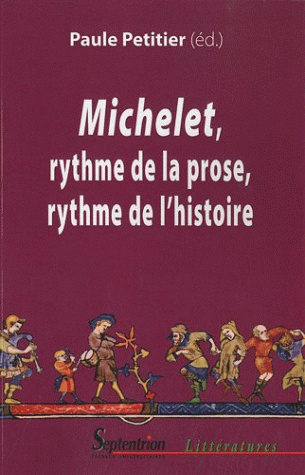Michelet, rythme de la prose, rythme de l'histoire
First Edition
Ce livre analyse le rôle du rythme dans l'écriture d'un grand historien, Jules Michelet. Le rythme est envisagé à la fois comme un procédé stylistique et comme un instrument permettant de penser les scansions de l’évolution historique. Read More
Il n'est guère d'historien avant Fernand Braudel pour qui la perception des différentes allures du temps ait eu plus d’importance que Michelet. Siècles du Moyen Âge qui s’étirent interminablement, pas vif de la Régence, boitement du XIXe siècle… Michelet mesure à travers ces variations non seulement la marche du progrès mais le rapport des hommes de chaque époque à l’histoire qu’ils vivent, selon qu’elle leur pèse, les écrase ou les porte. Le rythme, réalité essentiellement organique chez Michelet, dit que l’histoire n’est jamais désincarnée. Ce volume explore à la fois le rythme comme objet historique (la façon dont Michelet commente et interprète certains phénomènes rythmiques) et comme instrument intellectuel de l’historien, dont le travail repose sur le repérage de scansions, de cycles, de surgissements perturbateurs créant de nouvelles régularités… Des œuvres telles que La Mer figurent le rapport contradictoire que l’histoire de Michelet entretient avec les rythmes naturels. Mais est-il possible de parler d’une poétique de l’histoire liée au rythme sans aller voir dans l’atelier même de l’écrivain comment la prose concerte ses effets rythmiques ? C’est pourquoi le volume a souhaité accorder une large place aux études où la stylistique s’ouvre vers la production du sens de l’histoire.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Edited by
- Paule Petitier,
- With
- Arnaud Bernadet, Göran Blix, Eric Bordas, Ludmila Charles-Wurtz, Guillaume Délias, Aude Déruelle, Maria-Juliana Gambogi-Texeira, Muriel Louâpre, Eric Pellet, Claude Rétat, Myriam Roman, Sayaka Sakamoto, Judith Wulf, Gisèle Séginger,
- Collection
- Littératures
- ISSN
- 19658508
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts > Literature
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts
- Audience
- Étudiants en lettres et en histoire (L3, Master, doctorat)
- Title First Published
- 01 February 2010
- Includes
- Index, Bibliography
Paperback
- Publication Date
- 01 February 2010
- ISBN-13
- 9782757401408
- Extent
- Main content page count : 226
- Code
- 1205
- Dimensions
- 16 x 24 x 1.3 cm
- Weight
- 370 grams
- List Price
- 19.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3