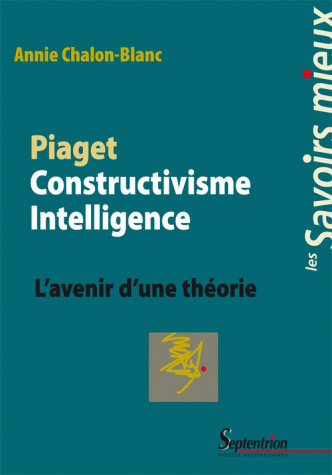Piaget Constructivisme Intelligence
L'avenir d'une théorie
First Edition
Après Introduction à Jean Piaget (1997) qui permettait de se familiariser avec les principaux concepts piagétiens et Inventer, compter et classer (2005) qui éclairait deux grands ouvrages piagétiens : La genèse du nombre et... Read More
Après Introduction à Jean Piaget (1997) qui permettait de se familiariser avec les principaux concepts piagétiens et Inventer, compter et classer (2005) qui éclairait deux grands ouvrages piagétiens : La genèse du nombre et La genèse des structures logiques élémentaires, Annie Chalon-Blanc propose avec Piaget – Constructivisme-Intelligence –un troisième manuel qui est un pari sur l'avenir de la théorie de Jean Piaget. Deux thèmes sont susceptibles, selon elle, de passer à la postérité : le constructivisme ou comment se construit progressivement un réel intelligible et la réversibilité des actes et/ou de la pensée, source de l'intelligence. Le constructivisme, car il apporte une réponse claire et originale à la question des rôles respectifs du sujet et des objets dans l'élaboration des connaissances ; la réversibilité, parce que cette capacité qu’a le sujet de se saisir des actions disparues des données perceptives et de les composer entre elles pour déduire un élément commun en dépit de leurs disparités reste une conception révolutionnaire de l’intelligence. Des textes brefs peu célèbres mais explicites de Jean Piaget viennent enrichir les deux thèmes retenus.
L’auteur laisse délibérément de côté, ou presque, quelques notions classiques : les stades, le sujet épistémique, la filiation des structures, et autres, qui ont fait couler beaucoup d’encre au siècle dernier.
L’originalité de Jean Piaget est le propos essentiel de ce manuel destiné en priorité aux étudiants en psychologie, en sciences de l’éducation et aux futurs professeurs d’école, mais aussi à tous les professeurs et éducateurs spécialisés, qui trouveront dans le rapport des expériences simples et élégantes menées à Genève, des explications possibles des retards cognitifs auxquels ils sont confrontés, et des pistes de travail de rééducation.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Title Part
-
Numéro 30
- Author
- Annie Chalon-Blanc,
- Collection
- Savoirs mieux | n° 30
- ISSN
- 12924385
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Acquisition and transmission of knowledge
- Audience
- L'originalité de Jean Piaget est le propos essentiel de ce manuel destiné en priorité aux étudiants en psychologie, en sciences de l'éducation et aux futurs professeurs d'école, mais aussi à tous les professeurs et éducateurs spécialisés qui trouveront, dans le détail des expériences simples et élégantes menées à Genève, des explications possibles des retards cognitifs auxquels ils sont confrontés et des pistes éventuelles de travail de rééducation.
- Title First Published
- 01 September 2011
Paperback
- Publication Date
- 01 September 2011
- ISBN-13
- 9782757403341
- Extent
- Main content page count : 220
- Code
- 1290
- Dimensions
- 14 x 20 cm
- Weight
- 270 grams
- List Price
- 15.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3