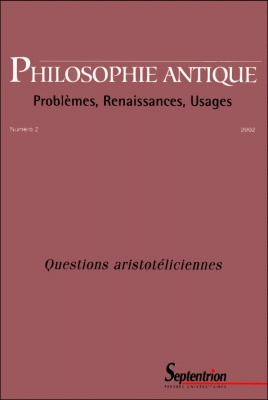Philosophie Antique n°2 - Questions aristotéliciennes
First Edition
Questions aristotéliciennes : de la Métaphysique au traité De l'Âme, en passant par le traité de la mémoire et de la réminiscence et la Physique, le numéro 2 de Philosophie antique propose une traversée du corpus aristotélicien, qui se prolonge dans... Read More
Questions aristotéliciennes : de la Métaphysique au traité De l'Âme, en passant par le traité de la mémoire et de la réminiscence et la Physique, le numéro 2 de Philosophie antique propose une traversée du corpus aristotélicien, qui se prolonge dans une étude critique de la légende selon laquelle Alexandre d'Aphrodise, le premier grand commentateur d’Aristote, s’en serait pris au médecin et philosophe Galien (IIe s.).
Trois contributions sur l’Antiquité tardive complètent ce numéro : la mise en évidence, chez le médecin Galien et le pseudo-Plutarque, d’une doctrine du « véhicule de l’âme » mène à conclure que cette doctrine, non seulement est bien antérieure à Jamblique, qu’on en croyait l’inventeur, mais n’est même pas propre au néoplatonisme. Proprement néoplatonicienne, en revanche, est l’étude sur l’interprétation du Philèbe de Platon par Damascius, le dernier chef d’école néoplatonicien (Ve-VIe siècle).
Ce numéro comporte enfin une étude pionnière sur l’Anthologie de Jean Stobée (Ve siècle). Composé d’extraits des philosophes grecs rangés par thèmes, ce florilège est un précieux document sur un certain nombre d’œuvres perdues par ailleurs dont seuls ont survécu les fragments qu’il en conserve. Est posé ici pour la première fois le problème, non de sa valeur documentaire, mais de l’intention qui a présidé à sa composition et du public auquel il était destiné, bref, de sa nature littéraire propre.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Philosophie antique
- Title Part
-
Numéro 2
- Edited by
- André Laks, Michel Narcy,
- Journal
- Philosophie antique | n° 2
- ISSN
- 16344561
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Knowledge and systems of thought > Philosophy, hermeneutics, philology
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Knowledge and systems of thought
- Title First Published
- 2002
- Type of Work
- Journal Issue
Paperback
- Publication Date
- 2002
- ISBN-13
- 9782859397708
- Code
- 815
- Dimensions
- 21 x x 2 cm
- Weight
- 433 grams
- List Price
- 20.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
L'ontologie aristotélicienne comme ontologie axiologique : proposition de lecture de la Métaphysique
Gwenaëlle Aubry
Perception du temps et mémoire dans Aristote (De memoria et reminiscentia, 1)
Daniela Taormina
Grandeur infinie en puissance et grandeur infinie en acte (Aristote, Physique, III)
Edmond Mazet
Le caractère musical de la voix chez Aristote : apotasis, melos, dialektos
Jean-Louis Labarrière
Alexandre contre Galien : la naissance d'une légende
Silvia Fazzo
Le véhicule de l'âme chez Galien et le Pseudo-Plutarque
Stéphane Toulouse
Encyclopédisme et enkyklios paideia. À propos de Jean Stobée et de son Anthologion
Rosa Maria Piccione
« N'essayons pas de compter l'intelligible sur les doigts ». Damascius et les principes de la limite et de l'illimité
Gerd Van Riel
Comptes rendus
Bulletin bibliographique
Excerpt
L'ontologie aristotélicienne comme ontologie axiologique. Proposition de lecture de la Métaphysique
On propose ici une lecture de la Métaphysique inspirée de E, 2, 1026a33-b2, prenant la dunamis et l'energeia comme principal sens de l'être. Le couple conceptuel de l'en-puissance et de l'acte fournit ainsi à la fois le principe d'une réponse possible à la question disputée de la « science recherchée », et le fondement d'une ontologie singulière, que l'on caractérise comme une ontologie axiologique. On commence par analyser la signification de ces notions telle qu'elle se déploie en Métaphysique D et Q : au terme de cette analyse, l'acte apparaît comme nommant l'identité réelle, ou réalisée, de l'être et du bien, et l'en-puissance, cette identité comme à réaliser. On montre ensuite, en suivant Z et H, comment le couple de la dunamis et de l'energeia, et non celui de la matière et de la forme, est au principe de la substance sensible, puis, à partir de L (en particulier L, 5, 1071a3-6), comment la dunamis et l'energeia valent, par-delà les substances sensibles, comme les principes communs à toutes les substances, sous la modalité spécifique de l'analogie. Le couple de l'en-puissance et de l'acte assure ainsi à la fois la généralité du discours ousiologique, et le primat réel du principe théologique (qu'Aristote désigne toujours comme acte, et jamais comme forme). On montre enfin comment dunamis et energeia fondent non seulement une ousiologie unitaire, mais aussi une ontologie générale, en ce qu'elles s'appliquent, sous certaines conditions, aux êtres mathématiques. On s'interroge, pour finir, sur la signification de l'inversion, par Plotin, de la dunamis aristotélicienne, et de la désignation du Premier Principe non plus comme acte pur, mais comme « puissance de tout (dunamis pantôn) ». En ce geste plotinien, on reconnaît l'origine d'un mouvement d'identification du divin non plus au bien, comme le faisait Aristote à travers la notion d'acte pur, mais à la puissance - à une puissance qui, ultimement, pourra être pensée comme excédentaire au bien. Comme la théologie de l'acte pur, cette ontologie axiologique de l'en-puissance et de l'acte est victime d'un oubli dont, en conclusion, est brièvement esquissée l'histoire.
Perception du temps et mémoire chez Aristote (De memoria et reminiscentia 1)
La perception du temps et la mémoire sont présentés dans leur spécificité et dans leur rapport réciproque. Après avoir rejeté deux interprétations, celle selon laquelle la perception du temps est différente chez l'homme et chez les autres animaux, et celle selon laquelle le temps est perçu par la sensation commune, est proposée l'hypothèse de lecture suivante: la perception du temps présuppose des sujets sentants et doués d'imagination. Cela permet de reconstituer, dans un cadre unitaire, la différence et en même temps la coopération entre les facultés de la partie sensitive de l'âme et de montrer que la mémoire, qui présuppose la perception du temps, conserve de façon stable les images. En ce sens elle ordonne les données provenant de la sensation via l'imagination, selon une disposition chronologique, disposition sans laquelle ces données seraient illisibles, voire inutiles et inutilisables.
Grandeur infinie en puissance et grandeur infinie en acte (Aristote, Physique, III)
Dans un passage de Physique III (7, 207 b 15-21), Aristote s'exprime d'une manière qui suppose que l'implication suivante est valide : « Si une grandeur peut être infinie en puissance, une telle grandeur peut aussi être infinie en acte ». Cette implication a intrigué les commentateurs tant anciens et médiévaux que modernes. Ces derniers se sont en général bornés à constater que l'implication n'est pas logiquement valide, sans expliquer comment et en quel sens Aristote avait pu la tenir pour telle. En rapprochant le passage précité d'un autre passage de Physique III (6, 206 b 16-27), le présent article en propose une interprétation qui semble lever toutes les difficultés. Au Moyen Age le sens de l'implication a été très discuté, et l'interprétation proposée ici a été vue et soutenue par plusieurs commentateurs : on l'étudie chez quelques-uns de ceux-ci en situant leur position dans le cadre du débat médiéval sur la question, notamment en référence aux deux interprétations alors fameuses proposées par Averroès.
Le caractère musical de la voix chez Aristote : apotasis, melos, dialektos
Dans le traité De l'âme, II, 8, 450 b 5-9, Aristote pose que la voix (phônê) possède apotasis, melos et dialektos. L'analyse des significations possibles de ces trois termes dans le vocabulaire musical conduit à soutenir qu'il y a progression de l'un à l'autre et qu'ils forment système. Apotasis désigne la tessiture ou registre, melos la séquence mélodique et articulée et dialektos la manière propre d'articuler, l'accent ou prononciation, ce qu'en éthologie on appelle le « dialecte ». La dialektos des oiseaux chanteurs permet de confirmer cette analyse.
Alexandre contre Galien : la naissance d'une légende
Un certain nombre de sources arabes font état d'une polémique entre Alexandre et Galien. Une tendance marquée de la recherche a été de lire nos sources grecques, relativement peu nombreuses, à la lumière de cette tradition. L'objectif de cet article est de contester le bien-fondé d'une telle orientation, et de dégager en même temps le statut spécifique de ce genre de récit biographique.
Le véhicule de l'âme chez Galien et le Pseudo-Plutarque
La notion d'un corps intermédiaire, connu sous le nom de véhicule de l'âme dans le néoplatonisme, est destinée à expliquer l'union de l'âme et du corps, mais aussi l'articulation du rationnel et de l'irrationnel, les communications avec le divin, et le maintien d'une forme de vie post mortem. Cette étude montre comment les premières attestations d'un usage structuré de la notion, sous la forme « le pneuma est le (premier) véhicule de l'âme », apparaissent dans deux contextes différents, fort éloignés l'un de l'autre : une discussion de physiologie sur le pneuma optique, chez Galien ; et une explicitation philosophique de l'eschatologie d'Homère, dans le De Homero du Pseudo-Plutarque. Ce sont cependant les témoins les plus clairs d'une doctrine qui est encore en gestation dans le platonisme impérial. L'analyse montre en particulier ce que le médecin doit au Timée de Platon, ce que l'allégoriste doit à la théorie médicale des exhalaisons du sang, quand ils formulent cette nouvelle hypothèse commune sur la nature du pneuma, appuyée sur Platon et Aristote, et manifestement présentée comme une alternative à la doctrine stoïcienne de l'âme-pneuma.
Encyclopédisme et enkyklios paideia. À propos de Jean Stobée et de son Anthologion
En me fondant sur le témoignage de Photius sur l'Anthologion de Jean Stobée (Bibl., cod. 167), et en considérant d'abord l'architecture de l'ouvrage et les aspects techniques de la composition, je me propose d'évaluer la possibilité d'une nouvelle lecture, selon laquelle le florilège de Stobée n'aurait pas été destiné à une instruction scolaire générale ni adressé à un destinataire unique, son propre fils Septimius, mais, tout en relevant indéniablement de la littérature didactique, aurait eu en quelque sorte un caractère propédeutique, en présentant à l'utilisateur l'inventaire général du monde, ordonné logiquement, et en utilisant une tradition gnomologico-doxographique antérieure, avec un dessein culturel nouveau.
« N'essayons pas de compter l'intelligible sur les doigts ». Damascius et les principes de la limite et de l'illimité
Cet article examine la façon dont Damascius, le dernier diadoque de l'académie platonicienne à Athènes, intègre les principes ontologiques du Philèbe dans son système. À l'opposé de ses prédécesseurs, Damascius refuse d'accepter une opposition des principes de la limite et de l'illimitation immédiatement en dessous de l'Un (principe de la cause), car une telle opposition briserait l'unité de l'Un. Après une présentation de la doctrine des premiers principes selon Damascius, l'auteur discute la critique de ce dernier vis-à-vis ses précurseurs, avant de se tourner vers la question complémentaire: étant donné que Damascius n'accepte pas la solution offerte par la tradition, quel rôle attribue-t-il lui-même aux principes tirés du Philèbe ?