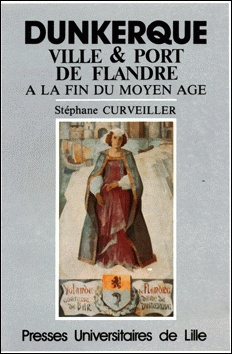Dunkerque Ville & port de Flandre à la fin du Moyen Âge
A travers les comptes de baillage de 1358 à 1407
First Edition
Réflexion approfondie et essai d'histoire quantitative, l'histoire de Dunkerque au XIVe siècle dévoile l'évolution d'un centre jugé trop longtemps anodin. La bourgade initiale dont l'entité urbaine est reconnue dès la fin du XIIe siècle se... Read More
Réflexion approfondie et essai d'histoire quantitative, l'histoire de Dunkerque au XIVe siècle dévoile l'évolution d'un centre jugé trop longtemps anodin. La bourgade initiale dont l'entité urbaine est reconnue dès la fin du XIIe siècle se dote d'institutions au début du siècle suivant; ignorée des grands courants commercaiux en raison de sa non-appartenance à la Hanse, elle ne connaît de réelle expansion que vers 1375. En effet, la ruine progressive de cette ligue de marchands, les difficultés rencontrées par des centres rivaux comme Gravelines et enfin, l'arrivée sur les marchés d'étrangers des Pays-Bas conduisent la cité à se hisser à un niveau très respectable lui permttant de s'imposer de plus en plus à Bergues. Par ailleurs, la ville s'apprête à devenir une place forte du littoral face à l'occupation anglaise de Calais. L'épanouissement économique et commercial de la cité au sein d'une vie quotidienne agrémentée de faits piquants amène peu à peu Dunkerque à jouer un rôle régional, consécration de son développment et de son affirmation au coeur de la Flandre maritime.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Author
- Stéphane Curveiller,
- Collection
- Économies et sociétés
- Language
- French
- Tags
- Middle Ages, North of France
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Time, space and society > Medieval History
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Time, space and society
- Title First Published
- 1989
Paperback
- Publication Date
- 1989
- ISBN-13
- 9782859393618
- Extent
- Main content page count : 376
- Code
- 338
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 867 grams
- List Price
- 9.14 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3