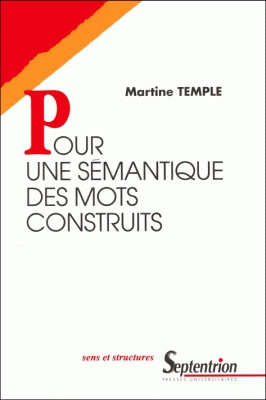Pour une sémantique des mots construits
First Edition
Malgré l'intérêt considérable que suscite aujourd'hui la sémantique lexicale, la particularité du sens des mots qui, comme chaton, redire ou vitreux, ont une structure construite, demeure ignorée dans la littérature linguistique.
L'ouvrage tente de combler cette lacune en faisant apparaître que des propositions de traitements adéquats du sens des mots construits font nettement défaut d'une part, en proposant d'autre part des moyens théoriques pour parvenir à une représentation sémantique adéquate de ce type de mots.
L'ouvrage tente de combler cette lacune en faisant apparaître que des propositions de traitements adéquats du sens des mots construits font nettement défaut d'une part, en proposant d'autre part des moyens théoriques pour parvenir à une représentation sémantique adéquate de ce type de mots.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Author
- Martine Temple,
- Collection
- Sens et Structures
- ISSN
- 12487732
- Language
- French
- Tags
- Economic history, North of France
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Acquisition and transmission of knowledge > Linguistics, lexicography, translation studies
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Acquisition and transmission of knowledge
- Title First Published
- 1996
Paperback
- Publication Date
- 1983
- ISBN-13
- 9782859392185
- Extent
- Main content page count : 192
- Code
- 196
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 341 grams
- List Price
- 6.10 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3