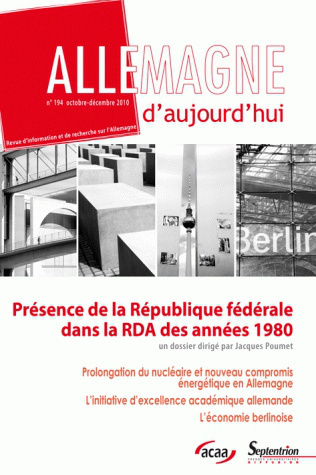Allemagne d'aujourd'hui, n°194/octobre - décembre 2010
Formes de la présence de la RFA en RDA dans les années 80
First Edition
Les contributions de ce dossier montrent que la politique officielle de démarcation menée par la RDA n'a pas empêché les interactions dans des domaines essentiels : politique étrangère et politique intérieure, stratégie économique et mesures à... Read More
Les contributions de ce dossier montrent que la polilitique officielle de démarcation menée par la RDA n'a pas empêché les intercations dans des domaines essentiels : politique étrangère et politique intérieure, stratégie économique et mesures à caractère social, idéologie et propagande, mouvements artistiques et littéraires. Dans ce dernier secteur, les phénomènes d'érosion des années 1980 permettent certaines formes de communication interallemande alors que l'idée même de nation culturelle allemande reste un sujet tabou en RDA.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui
- Title Part
-
Numéro 194
- Journal
- Allemagne d'aujourd'hui | n° 194
- ISSN
- 00025712
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations > Germanic and Scandinavian countries
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations
- Title First Published
- 01 December 2010
Paperback
- Publication Date
- 10 May 2011
- ISBN-13
- 9782757401460
- Extent
- Main content page count : 218
- Code
- 1215
- Dimensions
- 14 x 20 cm
- Weight
- 262 grams
- List Price
- 14.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
J. Vaillant – Une embellie pour l'Allemagne, une embellie
pour l'Europe ? De l'engagement européen de l’Allemagne,
20 ans après son unification
J.-J. Alcandre – Prolongation du nucléaire et nouveau
compromis énergétique en Allemagne
S. Neubert – En route vers l’excellence académique ?
L’exemple de l’initiative d’excellence allemande
H. Brodersen – L’économie berlinoise : comment dépasser
les ruptures imposées par l’histoire ?
L’actualité sociale par B. Lestrade
S. Hazouard – Les systèmes allemand et français
de relations sociales face à la dérégulation européenne
des services d’intérêt général
Comptes rendus par A.-M. Corbin
Dossier
Présence de la République fédérale
dans la RDA des années 1980
Dossier dirigé par Jacques Poumet,
publié avec le soutien du centre de recherche
Langues et Cultures Européennes de l’Université Lyon 2,
la participation de l’École normale supérieure de Lyon,
et le concours de la Région Rhône-Alpes
et du Département du Rhône
H. Miard-Delacroix – Le Mur comme matérialisation
de la démarcation dans l’Allemagne divisée
U. Pfeil – Les relations interallemandes dans le contexte
international des années quatre-vingt
H. Miard-Delacroix – Les mouvements pour la paix
en République fédérale et en RDA dans les années 1980
– entremêlés, distincts, différents
A. Steiner – La politique économique et sociale des années
1980 en RDA face au défi ouest-allemand ?
M. Gibas – La propagande contre la République fédérale
et ses effets dans la RDA des années 1980
M. Rauhut – Éléments de l’Ouest, construction de l’Est.
Transformation politique des styles de cultures
de jeunes en RDA
J. Poumet – Les arts plastiques de RDA et la rivalité
Est-Ouest
A. Lemonnier-Lemieux – La littérature est-allemande
dans le sillage de l’affaire Biermann
E. Dubslaff – Une social-démocratie originale en Allemagne
de l’Est ? Entre dynamique révolutionnaire intérieure à la RDA
et influences sociales-démocrates ouest-allemandes
Excerpt
Une embellie pour l'Allemagne, une embellie pour l'Europe ? De l'engagement européen de l'Allemagne, 20 ans après son unification
Résumé
L'Allemagne face à la crise
Depuis la crise financière et plus encore depuis la crise de l'euro sur fond de crise grecque, l'Allemagne a, en France, la réputation d'avoir négligé ses solidarités européennes au nom de ses intérêts propres et plus encore sans doute au nom de son manque de pragmatisme dans le souci doctrinaire de laisser au marché le soin de régler lui-même les crises.
Tandis que la France s'engage dès décembre 2008 dans un programme de relance conjoncturelle plutôt ambitieux, mobilisant 26 milliards d'euros, soit 1,3 % du PIB français, prévoyant une prime à la casse automobile de 1 000 € et une aide au bâtiment comme aux grands travaux 1, le programme de relance conjoncturelle de novembre de la même année en Allemagne passe pour être frileux et pas à la hauteur de la situation. Il prévoit pourtant déjà des aides publiques de l'ordre de 32 milliards d'euros étalées sur les années 2009 et 2010.
Il faut attendre le second programme de relance conjoncturelle de janvier 2009 pour que l'Allemagne donne à ses partenaires le sentiment de les suivre sur la même voie en matière de politique économique. Cette deuxième vague de mesures ne représente pas rien : prime à la casse automobile de 2 500 €, 14 milliards de plus de dépenses publiques, augmentation de 100 milliards d'euros du volume des crédits garantis par l'Etat, etc. Si l'on se réfère aux calculs faits par le FMI, la relance n'est que de 0,1% du PIB en 2008, mais de 1,6% en 2009 et de 0,9% en 2010. L'Allemagne ne répond à l'attente du FMI qu'en 2009, celui-ci fixant à 1,5-2% du PIB l'effort à consentir par les Etats 2.
Les hésitations du gouvernement de grande coalition dirigée par la chancelière a nourri le soupçon. C'est seulement sous l'influence de son ministre social-démocrate des Finances, Peer Steinbrück, qu'A. Merkel accepte de pratiquer une politique keynésienne anticyclique. Ses conseillers au sein de son propre parti, l'Union chrétienne-démocrate, continuent de miser sur les forces du marché et répugnent aux programmes de relance quand ils estiment qu'il vaudrait mieux se contenter de baisser les impôts. Cela tient aussi au fait que la France apparaît alors à l'Allemagne beaucoup trop fébrile et prête à se lancer dans un activisme jugé de mauvais aloi et qu'elle redoute, comme pays le plus riche, d'être obligée de faire le plus gros effort de tous: son dogmatisme économique ne permet pas alors à l'Allemagne de prendre toute la mesure de la crise.
Crise de la dette souveraine grecque : A. Merkel donne l'impression de traîner les pieds
C'est un schéma assez semblable que l'on retrouve dans les réactions allemandes à la crise de l'euro provoquée par la crise grecque. A ceci prêt que le parti de la chancelière est engagé dans un bras de fer électoral dans le Land de Rhénanie du Nord - Westphalie (9 mai 2010) avec son ancien partenaire social-démocrate de la Grande coalition alors que l'opinion publique allemande est globalement défavorable à toute aide à la Grèce. La chancelière donne l'impression de faire passer des élections régionales avant l'avenir de l'Europe. Un souci en soi compréhensible, vu la taille et le poids politique de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie, le pays de la Ruhr, un Land de 18 millions d'habitants, sans commune mesure avec une région française. Mais l'impression est fatale auprès des partenaires européens même si dans chacune de ses déclarations la chancelière laisse entendre à qui veut bien l'écouter qu'au bout du compte l'Allemagne fera, le moment venu, ce qu'il est de son devoir de faire pour sauver l'euro. On tient également pour preuve de l'égoïsme allemand la politique économique et les succès commerciaux de l'Allemagne. En mars 2010, la ministre française de l'Economie, Christine Lagarde, suivie en cela par l'essentiel des médias en France, reproche à l'Allemagne de pratiquer une politique qui mise essentiellement sur les exportations, privilégie les entreprises et, en négligeant les salaires, empêche la reprise de la consommation intérieure qui serait profitable à la croissance en Europe3.
Finalement, l'Allemagne n'a pas pu attendre l'issue des élections en Rhénanie-du Nord - Westphalie pour réagir à la crise l'euro, elle a dû se rendre à la double raison qu'il y avait pour elle d'empêcher son aggravation alors qu'elle est un des principaux bénéficiaires de l'euro et de répondre aux attentes de ses partenaires de la zone euro. Mais il est vrai aussi qu'au-delà de ses préoccupations électoralistes, la chancelière voulait respecter les règles interdisant à la Banque centrale européenne d'acheter des certificats défectueux pour ne pas compromettre son sacrosaint statut d'indépendance. Elle redoutait aussi d'alourdir inconsidérément la dette du pays. Elle devait encore compter avec son partenaire libéral, le FDP, pour lequel la suppression des subventions et la baisse des impôts ne sont pas seulement des instruments de politique économique mais une véritable question d'identité.
Cette tension entre les deux partis gouvernementaux se retrouve dans le contrat de coalition conclu le 26 octobre 2009. Les premiers ont veillé à ce que la baisse des impôts voulue par les seconds ne se fasse que sous la réserve de sa faisabilité. L'autorité de la chancelière pâtissait des ratés d'un gouvernement qui cherchait encore sa ligne et son style. La crise grecque est, dans ce contexte, apparue à la chancelière comme une bonne occasion de rétablir son autorité en faisant preuve de fermeté, au moins jusqu'à la date fatidique des élections en Rhénanie-du Nord - Westphalie. On peut encore ajouter qu'Angela Merkel n'a pas trouvé au sein de la coalition chrétienne-libérale les compétences en politique monétaire qu'elle avait au sein de la Grande coalition, ne serait-ce qu'en la personne de son ministre des Finances. Au bout du compte, il lui a bien fallu entendre raison et souscrire début mai 2010 au plan de sauvetage de l'Euro qui sollicite le budget de l'Union européenne à concurrence de 60 milliards d'euros et les principaux pays de la zone euro pour un montant de 440 milliards, dont 123 pour la seule Allemagne. La part prééminente de l'Allemagne qui certes ne fait qu'être proportionnelle à sa force économique et monétaire explique que c'est un Allemand, Klaus Regling, qui a été nommé, à Luxembourg, à la tête de l'organisme européen de stabilisation des marchés financiers. Sans doute est-ce le souci de l'Allemagne de partager la note qui l'a conduite à imposer à ses partenaires, qui n'en voulaient pas, que le FMI participe à concurrence de 250 milliards d'euro à l'opération. Autrement, l'apport allemand aurait sans doute facilement été doublé, même s'il ne s'agit pour l'instant que d'argent virtuel, sous forme de garanties.
L'Allemagne est-elle devenue moins européenne ? Ne se comporte-t-elle pas plutôt comme elle s'est toujours comportée depuis 20 ou 30 ans quand il s'agit de payer ? Même si c'est globalement à son avantage sur le plan commercial et économique, l'Allemagne a toujours eu tendance à adopter une attitude défensive dont le chancelier G. Schröder a donné le meilleur exemple quand il s'est agi de prévoir le budget de l'Union européenne sur le long terme. Cela fait bien longtemps que l'Allemagne ne souhaite plus être le payeur dans un simple souci d'apaisement. Le vrai problème, c'est que l'Allemagne n'a pas été à l'initiative des grandes mesures prises pour réagir aux crises, il a fallu la prier, la convaincre là où elle aurait dû prendre la tête du mouvement et cela est bien à mettre au compte des déficits imputables à la chancelière. Mais qu'en est-il maintenant que la croissance allemande retrouve, du moins pour un temps, son rôle de locomotive en Europe ?
L'Allemagne à nouveau locomotive de la croissance en Europe ?
La croissance allemande a été au deuxième trimestre 2010 de +2,2% par rapport au trimestre précédent. En comparaison, la France s'est contentée d'une croissance de +0,6%, ce qui est peu par rapport à l'Allemagne mais tout à fait honorable dans l'ensemble de l'Union européenne et semblable à la croissance enregistrée pour la même période par les Etats-Unis. La croissance allemande est tirée par les exportations qui ont augmenté plus vite que les importations, dans le contexte favorable de la reprise mondiale. On relève en Allemagne que la croissance du pays a permis à la France d'augmenter ses exportations vers l'Allemagne d'environ 6 % et à l'Espagne jusqu'à 12% 4. Tout serait-il rentré dans l'ordre puisque l'Allemagne aiderait à nouveau ses voisins ? Le retour à la croissance relativise assurément bien des jugements passés, plutôt péremptoires. Encore faut-il voir comment, en matière de croissance, l'Allemagne s'est comportée sur la longue durée et vérifier si le retour à la croissance observé en 2010 est durable et le signe d'un réajustement de la politique allemande.
Globalement, sur les dix dernières années, les résultats de l'économie allemande restent mitigés. Selon la Banque centrale européenne (BCE), les exportations allemandes ont certes crû plus vite que dans l'ensemble de la zone euro (+7,3 contre +5,5%), mais sa croissance (1,5%) est restée en deçà de celle de la zone euro (+2,2%), l'évolution de l'emploi (+0,1%) est resté inférieur à celle de la zone euro (+1,3%), tout comme les investissements (+1 ,3% contre +2,4%). Ces chiffres rappellent deux choses : pour retrouver sa compétitivité alors qu'elle était un pays de haut salaire jusque dans les années 1980/90, l'Allemagne a effectivement pratiqué une politique de réduction réelle des salaires. Ceux-ci n'ont augmenté nominalement sur les dix dernières années que de 21,8% contre 29,5% dans la zone euro et 35,5% dans l'ensemble de l'Union européenne, mais cette augmentation représente une diminution du salaire réel de -0,8%. A titre de comparaison, les salaires réels ont augmenté en France pour la même période de 9,6% 5. Cette politique de reconstitution de la compétitivité allemande a concerné les salaires mais elle a également grevé les investissements. Cet état de fait induit un besoin de rattrapage des salaires, affirmé haut et fort début septembre 2010 par les syndicats allemands, un point de vue soutenu par la ministre fédérale du Travail, Ursula van der Leyen, sans que celle-ci défende pour autant le montant des augmentations salariales revendiquées par ceux-ci. Les partenaires de l'Allemagne n'en seront que plus heureux puisque ainsi l'Allemagne va satisfaire à leur demande de stimuler davantage sa demande intérieure par l'augmentation des salaires.
Si l'Allemagne a bien délibérément pratiqué une politique de bas salaires et d'investissements réduits pour rester compétitive sur un marché toujours plus mondialisé, un des objectifs affichés par le chancelier Schröder dans le cadre de l'Agenda 2010 de la Grande coalition, on peut se demander quelle est la part de cette politique dans son retour à la croissance. Sebastian Dullien estime que le tiers de la croissance enregistrée en 2010 est à mettre au compte des programmes de relance conjoncturelle et des baisses d'impôts décidés en 2009 par la Grande coalition. Prises plus tard que dans d'autres pays, ces mesures n'auraient développé tous leurs effets qu'en 2010 6. C'est donc une politique social-démocrate de relance qui expliquerait pour une bonne part l'embellie que connaît en 2010 l'Allemagne. Ce n'est pas pour mettre la chancelière à l'aise puisque son actuel partenaire libéral au gouvernement défend une toute autre politique économique. C'est aussi la politique de maintien des emplois pendant la crise par un soutien sans équivalent en Europe de la part de l'Etat qui expliquerait la relative rapidité de la reprise : 1 500 000 emplois ont été préservés par des mesures que l'on appelle en Allemagne de « travail à durée réduite » (Kurzarbeit) là où l'on parle en France de « chômage partiel ».
La solution vient de la croissance et de la politique économique de relance préconisée par les sociaux-démocrates. La situation actuelle ne signale pas un changement de paradigme dans la politique économique et commerciale de l'Allemagne. Celle-ci continue de miser sur les exportations sans accepter de voir que ses excédents sont les déficits des autres. Pourtant, quand il était en fonction comme ministre des Finances et de l'Economie (1972-74) ou comme chancelier (1974-82), Helmut Schmidt rappelait qu'il ne fallait pas seulement poursuivre les objectifs formulés dans le fameux « triangle magique » (croissance, plein emploi, stabilité monétaire) parce qu'il y en avait un quatrième formant avec les autres un « carré magique » (magisches Viereck) : il convenait d'atteindre dans la mesure du possible à l'équilibre de la balance commerciale ! Au risque sinon de provoquer des tensions avec les partenaires commerciaux de l'Allemagne !
Intérêts commerciaux et politique étrangère de l'Allemagne
Miser sur l'exportation conduit naturellement l'Allemagne à adapter sa politique étrangère en conséquence. Comme les Etats-Unis, elle est intéressée à ce que le commerce international se fasse sans entraves et, à l'inverse de la France, elle ne pense pas l'Europe en termes de bastion à défendre. Ses entreprises se comprennent comme des intervenants sur un marché mondial (global players). C'est peut-être là la source de ce qui a été jugé comme une maladresse de la part du Président fédéral Horst Köhler quand, de retour d'un voyage en Afghanistan, celui-ci a déclaré le 21 mai 2010 au Deutschlandfunk que l'Allemagne misant sur le commerce extérieur, se devait « de défendre militairement ses intérêts, la liberté du commerce et des échanges » en même temps que de lutter contre l'instabilité de régions entières parce que cela « a des conséquences sur nos échanges commerciaux, notre emploi, nos revenus. » Ces paroles qu'il n'a pas pensées jusqu'au bout de leur formulation a conduit H. Köhler à démissionner. Elles étaient politiquement incorrectes parce que l'Allemagne se conçoit d'abord comme une puissance civile pour laquelle la guerre est l'ultime recours quand tous les autres moyens ont échoué. Pourtant ces propos disent, non sans une certaine forme d'innocence, ce qui est le ressort de l'Allemagne et en même temps une partie de ses motivations en matière de politique étrangère.
Ce n'est pas un hasard si la participation de la marine allemande à l'opération Atalanta contre les actes de piraterie le long des côtes de la Somalie et dans l'Océan indien n'est l'objet d'aucune contestation en Allemagne alors que celle en Afghanistan est de plus en plus contestée : il s'agit d'assurer le bon fonctionnement du commerce international. L'Allemagne n'est actuellement représentée qu'avec 330 hommes, mais le mandat accordé par le Bundestag l'autorise à envoyer jusqu'à 1 400 hommes.
Est-ce à dire que l'Allemagne se conçoit de plus en plus comme une puissance « interventionniste » ? Les mots comme les chiffres peuvent être trompeurs. Depuis l'unification réalisée en 1990, les gouvernements allemands qui se sont succédé ont eu le souci de prendre de plus en plus de responsabilités sur la scène internationale et se sont faits un devoir d'habituer une opinion allemande rétive à ce que l'Armée fédérale participe à toujours plus d'opérations au départ de type humanitaire, puis de plus en plus évidemment militaires. Le jugement rendu en juillet 1994 par le Tribunal fédéral constitutionnel a réinterprétée la Loi fondamentale - la constitution de l'Allemagne - de sorte que ce qui semblait interdit du temps de la Guerre froide soit désormais possible dans l'après-guerre froide dès l'instant que cela s'effectue dans le cadre d'organisations de sécurité collective et dans le respect de la Charte des Nations-Unies. On ne peut pas parler dans ce contexte de la « levée du tabou militaire » en Allemagne : il y a eu une simple clarification des termes de Loi fondamentale dans un contexte historique différent. L'Allemagne se refusant, en raison de son passé, à tout cavalier seul en matière d'opérations militaires, cette interprétation lui a permis de répondre favorablement aux demandes de ses alliés et partenaires et de réagir aux sollicitations de l'ONU. H. Kohl avait ouvert la voix, G. Schröder a poursuivi sur sa lancée jusqu'à la guerre d'Irak de 2003 à laquelle il a refusé que participe l'Allemagne parce que tous les moyens de la diplomatie n'avaient pas été épuisés et que l'Irak ne constituait pas un danger immédiat. On y a vu une remise en cause des fondamentaux de la politique étrangère allemande depuis 1949 là où il y avait, en fait, continuité du principe du seul recours à la guerre comme « ultima ratio ».
Sous le chancelier G. Schröder, la Bundeswehr était représentée sur de multiples théâtres d'opération avec environ 12 000 hommes. En arrivant à la chancellerie, A. Merkel a précisé qu'il n'y avait pas d'automatisme pour l'Allemagne à participer aux opérations extérieures pour lesquelles elle était sollicitée. En août 2010, ce sont seulement 6 830 hommes qui participent à des opérations extérieures, le plus fort contingent - plus de la moitié - étant en Afghanistan (4 660 h). 1 400 hommes sont intégrés dans la KFOR au Kosovo, 240 participent aux opérations de contrôle de l'embargo sur la côte libanaise, au sein de l'UNIFIl, à la demande conjointe du Liban et d'Israël, ce qui en soi n'est pas sans importance 7. Cette opération, présentée par la chancelière comme « historique » 8 devait dans l'esprit de beaucoup lever le dernier tabou à peser sur la politique étrangère allemande, donc lui donner le statut d'une puissance normale. Il s'en faut de beaucoup. Bien au contraire, il est apparu lors des débats de l'été et de l'automne 2006, que l'Allemagne, pour faire respecter un embargo certes dirigé d'abord contre les forces du Hezbollah, ne pouvait courir le risque d'un affrontement entre soldats de la Bundeswehr et soldats israéliens. On s'est donc replié sur une solution maritime autrement moins délicate.
De l'avis de divers observateurs dans le monde, l'Allemagne serait aujourd'hui en train de réduire inconsidérément ses forces. Chargé d'économiser en quatre ans (2011-14) 4 milliards d'euros, le ministre de la Défense, Karl-Theodor zu Guttenberg n'aurait de cesse de renoncer au service militaire obligatoire et de réduire de près de 90 000 les effectifs. Les faits sont exacts même si la question n'est pas encore tranchée. Le projet ministériel prévoit, en effet, une réduction des effectifs de 252 000 (chiffre de 2010) à 163 500 dont 156 000 soldats de métier et 7 500 engagés 9. L'objectif est moins de faire des économies - même si c'est là aussi un objectif déclaré - que de disposer d'une armée hautement professionnalisée, davantage susceptible de répondre aux besoins d'une armée mobile qui sert moins désormais à défendre le pays et le territoire couvert par l'OTAN qu'à intervenir dans des missions extérieures ponctuelles telles que définies par l'OTAN et la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). En cela, l'Allemagne suit la voie tracée par la France et, comme elle, se voit reprocher par ses alliés de ne pas consacrer un pourcentage suffisant de son PIB à la défense. Mais cela c'est pour elle, aujourd'hui comme hier, l'affaire de l'OTAN !
Puissance de médiation civile autant que faire se peut, l'Allemagne a donc aussi le souci de s'impliquer dans la prévention et la gestion des crises sous couvert de l'UE, de l'OTAN et de l'ONU. Elle cherche à faire entendre sa voix et à introduire des éléments de ses analyses dans les décisions internationales, mais elle n'est pas en mesure de se concevoir comme une « puissance régionale » et a fortiori comme une « puissance globale ». Elle est, comme ne cesse de le dire Egon Bahr depuis des années, une « puissance européenne moyenne » au poids économique supérieur à celui des autres puissances européennes, située au cœur même de l'Europe et marquée par son passé. Qu'elle voudrait être autre, elle n'aurait pas les moyens de son ambition.
Une Allemagne apaisée vingt ans après son unification ?
Vingt ans après son unification, l'Allemagne est-elle une puissance à l'aise dans sa normalité? A l'approche de ce vingtième anniversaire qui sera célébré le 3 octobre 2010, jour de l'unité, le ministre-président social-démocrate du Brandebourg, Matthias Platzeck, déclare que « nous avons fait les 2/3 du chemin » mais que les Länder de l'Est ont encore besoin de l'aide de ceux de l'Ouest 10. Ce constat est d'autant plus remarquable que M. Platzeck en 1989-90 aurait voulu que l'unité de l'Allemagne soit réalisée non par l'adhésion de la RDA à la RFA mais au terme d'une négociation sur un pied d'égalité entre RFA et RDA pour construire un nouvel Etat. Quelques chiffres permettent d'apprécier l'évolution sur vingt difficiles années. En août 2010, l'Allemagne enregistre encore 3,188 millions de chômeurs, soit un taux global de 7,6%, mais il y a 2,2 millions de chômeurs à l'Ouest, soit un taux de 6,6% tandis qu'à l'Est, il y en a 970 000 soit un taux de 11,5%. Le différentiel est-ouest est donc encore en gros de 1 à 2. Mais c'est en même temps le même taux de chômage à l'Est qu'en 1991, soit le moins élevé. Avec des taux de chômage qui d'un nouveau Land à l'autre varie entre 9 et 12%, on est malgré tout loin des 20% du milieu des années 2000. Un net progrès a donc été fait. Qu'il faut toutefois nuancer dans la mesure où en vingt ans l'Allemagne de l'Est a perdu environ deux millions d'habitants au profit de l'Ouest, mais pas, semble-t-il, pour accroître le contingent des chômeurs. L'Office fédéral de la statistique ne fournit pas de chiffre totalisant les migrations d'est en ouest. C'est presque curieux dans la mesure où l'argument principal invoqué en son temps par le chancelier H. Kohl pour hâter la mise en place d'une union monétaire avec la RDA avait été de dire qu'il fallait empêcher les Allemands de l'Est de venir s'installer à l'Ouest alors qu'ils scandaient dans les rues : « Si le deutschemark ne vient pas à nous, c'est nous qui irons à lui. » Les transferts financiers et sociaux considérables qui ont été effectués d'ouest en est ont à peu près mis l'Allemagne de l'Est à niveau, même si ce fut au prix d'une désindustrialisation massive et d'un exode de la main d'œuvre. Cela ne signifie pas encore que l' « unité intérieure » soit réalisée, au moins les jeunes Allemands de l'Est qui se sont établis à l'Ouest s'y sont fort bien intégrés. L'unité intérieure progresse. Mais sera-t-elle jamais atteinte si l'on veut bien tenir compte des diversités qui ont toujours caractérisé une Allemagne historiquement confédérale et fédérale?
La faiblesse de l'Allemagne, en cet automne 2010, vingt ans après la réalisation de son unité, est d'abord circonstancielle, c'est la faiblesse de son gouvernement tiraillé entre tendances et personnalités différentes au point que celui-ci ne parvient même pas à tirer politiquement profit de l'embellie économique que connaît le pays. De plus, l'Allemagne semble être prise de la manie de la démission de ses élites : non seulement le président fédéral a démissionné - du jamais vu ! - plus sur un coup de tête que pour des raisons sérieuses, mais deux ministres-présidents viennent de le faire : Roland Koch en Hesse et Ole von Beust à Hambourg et ce alors même que ces dirigeants politiques ont dans le passé trouvé que l'engagement des Allemands laissaient à désirer.
Quand l'Allemagne connaît une embellie économique, c'est manifestement bon pour l'Europe, quand elle est donne dans le flou, ce n'est pas un drame, mais ce n'est pas une bonne chose pour elle et ses voisins. Elle n'est pas une force de proposition ! L'Allemagne devrait montrer, voire ouvrir la voie à une Europe qui se cherche et dont elle est la première puissance économique. Quant aux attentes de la France à l'égard de l'Allemagne, elles sont pour l'essentiel l'expression de ses angoisses face à un avenir dont elle sent qu'elle n'est plus capable de l'affronter seule alors qu'elle crédite l'Allemagne, à tort, de cette capacité.
Notes
* Cet article, rédigé fin septembre 2010, a été publié en version originale sur le site http://www.diploweb.com Diploweb.com, la revue géopolitique online, est dirigé par Pierre Verluise, docteur en Géographie politique de l'Université Paris-Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages, dont 20 ans après la chute du mur. L'Europe recomposée, Paris, Choisel, 2009. Diplomates, universitaires et stratèges publient des analyses inédites sur ce site exclusivement consacré aux questions géopolitiques. On trouve sur ce site expert, pluraliste et transparent de nombreuses études de référence sur l'Union européenne, la Russie et la Communauté des Etats Indépendants... sans oublier l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le diploweb.com met en ligne de nombreuses cartes.
1) Sur le programme de relance de 2008 en France et ses insuffisances, voir Hugo Lattard, « Les 4 critiques des opposants au plan de relance Sarkozy », 07/01/2009 - L'Expansion.com
2) Sur les programmes de relance 2008 et 2009 en Allemagne, voir BMWi > Konjunkturpaket, en particulier Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 2/2009 . Cf. aussi FMI Pdf-File Germany: 2008 Article IV Consultation-Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Germany, Januar 2009
3) Cf. Le Monde du 19 mars 2010.
4) Cf. Christian Riermann, « Hilfe für die Nachbarn" in Der Spiegel, No 34/2010, p. 66.
5) Cf. Sources BCE dans Frankfurter Rundschau du 9 septembre 2010 et « Das Ende der Bescheidenheit » in Der Spiegel, 36/2010, p. 72 > Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans Böckler Stiftung.
6) Cf. Sebastian Dullien, « Merkels ungeliebter Aufschwung » in SpiegelONLINE, 26.08.2010.
7) Cf. « Einsatzzahlen - Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente » sur le site bundeswehr.de/portal/a/bwde/einsaetze/einsatzahlen…
8) A. Merkel lors du débat parlementaire du 20 septembre 2006 : « L'intervention au Liban n'est pas une intervention comme les autres, c'est une intervention historique ». D W. Steinmeier, en tant que ministre des affaires étrangères avait, avec davantage de circonspection, déclaré la veille devant le Bundestag : « Avec cette intervention, nous entrons sur un terrain politiquement vierge ».
9) La durée du service militaire n'a cessé de baisser depuis 1990 : de 12 mois de 1990 à 1995, il est passé à 10 mois (1996-2001) puis à 9 mois en 2002, enfin à 6 mois en juillet 2007, le nombre d'appelés passant dans le même temps de 197 000 à un peu plus de 61 000. Source : Bundesverteidigungminsterium > www.bmvg.de
10) Entretien avec M. Platzeck : « Ich verlange Respekt » in Der Spiegel, No 35/2010, p. 39-43.
En route vers l’excellence académique ? L’exemple de l’initiative d’excellence allemande
L'inititiative d'excellence allemande, lancée en 2005 et prolongée jusqu’en 2017, est un programme de promotion de la recherche de grande envergure qui a pour objectif de renforcer la visibilité internationale des universités allemandes et de promouvoir la compétitivité de la recherche allemande. Les universités allemandes, marquées par un sous-financement chronique, se sont lancées dans une compétition scientifique pour gagner à la fois des crédits de recherche et du prestige. L’initiative d’excellence contribue en même temps à une transformation profonde du champ académique en Allemagne. Le présent article décrit le contenu et les étapes de cette initiative et met en lumière ses conséquences pour les universités et les chercheurs. Les critiques de méthode et de fond à son égard sont également abordées.
Auf dem Weg zur Exzellenz ?
Das Beispiel der deutschen Exzellenzinitiative
Mit der im Jahre 2005 initiierten und vorerst bis 2017 laufenden Exzellenzinitiative haben Bund und Länder ein umfangreiches Forschungsförderungsprogramm mit dem Ziel aufgelegt, den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Spitzenforschung an deutschen Hochschulen sichtbar machen. Auf dem Weg des wissenschaftlichen Wettbewerbs konkurrieren die chronisch unterfinanzierten deutschen Universitäten um beträchtliche Fördermittel und Prestige. Zugleich trägt die Exzellenzinitiative zu einem tiefgreifenden Wandel des deutschen Hochschulsystems bei. Die Inhalte und Etappen der Initiative sowie ihre Auswirkungen auf Hochschulen und Forscher werden ebenso beleuchtet wie die Kritik an ihrer Zielrichtung und Umsetzung.
Actualité sociale, octobre 2010
Le 27 septembre 2009, le parti chrétien-démocrate et les libéraux ont remporté les élections fédérales avec plus de 48% des voix, contre moins de 34% pour les sociaux-démocrates et les Verts. A en croire les sondages, les résultats seraient inversés, si le scrutin avait lieu aujourd'hui, plus en raison de l'envol des Verts, semble-t-il aux dépens des libéraux, que grâce à la montée du SPD. Il est vrai que le gouvernement actuel doit faire face à une série de mécontentements qui commencent à prendre une allure de défiance. Les Allemands ne se reconnaissent plus dans ses décisions, que ce soit la prolongation de l’activité des centrales nucléaires, la réforme des prestations Hartz IV ou l’attitude du Mme Merkel dans le conflit qui oppose la municipalité de Stuttgart et ses administrés à propos du projet Stuttgart 21. L’économie va beaucoup mieux, les récentes augmentations de salaires dans la métallurgie en témoignent, mais l’ambiance n’est pas bonne, jetant le doute, après l’échec des élections de Rhénanie du Nord-Westphalie, sur l’issue des six élections régionales programmées pour l’année prochaine, notamment celle, décisive, du Bade-Wurtemberg de mars 2011.
Réforme des allocations sociales Hartz IV
Les conclusions du rapport sur le système d’allocations sociales Hartz IV étaient attendues avec impatience. Rendues publiques par la ministre du Travail, Ursula von der Leyen, le 26 septembre 2010, elles ont soulevé un tollé dans l’opposition, tant elles restaient en deça des attentes du public concerné. Elles préconisent en effet une simple augmentation de 5 € de l’allocation aux chômeurs de longue durée, assortie d’un complément éducatif (Bildungspaket) de 20 € par mois destiné aux enfants des familles pauvres. Si le gouvernement était obligé de se pencher sur Harz IV, d’après le nom de l’ancien DRH de Volkswagen chargé par Gerhard Schröder d’élaborer la réforme sociale en 2005, c’était en réponse aux critiques de la Cour constitutionnelle fédérale, qui avait estimé au début de l’année que le mode de calcul de la prestation pour les enfants manquait de transparence. D’après le verdict de la Cour, la réglementation en vigueur n’était pas compatible avec la loi fondamentale allemande qui garantit « le droit à une existence digne », selon la déclaration de son président de l’époque, Hans-Jürgen Papier. Sans exiger expressément un relèvement des allocations, les juges de Karlsruhe avaient donné jusqu’au 31 décembre 2010 au gouvernement pour mettre fin aux incohérences de la loi Hartz IV.
Les aides versées aux allocataires sont calculées selon un barème très précis, qui a l’ambition de prendre en considération l’ensemble des besoins d’une personne adulte, ce qui donnait une somme globale de 359 € en 2010 par mois, comparée à 345 € en 2005 lors de son entrée en vigueur. Pour les enfants, l’allocation est calculée sur la base de la somme versée pour un adulte. Ainsi, pour un enfant de moins de 6 ans, l’allocation est de 60% (215 €), entre 6 ans et moins de 14 ans de 70% (251 €) et pour ceux entre 14 et 18 de 80% (287 €). Le problème soulevé par la Cour constitutionnelle est que le mode de calcul appliqué par le gouvernement ne se base pas sur l’analyse des besoins des enfants, en particulier leurs besoins spécifiques, tels que le changement plus fréquent des vêtements et des chaussures, les activités scolaires et culturelles ou les produits d’hygiène nécessaires aux bébés.
Le nouveau calcul présenté par le ministère du Travail définit les besoins d’un allocataire, au centime près, de la manière suivante : alimentation : 128,46, loisirs : 39,96, téléphone et Internet : 31,96, vêtements : 30,40, équipement pour le foyer : 27,41, autres biens et services : 26,50, transports : 22,78, produits de santé : 15,55, restauration : 7,16 , culture : 1,16, hausse des prix : 1,19. Total : 364 €. Si la plupart des rubriques correspondent à celles appliquées auparavant, avec la même parcimonie en ce qui concerne les produits culturels, il a été noté que les dépenses allouées aux achats de tabac et d’alcool ont été complètement supprimées. Pour les enfants, les calculs ont été modifiées pour tenir compte des spécificités de leurs besoins, mais le niveau des allocations est resté identique. Le Bildungspaket créé par Mme von der Leyen fera toutefois bénéficier chaque enfant d’un crédit annuel d’environ 250 € pour ses loisirs, l’achat de matériel scolaire, sa cantine et éventuellement un complément de soutien scolaire.
L’allocation Hartz IV concerne environ 6,6 millions de personnes dont 1,7 million d’enfants de moins de 15 ans. En 2008, le gouvernement a dépensé près de 35 milliards d’euros pour ces prestations, total incluant aussi le loyer et le chauffage des bénéficiaires. Même modeste, l’augmentation prévue coûtera environ 300 millions d’euros. Le gouvernement sait que l’opinion publique ne partage pas complètement la position de l’opposition ; certains allocataires sont considérés comme des profiteurs qui ne cherchent pas activement à intégrer le marché de l’emploi. Une famille avec deux enfants vivant de Hartz IV perçoit en effet plus d’argent qu’une autre dont le chef de famille travaille dans le secteur des bas salaires.
La réforme des prestations de Hartz IV n’est toutefois pas définitivement adoptée. Il faut encore qu’elle passe au Bundesrat où le gouvernement n’a plus la majorité depuis son échec aux élections de Rhénanie-du Nord-Westphalie. L’opposition, le SPD et les Verts, ont d’ores et déjà annoncé leur intention de bloquer le processus législatif. Les discussions à venir risquent d’être animées.
Prolongation de l’activité des centrales nucléaires
En septembre 2010, le gouvernement a pris une décision qui le met en porte-à-faux par rapport à l’opinion publique. La coalition CDU/CSU/Libéraux s’est en effet mise d’accord sur l’avenir des 17 centrales nucléaires. Elle a confirmé la prolongation de l’activité des réacteurs de douze ans en moyenne, quatorze ans pour les plus jeunes et huit ans pour les plus anciens. Les quatre grands producteurs d’électricité, E.ON, RXE, EnBW et Vattenfall, saluent cette décision, bien qu’ils soient taxés de 2,3 milliards d’euros par an. Sur cette somme, ils verseront 300 millions par an jusqu’en 2013, puis 200 millions par an dans un fonds destiné à financer des investissements dans la recherche et le développement des énergies renouvelables. Le reste ira dans les caisses de l’Etat. L’industrie nucléaire, qui devra aussi investir de 300 à 500 millions d’euros par réacteur pour les adapter à cette prolongation, saura faire face à ces dépenses, car, les réacteurs étant largement amortis, cette activité supplémentaire leur permettra d’engranger au moins 50 milliards d’euros.
Pour le gouvernement, le nucléaire est considéré comme une « technologie de transition » en attendant l’essor des énergies renouvelables, très coûteuses à mettre en place. Sans l’allongement de la durée de fonctionnement des centrales, il aurait été impossible, affirme le gouvernement, que l’Allemagne remplisse ses engagements en matière de réduction des émissions de CO2 D’après la stratégie énergétique à l’horizon 2050 présentée par le gouvernement le 28 septembre, il s’agit de porter la part des énergies renouvelables à 60% du total de l’énergie consommée en Allemagne en 2050 et de réduire les émissions de CO2 de 80%. Pour ce faire, le gouvernement privilégie l’éolien, à l’image du projet de 75 milliards d’euros prévu en Mer du Nord et dans la Baltique. L’accent mis sur l’éolien est assez surprenant, Mme Merkel, qui fut ministre de l’Environnement au milieu des années 1990, ayant soutenu dans un livre d’entretien (A ma façon, Editions L’Archipel), que l’éolien était « son cauchemar » en raison de « l’énormité des subventions ».
Si la volte-face de la Chancelière concernant l’éolien ne passe pas bien auprès de l’opinion publique, qui n’est pas opposée aux moulins à vents, mais, si possible, pas sur son horizon, la décision de prolonger l’activité des réacteurs nucléaires est accueillie par une franche hostilité, non seulement par l’opposition, mais par la population dans son ensemble. En 2002, le gouvernement SPD/Verts précédent avait effectivement instauré une loi sur la sortie du nucléaire à l’horizon 2022, une décision saluée par l’opinion publique. Le nucléaire n’émet certes pas de CO2, mais il produit des déchets radioactifs, dont le stockage est un problème actuellement non résolu. C’est notamment cet aspect de dangerosité qui motive le refus des Allemands, même s’ils s’inquiètent aussi de la vulnérabilité des réacteurs face au terrorisme (aérien, p. ex.). C’est aussi un des arguments principaux avancés par l’opposition et les associations écologistes qui estiment que le gouvernement sacrifie la sécurité des citoyens au profit de l’industrie nucléaire. Ils soulignent par ailleurs que la stratégie énergétique pour 2050 reste en deça des attentes en ce qui concerne l’immobilier et l’automobile. Le gouvernement avait initialement envisagé de faire en sorte que tous les immeubles soient « écologiquement neutres » en 2050. Craignant que cette obligation ne conduise à de fortes augmentations de loyer, il souhaite désormais se limiter à des incitations financières pour parvenir à rendre plus économe ce secteur « énergivore ». Le secteur automobile, un des fleurons de l’industrie allemande, échappe également à de nouvelles contraintes. Si ces aspects de la stratégie énergétique du gouvernement passent bien dans l’opinion publique, le maintien du nucléaire est une politique risquée, tant l’opposition dans le pays est grande.
Stuttgart 21
Stuttgart 21, une appellation encore totalement inconnue du grand public avant l’été, divise l’opinion et met le gouvernement en difficulté. C’est le nom donné à un projet d’investissement d’environ 5 milliards d’euros portant sur la démolition de la gare de la ville de Stuttgart et son remplacement par une nouvelle gare passante, souterraine, située sur une grande ligne ferroviaire européenne qui relie Paris à Bratislava. Ce projet gigantesque, sur lequel la municipalité de Stuttgart travaille depuis des années, prévoit la construction de 55 ponts et de 63 km de tunnels. Il est passé par toutes les instances administratives, approuvé tant par les sociaux-démocrates que par les chrétiens-démocrates au pouvoir au Bade-Wurtemberg.
Mais à l’approche de la démolition d’une aile de la gare, qui a débuté fin août, une opposition englobant toutes les strates de la population s’est formée pour réclamer l’arrêt de l’opération. Les opposants semblent avoir pris conscience du fait que le projet implique la destruction d’un parc qui comporte des arbres centenaires. De plus, ils considèrent maintenant que l’opération est trop chère, inutile et anti-écologique. La mobilisation s’est radicalisée, conduisant à des manifestations quasi-quotidiennes dont certaines ont dérapé. Ainsi, dans la nuit du jeudi 30 septembre au 1er octobre, quand les engins de chantier se sont mis en action pour abattre les arbres comme prévu, des centaines de policiers en tenue de combat ont fait face à des manifestants déterminés qui ne se sont pas laissés intimider par les coups de canons à eau et de sprays de poivre. L’intervention musclée de la police qui a fait des centaines de blessés parmi les manifestants, dont un certain nombre de personnes âgées, a choqué l’opinion publique sans ébranler la détermination des opposants au projet.
Du coup, l’opération Stuttgart 21 a quitté sa dimension locale pour se muer en conflit politique national. Le SPD, qui avait initialement soutenu la nouvelle gare, a pris ses distances devant l’opposition grandissante au projet. Il réclame désormais un referendum. Les chrétiens-démocrates, loin de calmer le jeu, ont fait savoir, par la voix de Mme Merkel devant le Bundestag, qu’ils soutenaient l’opération sans réserves. D’après eux, les élections régionales au Bade-Wurtemberg en mars prochain se joueront sur ce projet. Pour débloquer la situation, un médiateur a été nommé le 7 octobre en la personne de Heiner Geissler, un membre du parti chrétien-démocrate, connu pour ses positions modérés. Mais la situation reste confuse. Les opposants au projet ayant exigé la suspension des travaux pendant les négociations avec le gouvernement du Land et la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands, M. Geissler a annoncé que les travaux seraient provisoirement arrêtés, le temps de nouer le dialogue avec les manifestants. Il a toutefois été contredit immédiatement par M. Mappus, le ministre-président du Bade-Wurtemberg, et M. Grube, le PDG de la Deutsche Bahn, qui ont nié avoir donné leur accord à un arrêt total des travaux. La suspension ne serait que partielle, l’abattage des arbres et la démolition de l’aile sud de l’ancienne gare continueraient comme prévu.
M. Geissler se donne jusqu’à Noël pour débloquer la situation. Car si les dissensions autour de Stuttgart 21 se poursuivent, elles risquent d’obérer les élections régionales au printemps prochain pour les chrétiens-démocrates au pouvoir. En baisse dans les sondages, ils pourraient perdre les élections pour la première fois depuis cinquante ans.
La fin de la rigueur salariale ?
Lorsqu’on évoque en France la rapide sortie de crise de l’économie allemande, à contre-courant de celle de la plupart des pays européens, les spécialistes français manquent rarement d’évoquer, à côté de ses forces en matière d’exportations, la grande modération salariale dont les Allemands ont fait preuve pendant la dernière décennie. De 2000 à 2008, le coût unitaire de la main-d’œuvre n’y a augmenté que de 2,7% contre 16,5% en moyenne dans la zone euro et 17,6% en France. Début septembre 2010, le puissant syndicat de la métallurgie, IG Metall, dont les revendications salariales donnent habituellement le ton à l’ensemble des branches professionnelles, a fait savoir que la rigueur salariale n’était plus de mise. Pour ce qu’il qualifie de « premières négociations d’après-crise », il réclame 6% d’augmentations sur douze mois. Le patron d’IG Metall, Michael Sommer, estime que les salariés ont accepté le chômage partiel et le recul sensible des revenus concomitant, mais avec des prévisions de croissance de 3% pour cette année, il considère qu’ils ont droit à leur part du gâteau. L’augmentation des salaires n’était pas le seul objectif des négociations. Le syndicat voulait également aborder deux autres sujets sensibles, à savoir l’amélioration des conditions de travail pour les salariés âgés et l’alignement des rémunérations des intérimaires et des salariés en contrat à durée déterminée sur celles des salariés permanents de l’entreprise.
Si le gouvernement estime que la reprise doit également profiter aux salariés, le patronat est plus dubitatif. Le président de Gesamtmetall, le patronat de la métallurgie, Martin Kannegiesser, estime pour sa part que la reprise est encore fragile après une crise aussi brutale et profonde. L’économie américaine, notamment, se remet à peine de la crise ; les exportations allemandes vers les marchés émergents ne parviennent pas à compenser complètement le recul sur les marchés occidentaux. De plus, les patrons allemands sont persuadés qu’il est préférable pour la croissance en Europe de créer des emplois plutôt que d’augmenter les salaires. Pour toutes ces raisons, Gesamtmetall a proposé une augmentation des salaires de 2,7% à partir de début 2011. La revendication sur l’égalité des salaires des intérimaires a également buté sur l’opposition du patronat. Alors qu’en France, les intérimaires sont non seulement payés au même tarif que les salariés maison, mais reçoivent en sus une prime de précarité à la fin de leur mission, en Allemagne, ils sont payés en moyenne 25% de moins que les salariés permanents, parce qu’ils ne dépendent pas de la même convention collective que les salariés de l’entreprise cliente. Ils relèvent d’une convention signée avec les associations des entreprises de travail temporaire, beaucoup moins favorable aux salariés concernés.
La rémunération des intérimaires est un sujet sensible eu égard au calendrier européen. Dès le 1er mai 2011, la libre circulation des travailleurs dans toute l’Union européenne pourrait entraîner un afflux de Polonais et de Tchèques – dont l’emploi dans certains pays membres occidentaux est freiné jusqu’à cette date – qui accepteraient de travailler dans l’intérim pour des salaires dérisoires, déstabilisant ainsi l’ensemble du marché du travail temporaire. C’est pourquoi le gouvernement, hostile à l’introduction d’un salaire minimum interprofessionnel garanti, est plutôt favorable à la fixation d’un salaire minimum dans l’intérim.
Fin septembre, sans pression excessive de la part des syndicats, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord considéré comme satisfaisant par les deux parties :
* Une augmentation salariale de 3,6% à partir du 1er octobre 2010 et valable jusqu’au 1er novembre 2011. De plus, les salarié(e)s recevront un versement forfaitaire de 150 € en septembre 2010. Les apprentis verront leur salaire augmenter également, de 40 € dès l’acceptation de la convention.
* Les personnes embauchées sous contrat à durée déterminée, ainsi que les intérimaires, recevront à partir du 1er janvier 2011 et pendant une période de deux ans la même rémunération que le personnel permanent, et ce dans toutes les entreprises sidérurgiques. Au cas où l’agence de recrutement de personnel temporaire ne verserait pas la rémunération prévue par l’accord d’égalisation salariale, l’entreprise sidérurgique serait tenue responsable envers le salarié.
Le 7 octobre 2010, ce résultat des négociations pour le secteur métallurgique de l’Allemagne du Nord-Ouest (Rhénanie du Nord-Westphalie, Basse-Saxe et Brême) a été accepté à l’unanimité par la Commission IG-Metall en charge des questions tarifaires. L’amélioration des rémunérations pour les intérimaires a été particulièrement bien perçue. Il s’agit en effet de la première convention qui établit l’égalité de traitement entre personnel permanent et travailleurs temporaires.
Le résultat des négociations dans le secteur de la métallurgie est considéré comme significatif de l’évolution globale des salaires en Allemagne. Peut-on d’ores et déjà estimer que la modération salariale a vécu ? Il est trop tôt pour le dire, mais ce serait une bonne nouvelle pour les salariés qui ont vu leur part dans la richesse produite décliner depuis des années au profit de la rémunération du capital. L’autre bonne nouvelle est la revalorisation du statut financier des intérimaires qui bénificient enfin de la règle : gleicher Lohn für gleiche Arbeit, comme en France. Plus problématique, hélas, est la hausse de l’euro vis-à-vis du dollar et du yuan, qui peut compromettre la reprise.
Brigitte.Lestrade@u-cergy.fr
Philippe Baudouin, Au microphone : Dr. Walter Benjamin. Walter Benjamin et la création radiophonique 1929-1933, Editions de la Maison des sciences de l'homme, collection Philia, Paris, 2009.
Avec cet ouvrage, Philippe Baudouin éclaire un aspect méconnu de l'œuvre de Walter Benjamin, sa collaboration avec les radios de Berlin et de Francfort, qu'il met en rapport avec sa réflexion théorique sur l'œuvre d'art. Pour mieux cerner la pratique de W. Benjamin, Ph. Baudouin commence par présenter les productions artistiques et les réflexions esthétiques à l'époque de la République de Weimar. Depuis les dadaïstes et les représentants de la Nouvelle Objectivité, les artistes intègrent dans leurs œuvres les avancées de la technique et bientôt le cinéma. Ils sont aussi nombreux à considérer comme impossible la séparation entre art et politique. Avec le Bauhaus, Walter Gropius propose un nouveau modèle de pédagogie. Erwin Piscator et Bertolt Brecht mettent l'accent sur la naissance d'une pensée critique. C'est d'ailleurs en s'inspirant des réflexions de Brecht sur le théâtre épique que Benjamin va déterminer la fonction qu'il assigne à la radio : un moyen d'intervenir dans l'actualité, un véritable outil de communication populaire.
On dispose aujourd'hui de quatre-vingt-dix émissions (conférences et entretiens littéraires) réalisées par Benjamin entre 1929 et 1933, mais ses archives ayant été confisquées en 1940 à Paris par les nazis et rapatriées en RDA par les Soviétiques, il se peut qu'il y en ait eu davantage. En revanche, il n'a rédigé aucun essai philosophique sur la radio. C'est à la photographie et au cinéma qu'il consacre son essai "L'auteur comme producteur" (1934), où il insiste sur le changement radical de la réception de l'art depuis l'apparition de ces nouveaux médias. Puis, dans son essai "L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique" (rédigé entre 1935 et 1939), il prolonge cette réflexion en insistant sur l'apparition des moyens démocratiques d'accès du public à l'œuvre d'art. En revanche, dans "Entretien avec Ernst Schoen" (1929), il utilise la forme de l'interview pour livrer sa réflexion sur des pièces à composante musicale et montrer son intérêt pour la vulgarisation à la radio. Dans ses "Réflexions sur la radio" (1930), il déplore que la radio allemande – contrairement à celle d'Union soviétique – ne soit pas encore parvenue à mieux intégrer ses auditeurs.
Benjamin a conçu des émissions très diverses. Les "Pièces radiophoniques" (Hörspiele) sont au nombre de cinq et font intervenir la musique électroacoustique et la poésie sonore. Les "Modèles radiophoniques" (Hörmodelle) proposent des solutions aux questions des auditeurs sur les problèmes de la vie quotidienne. C'est au trente-neuf émissions d'un nouveau genre, destinées aux enfants, que Ph. Baudouin consacre tout un chapitre. Il ne s'agit pas que de contes, mais aussi de pièces de théâtre et d'émissions pédagogiques, le tout publié sous le titre Lumières pour enfants (Aufklärung für Kinder). Benjamin considère, en effet, que "l'art de raconter est en train de se perdre", la narration se voyant progressivement confinée dans la littérature. Benjamin présente "La Prohibition américaine", transpose les enfants à Marseille, à Naples, sur les bords du Mississippi ou à Pompéi avec ses récits d'escroqueries, de catastrophes, de brigands et de sorcières. "Un gamin berlinois" fait intervenir – sans aucune nostalgie – les souvenirs de Benjamin et anticipe sur certains aspects du futur Passagen-Werk : "S'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt demande toute une éducation", affirmait-il. Il s'attache toujours à éveiller la curiosité de ses auditeurs en leur proposant de multiples expérimentations.
L'ouvrage de Ph. Baudouin comprend également en annexe une utile bibliographie et la traduction en français de plusieurs textes de Benjamin, dont les "Réflexions sur la radio". On y trouve aussi un CD ("Chahut autour de Benjamin") comprenant des pièces radiophoniques, une bonne initiative...
Anne-Marie CORBIN
Marc Beghin e. a., Heimat. La petite patrie dans les pays de langue allemande, actes
du 40e congrès de l'AGES, Chroniques allemandes, revue du CERAAC n° 13/2009.
Les actes du 40e colloque de l'AGES (Grenoble 2007) ont été édités par Marc Beghin, Ursula Bernard, Christian Eggers, François Genton, Sophie Lorrain, Herta Luise Ott et Gaëlle Vassogne. Ils rassemblent une quarantaine de contributions toutes consacrées à la définition et à l'illustration du concept de Heimat. Il s'y ajoute quelques témoignages et souvenirs. Les contributions sont présentées de manière thématique en six chapitres. Le premier traite de l'évolution du concept politique de Heimat au cours de l'histoire des pays de langue allemande. Comme le souligne Alfred Grosser dans l'un des discours introductifs, c'est une notion dangereuse dans la mesure où elle était parfois assimilable à celle de patrie et exploitée à des fins de propagande. Les deux chapitres suivants donnent de multiples exemples de son utilisation dans les œuvres littéraires en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Autriche et en Europe centrale. Le quatrième chapitre évoque la perte de la "petite patrie", qu'il s'agisse d'un exil intérieur ou d'un exil réel pour tous ceux qui durent quitter leur terre natale à l'époque nazie, par exemple, pour fuir des persécutions politiques. S'ils trouvèrent une nouvelle terre d'accueil, ils eurent souvent beaucoup de mal à y prendre racine, étant menacés de destruction identitaire. Ce phénomène était très lié au problème de la langue, un aspect développé dans le cinquième chapitre qui insiste également sur l'usage des dialectes et l'instrumentalisation de la langue par le pouvoir au XIXe siècle en vue d'asseoir le pouvoir de l'Etat-nation. Le dernier chapitre est consacré à la place qu'occupe cette thématique dans les chansons et le cinéma, d'autres moyens de discours sur la Heimat, lecture parfois nostalgique, parfois très critique pour la société contemporaine. La qualité de cet ouvrage repose sur la variété des champs abordés. C'est aussi une bonne illustration des rapports entre littérature, civilisation et linguistique dans la germanistique française.
Anne-Marie CORBIN
Présence de la République Fédérale dans la RDA des années 1980
Dossier dirigé par Jacques Poumet, publié avec le soutien
du centre de recherche Langues et Cultures Européennes de l'Université Lyon 2,
la participation de l'École Normale Supérieure de Lyon,
et le concours de la Région Rhône-Alpes et du Département du Rhône
La fin de la division de l'Allemagne et l'unification réalisée en 1990 marquent la fin de la période de l'après-guerre. Le nouveau statut international de l'Allemagne auquel les « Quatre » souscrivent avec un empressement divers met fin à quarante années de statut juridiquement provisoire reposant sur les accords et les désaccords entre les vainqueurs de 1945. L'effondrement du bloc soviétique et la fin de la guerre froide font disparaître le cadre international dans lequel avait prospéré la division allemande et mettent un terme aux affrontements militaires et idéologiques qui ont prolongé la période d'après guerre. Cette nouvelle donne a des conséquences sur la façon de considérer l'histoire des deux États allemands pendant la période de la division. Avant 1990, l'intégration durable des deux Allemagnes dans deux blocs antagonistes conduisait à traiter leur histoire principalement comme deux histoires divergentes dont les déterminations se trouvaient en dehors du contexte interallemand. Vingt ans après l'unification la perspective s'est déplacée, et, avec le recul du temps, les interdépendances entre les histoires des deux États allemands prennent une importance nouvelle. L'idée d'une histoire intégrée des deux États allemands fait son chemin, mais les contours et les limites d'une telle démarche sont encore loin de faire l'unanimité.
« L'histoire parallèle asymétriquement entrelacée » que l'historien Christoph Klessmann appelle de ses vœux implique en particulier la reconnaissance du fait que l'influence de la République fédérale sur les évolutions en RDA a été plus marquée et est plus facile à saisir que l'influence inverse. La référence implicite ou explicite à l'autre État allemand a eu dans la conscience publique, jusque dans la dernière décennie, une importance plus grande en RDA qu'en République fédérale. Les sources rendues accessibles en grand nombre par la disparition de l'État-Parti et les études fondées sur l'expérience vécue de la population montrent qu'en dépit des dénégations officielles la République Fédérale a eu une importance centrale sur les évolutions en RDA. Cela ne concerne pas seulement les problèmes frontaliers, mais des domaines aussi différents que les relations économiques, les relations avec les Églises et l'utilisation de l'antifascisme comme un instrument de légitimation du pouvoir.
Les contributions de ce dossier montrent que la politique officielle de démarcation menée par la RDA n'a pas empêché les interactions dans des domaines essentiels: politique étrangère et politique intérieure, stratégie économique et mesures à caractère social, idéologie et propagande, mouvements artistiques et littéraires. Dans de dernier secteur, les phénomènes d'érosion des années 1980 permettent certaines formes de communication interallemande alors que l'idée même de nation culturelle allemande reste un sujet tabou en RDA.
La RDA des années 1980 parvient à une certaine forme de consécration internationale, mais dans le même temps elle est confrontée à des évolutions qui la fragilisent ou qui la minent : nouvelles marges d'autonomie reconnues par l'Union Soviétique aux pays satellites, déclin économique et endettement massif, établissement durable d'une nébuleuse contestataire. Fermée aux courants de réformes qui se répandent dans les pays voisins du bloc de l'est, la RDA est incapable d'enrayer chez elle la perte confiance qui se répand à tous les niveaux de la population, y compris dans les rangs du SED. L'incapacité du régime à résoudre les problèmes existentiels est sensible dans de nombreux domaines et se manifeste de façon visible dans la dégradation de l'environnement et le délabrement des quartiers anciens. Ce climat alimente une vague d'émigration en République Fédérale qui s'amplifie d'année en année, tant l'immobilisme du pouvoir fait douter de la possibilité d'un changement à brève échéance.
Malgré le regain de tension est-ouest des années 1980, les deux États allemands se sont efforcé de préserver les relations entre Bonn et Berlin-est. Ulrich Pfeil rappelle que si la visite de Helmut Schmidt en RDA (1981) et celle d'Erich Honecker à Bonn ( (1987) ont manifesté de façon spectaculaire le maintien de ces relations, elles ont apporté peu de changements concrets. Tout contact de H. Schmidt avec la population a été empêché lors de sa visite en RDA, et les efforts de Bonn pour obtenir une amélioration des contacts entre les deux populations ont été suivis de peu d'effets. Pour la population de RDA, l'espoir de voir s'élargir de façon significative les possibilités de voyages à l'ouest a été déçu, ce qui a contribué à alimenter le mécontentement et la frustration.
Les mouvements pacifistes dans les deux États allemands ont eu un déclencheur commun, la double résolution de l'OTAN. Mais Hélène Miard-Delacroix souligne que la structuration du courant pacifiste a été très différente à l'est et à l'ouest du fait de l'accès très inégal à l'expression publique, ce qui a limité les possibilités d'influence mutuelle. Entre le mouvement de masse du pacifisme à l'ouest et la mouvance des groupuscules qui revendiquaient en RDA un autre pacifisme que celui que l'État s'attribuait, les contacts ont été réels mais difficiles, les formes d'action peu interchangeables, les interférences parfois contre productives dans le contexte de défiance vis à vis des influences politiques venant de l'autre côté. L'objectif commun a réuni ponctuellement des personnalités contestataires de l'est et de l'ouest, mais les réseaux pacifistes de RDA, souvent liés aux Églises qui avaient leurs propres initiatives dans ce domaine, se sont développés de façon autonome, malgré une certaine visibilité à l'ouest.
Les choix économiques faits par la RDA ont été dictés à la fois par les contraintes de son système économique et par le voisinage de la République Fédérale. André Steiner montre que, pour s'assurer de la loyauté de la population, la RDA a dû lui procurer un niveau de consommation dont l'unique référence était la République fédérale, ce qui a rapidement excédé ses capacités de production. L'endettement qui en a résulté, symbolisé par les deux crédits de 1 milliard de D-Mark octroyés par la République fédérale, a conduit la RDA à des décisions stratégiques - production ruineuse de processeurs informatiques- et commerciales - réduction des importations- qui ont aggravé avec le temps la situation de l'offre. La RDA ne sortira jamais de ce cercle vicieux et sera impuissante à empêcher que le D-Mark ne prenne une place croissante comme « seconde monnaie » officieuse sur le marché intérieur.
L'image officielle de la République fédérale comme ennemi a été forgée dès la fondation de la RDA et a connu une évolution que retrace Monika Gibas. Inséparable des proclamations des années 1950 sur l'unité de la nation, la visée éliminatoire de cette image de l'autre État a été nécessaire à la RDA pour justifier sa propre existence au plus fort de la guerre froide. Avec les progrès de la détente, cette image de l'ennemi n'est pas révisée sur le fond, mais fait l'objet d'une propagande moins agressive. La Stasi , quant à elle , cultive dans ses directives et ses documents internes la conception classique de l'ennemi de l'ouest, mais le discours officiel est atténué, la notion d'ennemi fait place à celle d'adversaire, voire passagèrement à celle de concurrent. Le regain de tension entre les blocs au début des années 1980 ravive l'image de l'ennemi lorsque l'éducation militaire précoce est introduite dans les écoles. Mais l'approfondissement des contacts interallemands est de plus en plus difficile à concilier avec la répression du mouvement pour la paix, et la population n'est plus réceptive aux images d'une République Fédérale menaçante.
Les courants musicaux relevant à l'ouest d'une culture spécifique de l'adolescence et de la jeunesse on tous pénétré en RDA où ils ont fait des adeptes, en particulier grâce aux médias de la République Fédérale. Michael Rauhut fait remarquer que ces phénomènes transplantés en RDA y ont connu un infléchissement notable. Les phénomènes de groupe, les comportements et les modes vestimentaires (gothics, punks, heavy metal, blues) ont été plus qu'à l'ouest l'affirmation d'une altérité protestataire en butte à l'hostilité, voire aux réactions agressives des autorités envers toute forme de réseau autonome. Ces courants ont recruté en RDA dans des couches de population plus populaires qu'à l'ouest et n'y ont pas connu l'érosion qu'engendre une commercialisation à l'occidentale. Dans la seconde moitié des années 1980, la politique culturelle officielle a fini par faire une place à certains de ces courants, leur ôtant ainsi l'att rait de l'interdit sur lequel reposait pour une part leur vogue.
Dans le domaine des arts plastiques, Jacques Poumet constate que la politique de démarcation et l'appareil institutionnel chargé de promouvoir une culture spécifique de la RDA n'ont pas pu empêcher les contacts avec les courants artistiques de l'Ouest. Des échanges ont eu lieu à différents niveaux et des correspondances se sont dégagées. Après les débats très vifs des années 1990 où s'est affirmée une vision souvent dévalorisante des arts de RDA, les approches actuelles mettent en avant les rapports qui ont existé, spécialement dans les années 1980, entre les productions artistiques des deux parties de l'Allemagne. Les parallélismes témoignent soit d'influences directes, soit d'évolutions concomitantes, et le travail pictural sur le poids du passé nazi est un lieu de rencontre particulièrement important. Les formes d'expression qui brisent le cadre des genres traditionnels doivent cependant en grande partie se cantonner dans une marginalité dont les membres sont réceptifs aux courants occidentaux, et qui seront concernés au premier chef par la vague de départs à l'Ouest des années 1980.
Dans les années1980, l'existence de formes de circulation particulières entre les œuvres littéraires et les auteurs des deux Allemagnes prend une importance nouvelle qu'analyse Anne Lemonnier-Lemieux. L'exode massif d'écrivains de RDA après l'affaire Biermann donne naissance à une littérature de RDA « hors les murs » qui reste pour une part centrée sur l'objet RDA et constitue un défi pour les écrivains qui ont renoncé à émigrer ou qui retardent le moment de le faire. La désorientation de la politique culturelle de RDA dans les années 1980 permet aux écrivains de profiter de certaines failles tout en les exposant à des réactions imprévisibles. Plus que les contacts personnels entre les écrivains de l'est et de l'ouest, c'est la naissance d'un embryon de littérature interallemande qui exerce en RDA un effet déstabilisant : Les influences peuvent désormais s'exercer à double sens, et les productions majeures des écrivains de RDA peuvent faire référence à l'ouest. Peu préparées à cette situation, les autorités naviguent à vue et seront incapables d'empêcher la fronde générale du dernier congrès des écrivains deux ans avant l'effondrement du régime.
Le 7 octobre 1989, un parti social-démocrate se crée en RDA. Étienne Dubslaff s'interroge sur les rapports de ce nouveau parti avec son pendant ouest-allemand. En elle-même, la fondation d'un parti social-démocrate en RDA dénonce la prétention du SED à incarner à lui seul l'ensemble du mouvement ouvrier. Pour autant, le nouveau parti reste attaché dans un premier temps à l'existence de deux États allemands. Adoptant un sigle (SDP) différent de celui du SPD de l'Ouest, le parti social-démocrate de RDA marque sa volonté de se distinguer de son homologue occidental. Il existe néanmoins une nette parenté dans la composition des élites des deux partis, et la définition que le SDP donne de lui-même est proche de celle du Volkspartei que le SPD est devenu après le congrès de Bad Godesberg. Les similitudes l'emportent bientôt sur les tentatives de construire une identité propre du parti social-démocrate issu de la RDA, et la fusion des deux partis intervient quelques jours avant l'unification.
La propagande contre la République fédérale et ses effets dans la RDA des années 1980
Au cours des quarante années d'histoire de la RDA, l'image officielle de la RFA a perdu peu à peu de son ton alarmiste dû à la conviction d’une menace latente durant les années 1950, au paroxysme de la Guerre Froide. L’image de l’autre partie de l’Allemagne demeura cependant une image de l’ennemi à laquelle on eut recours de façon offensive dans des situations de crise, intérieure ou extérieure. Au sein des élites politiques est-allemandes, le remplacement de l’image de l’ennemi « RFA » par l’image nuancée d’une République Fédérale considérée comme un voisin tout à fait normal, comme l’autre Allemagne – et non pas l’Allemagne ennemie -, n’a finalement pas eu lieu, alors qu’il avait été amorcé dans le cap affiché par la politique étrangère dans le contexte de la politique de détente des années 1970-1980. Les seules modifications que l’on puisse constater concernent l’idée que l’ennemi devait être éliminé et qu’il était « fasciste ». Dans le contexte des premières années, au moment où se définissaient les objectifs politiques et stratégiques du « combat pour l’unité de l’Allemagne », ces attributs de l’ennemi avaient encore une dimension opérationnelle. Mais lorsque les dirigeants est-allemands se furent détournés de l’unité pour se concentrer sur le développement de leur propre Etat, ces attributs n’eurent plus la même utilité : la question de « l’élimination de l’ennemi » ne se retrouve plus que sous la forme d’une option théorique, conséquence logique du processus mondial inévitable, anticipé par la théorie sociale marxiste-léniniste, de passage d’une société capitaliste à une société socialiste puis communiste. Dans la deuxième moitié des années 1980, on constate cependant que les fronts se durcirent dans la discussion politique interne entre les partisans d’une réforme et les opposants déclarés, parmi lesquels les groupes du mouvement pour la paix. L’érosion de l’image de la République Fédérale comme ennemi, accélérée par le discours consensuel des élites politiques sur la question germano-allemande, y a sans doute largement contribué.