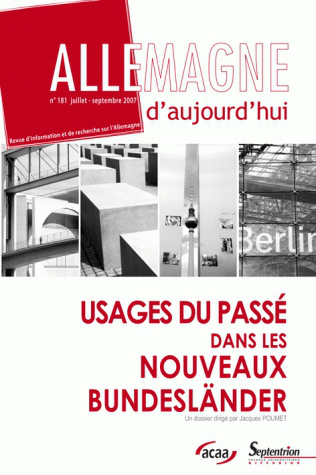Allemagne d'aujourd'hui, n°181/juillet - septembre 2007
Usages du passé dans les nouveaux Länder
First Edition
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui
- Title Part
-
Numéro 181
- Journal
- Allemagne d'aujourd'hui | n° 181
- ISSN
- 00025712
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations > Germanic and Scandinavian countries
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations
- Title First Published
- 01 July 2007
Paperback
- Publication Date
- 01 July 2007
- ISBN-13
- 9782859399894
- Code
- 1034
- Weight
- 270 grams
- List Price
- 11.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Excerpt
Editorial
Allemagne d'aujourd’hui se présente dans un nouveau format et avec une nouvelle parure. Il est toujours difficile d’abandonner une présentation à laquelle collaborateurs, abonnés et lecteurs s’étaient sans aucun doute habitués depuis maintenant plus de quarante ans. Nous nous étions habitués au caractère austère des décennies passées jusqu’à la prise de conscience, à force de remarques répétées, que nous manquions peut-être de modernité et d’attractivité pour un public plus jeune. Mais faut-il changer pour changer, et en changeant, nous transformons-nous ? Quel est le message de ce changement ?
En adoptant le format 16 x 24 à la française, nous avons d’abord eu un souci de lisibilité et d’économie : présenter, sans trop remplir les pages ou agrandir inconsidérément le pavé imprimé, plus de texte tout en rendant la lecture plus aisée. Le changement de format s’accompagne de ce fait d’une présentation plus aérée dans une police d’imprimerie moins classique que le times new roman pratiqué jusqu’à maintenant. La police « futura » est à la fois une merveilleuse ouverture sur l’avenir comme la promesse d’une lecture agréable. Mais le plus grand changement assurément, c’est la couverture qui emprunte à la précédente en conservant des traits de l’ancien titre, tout en introduisant pour la première fois un visuel et en renonçant délibérément à présenter la totalité du sommaire du numéro. Elle présente également un nouveau logo et un élément décoratif qui crée, avec son carré rouge finement cerclé d’un entrelacs de traits, un nouvelle équilibre toujours à la recherche de lui-même. Comme la couverture annonce la thématique du dossier que comprend aujourd’hui chacun de nos numéros, les autres articles se retrouvent sur le dos de la couverture qui est aussi travaillé que la première de couverture par le prolongement du visuel.
L’introduction d’éléments visuels est la plus grande nouveauté et représente le plus grand effort de modernisation. Il fallait que ce visuel soit un message convaincant de la politique éditoriale de la revue. Si l’Allemagne ne se réduit pas à Berlin encore moins que la France à Paris, nous avons pourtant choisi de ne choisir que des photos qui représentent Berlin. Cela mérite explication. Dans un souci de lisibilité esthétique pour éviter de brouiller le message en multipliant l’énumération des symboles des grandes villes allemandes, nous voulions placer ailleurs que dans la géographie la diversité de l’Allemagne. En choisissant Berlin, nous avons voulu également dédramatiser l’appellation de « République de Berlin » et montrer que l’Allemagne, à travers sa capitale retrouvée, ne cesse d’être une tension entre passé et modernité : c’est encore une façon de dire que le retour sur la scène mondiale de ce pays puissant ne signifie pas rupture d’équilibre et oubli du passé. Aussi la première page de couverture insère-t-elle entre les deux éléments d’architecture moderne que sont la nouvelle Gare centrale de Berlin et les bureaux du Bundestag les deux visages de l’Allemagne du 21e siècle. Le monument à la mémoire des juifs d’Europe rappelle la volonté du pays d’assumer son passé tandis que la tour de télévision de l’Alexanderplatz, photographiée entre les deux panneaux du monument érigé du temps de la RDA à la mémoire des mouvements de libération nationaux, témoigne du passé est-allemand qui subsiste dans l’Allemagne d’aujourd’hui. Bundestag et Gare centrale sont placés des deux côtés de la Spree qui séparait à cet endroit la RFA de la RDA, la passerelle dont on ne voit ici que le départ du côté « occidental » se lance pour enjamber la rivière et rejoindre l’arc que dessine les poutrelles du toit de la Gare située « à l’Est ». Au dos de la couverture, place est faite aux symboles plus connus : porte de Brandebourg, bâtiment du Reichstag avec sa coupole qui exprime le besoin de transparence de toute démocratie ; la « Bahn-Tower », la tour de la Deutsche Bahn du Potsdamer Platz, et la coupole rénovée du Musée Bode symbolisent le double besoin de modernité architecturale sobre et la restauration du passé prussien via le bien le plus précieux de tout pays, c’est-à-dire sa culture.
Nous changeons pour être plus attrayant et plus lisible sans concession à notre exigence d’explication de l’Allemagne d’aujourd’hui dans la totalité de ses dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles, et sans jamais oublier l’imbrication étroite entre le passé et le présent.
C’est à une jeune conceptrice imaginative de l’agence3C <www.agence3C.com>, Camille Lombardot, que nous devons la maquette de couverture et la charte graphique ; les photos sont l’œuvre d’un jeune photographe français talentueux qui évolue entre Berlin et Paris, Tristan Siegmann <www.tristansiegmann.com>. Nicolas Delargillière, des Presses universitaires du Septentrion, a transformé le concept en modèle opérationnel au quotidien tandis que Françoise Cokelaere a assuré la composition selon le nouveau modèle. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
– Jérôme Vaillant et Jean-Louis Georget –
Actualité sociale
Pendant le premier semestre 2007, la vie politique allemande a été dominée par le hiatus entre la visibilité accrue à l'extérieur grâce à la présidence tournante de l’Europe assurée par l’Allemagne et les difficultés de la grande coalition à s’accorder sur les réformes à entreprendre. Dans ce contexte, on peut saluer la persistance dans l’opinion d’une certaine bonne humeur, reflet de l’enthousiasme généré par le Mondial du football. Encore neuf mois après, on s’interroge sur les conséquences bénéfiques de cet événement hors du commun.
Compromis a minima dans le conflit sur le salaire minimal garanti
L’Allemagne ne connaît pas de salaire minimal garanti fixé par l’Etat et s’appliquant à l’ensemble des salariés de toutes les branches d’activité. Le seul domaine qui fait exception est le bâtiment, où une loi de 1996 a permis à l’Etat de fixer un minimum salarial à partir d’un tarif négocié par les partenaires sociaux ; le syndrome du plombier polonais avant l’heure, peut-être. Pour toutes les autres branches, le niveau des salaires est le produit des négociations entre les associations patronales et les syndicats, sans intervention de l’Etat, ce qui a deux conséquences : les salaires plancher peuvent varier de façon importante d’un secteur à l’autre, et les salariés non couverts par une convention collective de branche peuvent se trouver dans une situation de working poor, où le produit de leur travail ne leur permet pas de vivre. C’est ce qui a fait la une des médias il y a quelques mois, lorsqu’il est apparu que de nombreux travailleurs, notamment dans les nouveaux Länder, devaient se contenter d’un salaire horaire de 5 ¤ brut, voire moins, pour les coiffeuses par exemple, et ce dans un pays riche comme l’Allemagne. Déjà à l’époque de la négociation entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates pour former la grande coalition, en 2005, était en discussion le sujet de l’introduction d’un SMIC à l’allemande, cheval de bataille du SPD. Ils demandaient en l’occurrence qu’il soit fixé à un niveau inférieur à celui en vigueur en France : les sociaux-démocrates le voyaient à 7,50 ¤, alors que le nouveau parti à gauche du SPD, die Linke, exige 8 ¤.
Deux ans plus tard et après des mois de négociations acharnées, le SPD et les unions chrétiennes CDU et CSU sont parvenus fin juin à un compromis sur les bas salaires. Ce n’était pas joué d’avance, tant les positions étaient à l’opposé. Le compromis trouvé reflète d’ailleurs les forces respectives au sein de la grande coalition, les chrétiens-démocrates tenant le haut du pavé face à un parti social-démocrate sur la défensive. Alors que ces derniers souhaitaient l’introduction d’un salaire minimal garanti en généralisant la législation en vigueur dans le bâtiment à la plupart des branches, les chrétiens-démocrates, conscients, eux aussi, de la précarité d’un nombre croissant de salariés, privilégiaient la garantie d’un revenu minimum aux travailleurs par le biais de l’introduction de la subvention salariale. Ce procédé, qui existe déjà dans une certaine mesure dans le cadre de la réforme Hartz IV (voir Allemagne d’aujourd’hui 175/2006), prévoit le versement d’un complément salarial à tous ceux dont le revenu est inférieur à certaines limites. Les deux partis n’ayant pu s’entendre, la position commune finalement retenue prévoit d’étendre à une dizaine d’autres branches le règlement actuellement en vigueur pour le secteur du bâtiment. Pour certains secteurs dépourvus de convention collective, la grande coalition envisage de moderniser une loi de 1952 qui permet à l’Etat de fixer un salaire minimum après une concertation des partenaires sociaux avec le ministère fédéral du Travail. Même si les sociaux-démocrates ne croyaient guère à la possibilité d’un SMIC à la française, la déception est très grande dans leurs rangs. Elle est d’autant plus amère que les chrétiens-démocrates n’ont pas non plus accédé à leur demande de resserrer les dispositions sur les salaires contraires aux bonnes mœurs (sittenwidrige Löhne). La jurisprudence a défini ce concept comme des salaires qui seraient de 30 % inférieurs à ce qui se pratique localement. Le SPD souhaitait abaisser cette limite à 20 %, en y ajoutant une limite inférieure fixe pour mettre fin aux abus. Devant la position intransigeante de la CDU, les sociaux-démocrates, très en colère, ont déjà averti que le salaire minimal garanti ferait partie de leur thème de campagne pour 2009. Un thème porteur, car les sondages montrent qu’une grande majorité d’Allemands souhaite l’instauration d’un salaire minimum généralisé.
Le mini baby-boom : fantasme ou réalité ?
Une bonne nouvelle a fait le tour des médias au mois de mai. Selon une enquête de WELT ONLINE, le nombre d’enfants nés au premier trimestre 2007 aurait fait un bond de plus de 20%. L’étude menée dans 15 grandes villes fait état d’accroissements significatifs dans 12 villes sur 15, dont Brême -Nord avec 21 % et Cologne avec 15 %. Même l’Allemagne de l’Est, réputée pour sa démographie défaillante – avec un taux de fertilité de 1,1 enfant par femme comparé à 2 pour la France –, ne fait pas exception : Magdeburg enregistre un plus de 15,6 %, Erfurt de 12,5 %, même Berlin s’y met avec un accroissement de 5 % pour le trimestre, mais de 20 % pour le seul mois de mars. Pour ceux qui savent calculer, l’origine de ce miracle est évident. Neuf mois auparavant, en juin 2006, l’Allemagne a organisé la Coupe du monde de football, et le monde entier découvrait avec stupéfaction un pays joyeux et décontracté, prêt à faire la fête dans une ambiance chaleureuse, loin des clichés habituels qui lui collaient à la peau. Cette grande fête sportive avait suscité une vague d’optimisme dans le pays. De nombreux observateurs estimaient que le Mondial allait insuffler un nouvel élan à l’économie en stimulant la croissance et à la société en lui faisant découvrir les joies d’un patriotisme longtemps réprimé. Quoi de plus naturel, dès lors, que d’attribuer le nombre inhabituellement élevé de naissances au premier trimestre 2007 à l’effet Coupe du monde ?
Regardés de près, les chiffres de l’enquête du quotidien semblent toutefois reposer sur peu de choses. Pour prendre l’augmentation la plus spectaculaire, celle de Brême Nord : les 21 % se réfèrent à une population partielle de Brême, environ 20 % de la population totale de la ville, ce qui réduit d’autant l’impact annoncé. Le nombre total de naissances à Brême est en baisse depuis plusieurs années. S’y ajoute le fait que les bébés sont habituellement plus nombreux à venir au printemps que pendant les autres saisons : le phénomène observé serait-il purement saisonnier ? Les statistiques doivent être interprétées avec plus de discernement, exhortent certains spécialistes qui se réfèrent au bilan démographique que vient de publier Destatis, l’Agence fédérale de Statistiques. En 2006, 672 675 bébés sont nés en Allemagne, 1,9 % de moins qu’en 2005. L’année 2006 poursuit ainsi une tendance à la baisse entamée depuis les années soixante-dix et qui ne s’est interrompu brièvement que pendant les années 1996 et 1997.
Le mini baby-boom ne serait donc qu’un joli conte de fées, une barrière mentale érigée contre la menace du déclin démographique ? Le constat d’une légère remontée du nombre de naissances en Allemagne n’est pas écarté par les spécialistes. Si l’effet Coupe de monde est en effet difficile à prouver, certains estiment que la politique familiale du gouvernement pourrait avoir joué. L’allocation congé parental n’a certes été introduite qu’au 1er janvier 2007, trop tard pour être à l’origine du baby-boom, mais cette prestation avait déjà été discutée dans le cadre de la formation de la grande coalition en 2005 et intégrée au projet de gouvernement. Rappelons qu’elle est nettement plus généreuse que l’allocation à laquelle elle se substitue : 67 % du dernier salaire, avec un maximum de 1 800 ¤ par mois, pendant 12, voire 14 mois, si le père participe, au lieu d’une somme forfaitaire mensuelle de 300 ¤. Avec cette mesure, ainsi que d’autres à venir, comme l’amélioration de l’accueil de la petite enfance, la ministre, Mme von der Leyen, espère faire passer le taux de fertilité, de 1,4 enfant environ par femme actuellement, à 1,7 à l’horizon 2015. Y parviendra-t-elle ? Les exemples de politiques familiales offensives sont contradictoires : du temps de la RDA, la fertilité s’est accrue avec l’introduction de mesures en faveur des mères, dans les pays scandinaves aussi, mais de façon très passagère. Le débat actuel montre peut-être qu’un changement de mentalités est en train de s’opérer en Allemagne.
Tests de paternité
Depuis plusieurs années, l’Allemagne se déchire sur le recours aux tests de paternité. Au printemps, le Tribunal constitutionnel a alimenté le feuilleton de son côté. Depuis que les tests ADN, qui établissent – ou infirment – la filiation avec certitude, sont devenus financièrement accessibles, les demandes affluent. Il suffit d’envoyer un cheveu ou un coton tige imbibé de salive à un des nombreux laboratoires qui proposent leurs services sur Internet ou sur les publicités qui s’étalent jusque dans le métro de Berlin pour avoir la confirmation que l’enfant est ou n’est pas celui du père juridique. En 2003, il paraît que 50 000 tests de ce genre ont été effectués en Allemagne, un chiffre qui n’est certes pas en recul, depuis que des informations, difficilement vérifiables, affirment qu’un enfant sur dix n’est pas le descendant génétique de son père. Un test sur quatre serait négatif et démentirait la paternité revendiquée par la mère de l’enfant. En janvier 2005, premier rebondissement : la Cour de justice fédérale de Karlsruhe (Bundesgerichtshof, BGH) a décidé que le test n’a aucune valeur juridique. Elle a ainsi débouté deux pères qui avaient introduit devant le tribunal une procédure de contestation de paternité après avoir découvert, à la faveur d’un test effectué à l’insu de la mère de l’enfant, que celui-ci n’était pas le leur. Le véritable problème, pour la ministre de la Justice, Brigitte Zypries, réside toutefois ailleurs. Le test permettrait en effet d’accéder aux données génétiques de l’enfant – qui n’a guère pu donner son accord –, et même partiellement à celles de ses parents, dont la mère, souvent également ignorante de la démarche de son conjoint. La procédure tomberait donc sous le coup d’une loi en préparation qui vise à protéger les données génétiques des personnes contre toute intrusion dans la sphère intime des individus. C’est peu dire que les labos ne partagent pas cet avis !
On ne peut contester le fait que le test de paternité a aussi des motifs matériels. Le régime des pensions alimentaires pour enfant, très strict en Allemagne, ne dépend que du revenu du père. Puisqu’il ne peut pas apporter la preuve de l’absence de filiation sans le consentement de la mère, il se voit contraint de verser une pension même s’il est avéré que l’enfant n’est pas de lui. Les tribunaux entrouvrent à peine la porte pour remédier à cette situation. Le père devra dorénavant apporter des « éléments de preuve » suffisants aux tribunaux pour que ceux-ci entament une procédure et ordonnent eux-mêmes un test de paternité. L’expérience a prouvé que c’est extrêmement difficile. Non content d’interdire la reconnaissance des tests de paternité obtenus à l’insu de la mère en justice, le ministère a décidé d’introduire une loi qui punirait le père – d’un an de prison – qui demanderait un tel test ; les laboratoires qui l’effectueraient seraient également poursuivis. Les groupements féministes étaient à l’origine de ce projet de loi. Constatant l’explosion du nombre de tests de paternité, ils ne souhaitaient pas que le conjoint puisse faire appel à la science pour se soustraire à ses obligations financières. Les partis, eux, sont divisés. La droite chrétienne, qui protège le patrimoine et défend le droit du sang, soutient majoritairement le droit du père à contrôler sa paternité. Les Sociaux-démocrates et les Verts sont plus partagés, certains estimant que la loi protégera les enfants, d’autres considérant que l’alternative judiciaire au test interdit risquerait de compliquer plutôt que de faciliter les problèmes. Devant le tollé suscité par cette mesure – 80 % des hommes seraient partisans du libre accès aux tests de paternité –, le gouvernement a renoncé à la mise en œuvre d’une loi répressive.
Grèves à la Deutsche Bahn
Au mois de juillet, le transporteur ferroviaire Deutsche Bahn a connu son plus fort mouvement de grèves depuis 2003. Les négociations salariales entamées le 18 juin n’ayant pas abouti, les syndicats Transnet et GDBA ont appelé les salariés à prendre part à des grèves d’avertissement à compter du lundi 2 juillet. Le lendemain, le syndicat des conducteurs de trains GDL s’est mis de la partie. En Allemagne, les salariés ne peuvent pas faire grève quand ils veulent ; ils n’en ont la possibilité que dans le cadre de négociations salariales et lorsque l’accord précédent est arrivé à expiration, ce qui est le cas dans ce conflit. Au début des négociations, les positions des partenaires sociaux étaient très éloignées, les syndicats réclamant une augmentation salariale pour les 134 000 cheminots de 7 % ou au moins 150 ¤ de plus par mois, alors que la Deutsche Bahn proposait une augmentation de deux fois 2 % étalée sur une période de 30 mois et une prime unique de 300 ¤. Le syndicat des conducteurs de trains, pour sa part, a exigé une augmentation beaucoup plus importante, avec des hausses allant jusqu’à 31 %, ainsi qu’un accord salarial spécifique. GDL, qui ne s’est pas privé d’étaler ses doléances dans tous les médias, estime qu’un conducteur de train porte une responsabilité particulièrement lourde et devrait être rémunéré en conséquence. Le salaire d’un conducteur débutant se situe actuellement à 1 500 ¤ net par mois, et GDL souhaite le faire passer à 2500 ¤.
Les premiers débrayages ont touché surtout le sud-ouest et l’est du pays. Parmi les principales gares concernées ont figuré Dortmund, Francfort, Cologne et Karlsruhe à l’ouest, Hambourg au nord, Munich au sud et Rostock à l’est. Ils concernaient principalement les trains à grande vitesse ICE, mais les lignes régionales n’étaient pas épargnées, conduisant à des retards très importants pour des millions de voyageurs. Si les syndicats ont l’habitude de publier la veille les débrayages du lendemain, les grèves d’avertissement ont néanmoins conduit à de multiples perturbations du trafic ferroviaire, ce qui n’a pas manqué de produire l’effet escompté : les partenaires sociaux ont décidé de reprendre les négociations. Jeudi 5 juillet, le patronat a décidé d’améliorer son offre. Il a proposé 3,4 % d’augmentation salariale à partir du 1er janvier 2008 pour une durée de 24 mois ainsi qu’un versement unique de 450 ¤. La Deutsche Bahn refuse toutefois de considérer un accord salarial spécifique pour les conducteurs de trains, ne souhaitant pas départager son personnel en « salariés de première et de deuxième classe ». Elle souhaite désormais une fin rapide à ce conflit qui porte un grave préjudice financier, de l’ordre de 10 millions d’euros par jour, à la société. Les syndicats, de leur côté, se disent prêts à entamer une grève illimitée, s’il le faut, pour obtenir satisfaction. La croissance économique aidant, les Allemands sont de moins en moins disposés à se satisfaire de la stagnation de leur pouvoir d’achat qui a prévalu ces dernières années outre-Rhin.
Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord le 7 juillet. La Deutsche Bahn et les syndicats GDBA et Transnet ont établi un compromis qui prévoit une augmentation des salaires de 4,5 % ainsi qu’un versement unique de 600 ¤. L’accord a une durée de 19 mois, jusqu’au 1er janvier 2009. Le syndicat des conducteurs de train n’a pas participé aux négociations.
Le château des Hohenzollern sera reconstruit à Berlin
Le château des Hohenzollern est de retour dans l’actualité. Le 4 juillet 2007, cinq ans, jour pour jour, après que le Bundestag, dans un vote historique, se soit prononcé en faveur de la reconstruction du château des Hohenzollern, le gouvernement allemand a enfin bouclé le dossier financier. Cet automne, un concours d’architectes sera lancé pour lequel on attend des centaines de propositions du monde entier. Le début des travaux est prévu pour 2010, à commencer par les trois façades baroques, pour une livraison, si tout va bien, vers 2013. Le bâtiment immense au cœur de Berlin abritera sur quelque 50 000 m2 de surface les œuvres d’art du musée ethnologique de Dahlem, dans la banlieue de Berlin, une bibliothèque et les collections scientifiques de l’Université Humboldt. Y sont également prévus des magasins, des restaurants, des salles de spectacles et de conférences. La renaissance de ce chefd’œuvre du baroque protestant n’allait pourtant pas de soi. Construit à partir de 1699 à la demande du futur roi de Prusse, Frédéric I, il a été le témoin d’un passé mouvementé. C’est du balcon du château des Hohenzollern que l’empereur Guillaume II a exhorté son peuple à l’aube de la Première Guerre Mondiale. Karl Liebknecht y proclama l’avènement de la République socialiste de Weimar en 1918. A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, en février 1945, le château a été sévèrement endommagé. Situé dans la partie Est de la ville, il a fini par être dynamité en 1950 sur ordre de Walter Ulbricht, premier secrétaire du parti estallemand SED. Vingt-cinq ans plus tard, en 1976, son successeur, Erich Honecker, y a fait construire le Palais de la République, un cube de verre fumé au goût douteux, qui a accueilli la Volkskammer, parlement de la RDA. C’est là que l’unification de l’Allemagne a été votée le 23 août 1990 par l’assemblée est-allemande, pour la première fois librement élue. Un mois plus tard, le bâtiment a dû fermer ses portes pour désamiantage.
Les premières demandes de résurrection du château des Hohenzollern datent des années soixante-dix, du temps de la RDA donc. Après la chute du mur, des voix se sont élevées pour appeler à la reconstruction du bâtiment initial. En 1992, un commerçant de Hamburg, Wilhelm von Boddien, créa l’association de soutien Schlossverein pour pousser le projet. Mais ce n’est qu’après que le gouvernement s’en soit saisi pour y créer le Forum Humboldt, que le projet a véritablement pu prendre corps. Le gouvernement fédéral débloquera 448 des 480 millions ¤ requis, la ville de Berlin, notoirement endettée, financera le reste. Après tant d’années d’attente, un symbole de la RDA laissera la place à un bâtiment qui représente pour les Allemands peut-être une forme de réconciliation avec leur passé.
– Brigitte LESTRADE –
Brigitte.Lestrade@u-cergy.fr
Ostalgie ou utopie ? La mémoire « close » des nostalgiques de la RDA
Résumé
Ce texte a pour objectif de revenir sur la notion d' " ostalgie " à partir d'une étude portant sur d'anciens hauts fonctionnaires du SED nés avant 1939 et qui, de par leur position à priori de " perdants " de la réunification, sont les plus susceptibles de regretter la RDA. L'ostalgie, et en amont la " nostalgie ", sont analysées dans un premier temps afin de décrypter les différents sens et connotations qu'elles ont pu prendre depuis leur création. Les deux autres parties de l'article sont consacrées au résultats de l'enquête de terrain et permettent de mieux cerner le sentiment de manque éprouvés par des personnes attachées à un pays et un régime aujourd'hui disparus. La reconstitution de réseaux d'anciens collègues et leurs sources communes d'information leur permet de maintenir une vision du monde qui oscille entre utopie et nostalgie. Sans renoncer à leurs idéaux socialistes mais aussi sans espoir de ressusciter la RDA, ils poursuivent ainsi une " utopie rétrogressive ", selon le concept de Jean Séguy.
Zusammenfassung
Ziel dieses Beitrags ist es, ausgehend von einer Studie über ehemalige SED-Kader, die vor 1939 geboren sind, aufgrund ihrer politischen Funktionen a priori zu den „Verlierern" der Vereinigung gehören und sich daher am ehesten nach der DDR zurücksehnen, neu über den Begriff der „Ostalgie“ nachzudenken. In einem ersten Schritt werden der Sinn sowie die verschiedenen Konnotationen untersucht, die mit den Ausdrücken „Ostalgie“ sowie zuvor „Nostalgie“ seit ihrer Entstehung verbunden werden. Die beiden anderen Teile des Artikels sind den Ergebnissen der Felduntersuchung gewidmet und beschreiben das Gefühl des Verlustes derjenigen, die von der Verbundenheit mit einem Land und einem politischen System geprägt sind, das heute verschwunden ist. Aufbau und Pflege von Kontakten zu ehemaligen Kollegen sowie der gegenseitige Austausch von Informationen erlauben es den ehemaligen SED-Kadern, ihre Weltanschauung aufrecht zu erhalten, die zwischen Utopie und Nostalgie schwankt. Ohne ihre sozialistischen Ideale aufzugeben, aber auch ohne an eine Wiederherstellung der Verhältnisse der DDR zu glauben, verfolgen sie somit eine " retrogressive Utopie " im Sinne von Jean Séguy.
Mémoire collective de la fuite et de l’expulsion, une mémoire (ré)unifiée ?
Mémoire collective allemande de la fuite et de l'expulsion, une mémoire (ré)unifiée?
Le tournant amorcé depuis 1989 sur le plan de la mémoire collective allemande pose la question de l’héritage de la politique mémorielle est-allemande et marque le début d’une réflexion nationale autour de l’élaboration de " lieux de mémoire " communs aux Allemands de l’Est et de l’Ouest. Le cas de la mémoire de la fuite et de l’expulsion des Allemands au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui connaît aujourd’hui une forte conjoncture dans le débat public, constitue un exemple pertinent pour interroger la " réunification " des mémoires est- et ouest-allemandes. En effet, le traitement de cette mémoire fut radicalement différent en RDA et RFA. La mémoire de la fuite et expulsion apparaît comme le prototype d’une mémoire " blessée " (Ricœur) au sens de manipulée, instrumentalisée à des fins politiques, et ce jusqu’au tabou officiel décrété en RDA. Après une présentation synthétique de ces différences Est / Ouest sur le plan du traitement officiel de cette mémoire, l’étude empirique de la mémoire communicative de cet évènement dans les familles d’expulsés permettra de se pencher sur l’impact de ces politiques mémorielles et sur l’existence de différences Est / Ouest au niveau de la mémoire privée de la fuite et expulsion à l’heure actuelle.
Das deutsche kollektive Gedächtnis an Flucht und Vertreibung, ein wiedervereinigtes Gedächtnis ?
Die Wende von 1989 markierte einen Wendepunkt auf der Ebene der deutschen Erinnerungskultur, der die Frage nach gesamtdeutschen Erinnerungsorten angesichts der Erbe einer spezifischen ostdeutschen Erinnerungskultur neu stellte. In diesem Rahmen ist der besonderer Fall der Erinnerung an Flucht und Vertreibung besonders geeignet, um die Vereinigung der ost- und westdeutschen kollektiven Gedächtnisse zu analysieren, da mit diesem Thema in der BRD und der DDR völlig anders umgegangen wurde. Das kollektive Gedächtnis an Flucht und Vertreibung erscheint sogar aufgrund seiner starken politischen Instrumentalisierung bis hin zur Tabuisierung als Prototyp eines „verletzten" Gedächtnisses (Ricoeur), eines „traumatischen“ Erinnerungsorts (Aleida Assmann). Nach einer synthetischen Darstellung der unterschiedlichen Erinnerungspolitiken in Ost und West vor 1989, werden anhand einer empirischen Analyse des kommunikativen Gedächtnisses an Flucht und Vertreibung in Vertriebenenfamilien das Erbe dieser Politiken und die aktuellen Unterschiede zwischen Ost und West untersucht.
Les notes de lecture
Livres sur la littérature et l'art
Ursula Welsch/Dorothee Pfeiffer, Lou Andreas-Salomé, Eine Bild-Biographie, Reclam-Leipzig, 2006, 200 p.
Un ouvrage du genre « Bild-monographie », avec plus d’images que de textes, issus pour la plupart de son Lebensrückblick, édité en 1951 seulement. Un nom célèbre, pour une existence riche en contacts (1861- 1937) : Lou pour Lolja, Andreas par son mari, Salomé par son père, général du tsar. En sept chapitres, nous suivons son itinéraire européen : Saint-Pétersbourg, Zurich, Rome, Berlin, Paris, Vienne, Göttingen où elle mourut. Elle eut plus d’admirateurs que d’amants, le plus connu étant Rilke. Elle fut (avec Malwida von Meysenbug) une des plus illustres « féministes », grâce à ses études à Zurich (seule université, à l’époque, accessible aux femmes), son rôle dans des cercles philosophiques (avec Nietzsche) et dans la « vulgarisation » des acquis de la psychanalyse (elle fut l’élève de Freud et exerça le métier de son maître). Une biographie lui fut consacrée en 1988 par U. Welsch. Ce livre l’illustre avec bonheur.
Bloch, eine Bildmonographie, édité par le Ernst-Bloch-Zentrum, Suhrkamp, Francfort, 2007, 217 p.
Ce livre ne pourra pas servir d’introduction à la pensée et à l’œuvre du grand philosophe du 20e siècle que fut Ernst Bloch (1885-1977). Mais il accompagnera avec réussite toute (re)lecture des textes et articles de Bloch, réunis dans l’édition de ses Gesammelte Werke chez Suhrkamp (quatorze volumes). Il y eut plus d’une « carrière » dans la longue vie de cet homme singulier, né sous l’empire wilhelminien à Ludwigshafen et mort finalement en RFA, à Tübingen. Un grand nombre de photos et de témoignages restituent le climat de ces différentes phases combatives de l’histoire de l’Allemagne, où il fut un acteur de premier plan. On y retrouve Mannheim, Munich, Berlin, Heidelberg, puis Zurich, Prague et New York. On y rencontre Lukacs, Max Weber, Klemperer, Adorno, Benjamin, Kracauer, Kurt Weill et Brecht. On s’intéressera plus particulièrement à sa période de près de dix ans en RDA, où il fut professeur de philosophie à l’université de Leipzig, en même temps que le germaniste Hans Mayer. Il y fut « mis à la retraite d’office » en 1957… après avoir été honoré d’une « croix du mérite en argent ». Il ne rentra pas en RDA avec la construction du Mur, reprit ses activités pédagogiques à Tübingen et accompagna les mouvements étudiants en 1968. Sur ses dernières photos, il figure avec Rudi Dutschke, Günter Grass et Wolf Biermann. Cette biographie illustrée de « l’homme à la pipe » figurera avec bonheur aux côtés des autres livres sur la « Kulturgeschichte » d’une Allemagne divisée par essence.
Rainer Stamm, « Ein kurzes intensives Fest », Paula Modersohn-Becker, Eine Biographie, Reclam,Stuttgart, 2007, 259 p.
Cette publication vient à son heure pour rappeler la vie et l’œuvre d’une figure peu connue en France : la grande femme-peintre du groupe dit de Worpswede. La ville de Brême lui consacre cette année une exposition méritée : « Paula in Paris – von Cézanne bis Picasso ». Une vie brève (1876-1907), avec une naissance à Dresde, un séjour à Berlin, son union avec le peintre Otto Modersohn, sa vie au sein du groupe d’artistes de Worpswede, de fréquents voyages à Paris. Elle y a connu Rilke, Rodin et les créateurs de la peinture moderne de Cézanne à Picasso. Ses œuvres (portraits, natures mortes, paysages) portent la marque de ces rencontres, mais avec une grande originalité dans le dessin et le contraste des couleurs. Seize reproductions (surtout du musée de Brême) en témoignent.
Hiltrud Häntzschel, Marieluise Fleißer, Eine Biographie, Insel, Francfort, 2007, 411 p.
Il n’existait pas, jusqu’à présent, de biographie de Marieluise Fleißer (1901-1974), alors que son œuvre (théâtre, récits, essais) avait fait l’objet de nombreuses études, avant et après la publication de ses Gesammelte Werke (4 volumes, Suhrkamp, éditée par Günther Rühle, 1972, complétée en 1992). En dix chapitres précis et documentés, l’auteure évoque le destin et l’entourage de celle qui fut découverte et protégée par Brecht, avant d’être abandonnée, puis soumise à l’interdiction d’écrire par le régime nazi et reléguée dans l’oubli par la RFA, avant sa redécouverte par Fassbinder et Kroetz au début des années soixante-dix (reprise de ses « pièces d’Ingolstadt », Pioniere et Fegefeuer). Tous les éléments d’une bonne biographie sont ici réunis (correspondance, iconographie, échos de l’époque). Une riche moisson pour germanistes et gens de théâtre. A (re)signaler : la publication par les Presses universitaires du Mirail de la pièce dense et émouvante de Kerstin Specht, Marieluise, créée en allemand à Toulouse, en 2005, par J.-P. Confais.
Du côté des traductions
Bertolt Brecht, Manuel pour habitants des villes, poèmes, L’Arche, Paris, 2006, 180 p.
Il s’agit en fait d’une anthologie de cent poèmes de Brecht, portant le titre d’un volume publié en 1927. Les poèmes ici rassemblés ont été écrits entre 1916 et 1956, la plupart ayant été traduits dans l’édition déjà ancienne des Poèmes publiée par L’Arche, en 9 volumes, à partir de 1968. Une grande part est faite aux poèmes du « jeune Brecht » (tendance expressionniste manifeste), mais la suite chronologique inclut aussi les poèmes de l’exil et de la présence de Brecht en RDA (tendance politique, évidente ou cryptée). A côté des grands classiques (Questions d’un ouvrier qui lit) on trouvera des textes plus intimes sur les amours de Brecht. Livre très utile pour rappeler que Brecht fut à l’origine « Lyriker » et le resta jusqu’à sa mort (Dans la chambre de La Charité).
Bertolt Brecht, L’Uppercut et autres récits sportifs, L’Arche, Paris, 2006, 157 p.
Là aussi, une anthologie de vingt-huit textes courts, écrits vers la fin des années vingt, quand Brecht s’adonnait à la « nouvelle objectivité » et fréquentait des boxeurs, comme le célèbre Samson Körner. Partant du sport, Brecht en arrive vite à parler de théâtre, de son théâtre et des spectateurs qu’il souhaite attirer, ainsi que des comédiens « sportifs » qu’il désire. Par là, il livre les ressorts de sa dramaturgie (à l’époque : Dans la jungle des villes, Un homme est un homme, Mahagonny). Ce recueil comporte quelques inédits en langue française.
Georg Büchner, Léonce et Léna, texte français de Bruno Bayen, 2007, 75 p.
Ce n’est pas la première traduction de la célèbre comédie désenchantée de Büchner. D’autres plumes célèbres s’y sont essayées (Marthe Robert, Jean-Louis Besson). Bruno Bayen fait partie des traducteurs-metteurs en scène, on lui doit aussi des textes français de Lukas Bärfuss, Fassbinder et Handke. Cette édition nouvelle et maniable rendra des services dans les classes où le théâtre est au programme.
Livres sur l’histoire et la civilisation
Gunnat Hinck, Eliten in Ostdeutschland, Ch. Links, Berlin, 2007, 214 p.
Le Ch. Links Verlag de Berlin s’est taillé une place particulière dans l’étude du passé et du présent de la RDA/Allemagne de l’Est. Ce livre présente une quinzaine d’interviews/ biographies de personnalités en position d’influer sur la vie politique, au sens large, des « nouveaux Länder ». On y trouve des « natifs » de la RDA et des « occiden- taux » venus aider les cinq Länder de cette entité devenue malgré elle cet « Est de l’Allemagne » victime d’une double hémorragie des élites, suscitée par l’épuration de l’après-1945 et celle de l’après-1989. L’auteur est journaliste et politologue, il interroge, puis commente les dépositions de députés, de ministres, de juges, d’industriels, de maires, de collègues journalistes sur l’esprit du temps qui prévaut à l’est de l’Elbe. Son introduction mesure les incertitudes qui pèsent sur le destin des quelque seize millions de « Bundesbürger » déstabilisés par les quarante années du régime SED et les bientôt vingt ans de transplantation du régime « économie sociale de marché ». Rien ne vaut ce vécu authentique, narré le plus souvent à la troisième personne, pour comprendre la complexité de la situation. Le tout se lit avec plaisir et joie d’apprendre.
Helga Schultz, Hans-Jürgen Wagener (éd.), Die DDR im Rückblick, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Ch. Links, Berlin, 2007, 336 p.
Le sous-titre de ce recueil de quatorze articles reprend celui de notre revue. Ses auteurs sont professeurs à l’Europa-Universität Viadrina, de Francfort/Oder, ou au Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschung (un peu l’équivalent de celui de Munich). Le temps est sans doute venu d’un « regard rétrospectif » et objectif sur la DDR, près de vingt ans après sa disparition. Il ne s’agit pas d’une histoire au sens strict, mais chaque sujet est bien traité de façon chronologique. Quelques exemples : le pouvoir, les Eglises, la Stasi, l’économie planifiée, la société rurale, l’art soumis à une vision du monde. C’est la meilleure synthèse des travaux entrepris après la chute du Mur.
Elle sera utile pour chacun des spécialistes concernés et pour l’enseignement de la civilisation allemande. Bibliographies et illustrations sont à la hauteur.
Berlin, Die Zwanziger jahre, Kunst und Kultur, 1918-1933, DTV, Munich, 2007, 400 p.
Voici un livre sur les fameuses « années folles » où Berlin fut vraiment une « Weltstadt ». Il devrait connaître un grand succès à cause de la richesse de son iconographie : pas une page qui ne soit illustrée d’une photo, d’un portrait, d’une reproduction. La culture est prise ici au sens large, puisqu’elle englobe tout autant la publicité, le design, la mode que l’architecture, le cinéma, la peinture, le théâtre et la danse. La conception des chapitres n’est pourtant pas générique, mais historique (textes de Rainer Metzger). Dix chapitres suivent le cours du temps, avec une introduction sur « Die Stadt als Parvenü », et une conclusion sur la capitale du Reich devenue le centre de l’horreur nazie. Les grands courants esthétiques servent de fil conducteur : l’expressionnisme, le dadaïsme, le vérisme, la « nouvelle objectivité ». La plupart des photos (souvent au format de deux pages) sont peu connues, puisées dans les riches fonds des éditeurs, théâtres, agences, etc. Un seul exemple : le passage du zeppelin au-dessus de la Porte de Brandebourg, avec son avenue couverte de voitures. Une quinzaine de pages de « courtes biographies », suivies d’un index, permettent de retrouver facilement tel ou tel protagoniste de la vie politique et culturelle. Un livre passionnant, à feuilleter ou à scruter, le seul qui, jusqu’ici, donne l’impression de faire revivre cette époque dans une ville fabuleuse, qui en verra bien d’autres.
Comptes rendus
Béatrice Angrand, en collaboration avec Aurélie Marx, L’Allemagne, Le cavalier Bleu (Paris, 2006).
Comment faire tenir en 124 pages les idées reçues sur l’Allemagne et leurs correctifs – tel est le programme de ce petit ouvrage à offrir à des amis qui voudraient découvrir le pays, sa culture et son histoire rapidement ou à d’autres qui voudraient mettre à l’épreuve leurs propres préjugés. Le livre se découpe en trois grands chapitres, avec un propos introductif et une conclusion. Les trois grands thèmes abordés sont l’histoire, l’économie, la société. Chaque chapitre est subdivisé en sous-chapitres qui ont pour sujet des idées reçues sur l’Allemagne comme par exemple : les Allemands aiment l’ordre ; les Allemands ne sont pas raffinés ; l’allemand n’est pas une langue attractive, etc. ... On pourra regretter certaines coquilles histori- ques, on s’attardera plus sur le message des auteures, Béatrice Angrand, conseillère pour les relations franco-allemandes chez ARTE, et Aurélie Marx, normalienne, agrégée d’allemand. Elles insistent sur l’importance du couple franco-allemand, de la « Deutsch- Französische Freundschaft » en Europe, laquelle doit passer par l’« ardente obligation » d’une « connaissance bienveillante ». Vaste et intéressant programme en effet.
– Martine BENOIT –
Birgit Dahlke, Jünglinge der Moderne. Jugendkult und Männlichkeit in der Literatur um 1900 Köln, Böhlau Verlag, 2006, 273 p.
Principalement connue pour ses travaux sur la littérature de RDA, et notamment les auteures non-officielles des années 1980, Birgit Dahlke se consacre dans sa thèse d’habilitation à la littérature du « fin de siècle » et plus particulièrement à l’alliance entre « culte de la jeunesse » et masculinité à cette époque. Le sous-titre de l’ouvrage est d’ailleurs trompeur, à moins d’entendre par littérature, de prime abord, un ensemble beaucoup plus vaste que les belles-lettres. En effet, dans une approche culturaliste reflétant l’actuel « cultural turn » des études germaniques en Allemagne, Dahlke élargit son corpus audelà de la « littérature » pour tenir compte aussi bien des discours pédagogiques et psychologiques que des œuvres de la philosophie culturelle ou des études sur la sociologie de la jeunesse de l’époque. Le texte littéraire devient une source de l’histoire culturelle parmi d’autres. Et pour cause : selon l’auteure, l’extrême valorisation de la jeunesse (masculine et bourgeoise) suite à la modernisation de la société, et la crise de l’identité masculine liée à l’émancipation de la femme qui se fait sentir parallèlement, ne peuvent s’expliquer qu’en recourant aux textes littéraires qui en font leurs sujets. Les différents discours se chevauchent, s’entrecroisent ou entrent en conflit ; texte et contexte entrent dans un « rapport dynamique » et font apparaître toutes les dimensions de la tension entre « espérance » et « conscience de crise » qui caractérise le discours sur la jeunesse du « fin de siècle ».
Le cadre théorique pour les deux concepts clé de l’ouvrage, « masculinité » et « jeunesse », provient d’une part des théories sur la masculinité circulant depuis les années 1970 – en cela Dahlke reste fidèle aux approches « gender » qui ont marqué ses travaux antérieurs. D’autre part, en ce qui concerne le concept de « jeunesse », Dahlke le considère comme un « symbole agrégé » (aggregiertes Symbol), concept forgé dans un contexte idéologiquement très marqué par le philosophe cybernéticien est-allemand Georg Klaus dans son ouvrage « Sprache der Politik » (1971) et récemment réintroduit dans le débat littéraire par Dieter Schlenstedt. Sans pouvoir discuter la pertinence de ce concept et son emprunt à un ouvrage fortement marqué, il est intéressant de voir qu’il y a depuis quelque temps comme une volonté de la part de chercheurs est-allemands d’introduire et de faire valoir dans le discours scientifique actuel des concepts et notions forgés à l’époque de la RDA.
Revenons au contenu du livre. Dans une première partie, Dahlke fait le tour des débats de l’époque concernant la « jeunesse », en passe de devenir un véritable mythe. Entre catégorie esthétique et vecteur de la critique culturelle contre la tradition, l’ancien et les pères, la « jeunesse » devient la « signature » d’une époque en changement où les techniques médicales du rajeunissement côtoient des mouvements comme la réforme de l’existence (Lebensreform), Wandervogel ou le nudisme, donnant tous une première importance à la « jeunesse ». Outre le fait de passer en revue l’histoire du concept de jeunesse et de s’intéresser à l’histoire sociale, l’auteure se consacre au discours de la psychologie sur le danger de l’adolescence (Stanley Hall), au (non)traitement de l’adolescence dans la psychanalyse (Freud) et aux conceptions androgynes de la jeunesse.
Les analyses de la deuxième partie se consacrent principalement à la littérature. D’abord, Dahlke cerne la « rhétorique de l’épuisement et de la fatigue » telle que l’on peut l’apercevoir dans le roman de l’adolescence. Les jeunes protagonistes échouent dans des situations de crise, reflétant les peurs de la modernisation et l’expérience de la rupture propre à l’époque. Parmi les auteurs étudiés, on trouve aussi bien Max Halbe, Emil Strauß et Friedrich Huch que Hesse, Wedekind, Musil et Mann. Une autre analyse littéraire est consacrée à Stefan George et son cercle ainsi qu’à Rudolf Borchardt. Alors que la littérature relaye le thème de l’épuisement et de la fatigue, on peut apercevoir comme un contre-mouvement dans l’art nouveau, notamment avec l’artiste Fidus qui réagit par un « pathos de l’éveil » et un culte de la lumière. D’autres sous-chapitres éclairent les ruptures dans la narration généalogique, lorsque la position du père n’est plus qu’une lacune, ou encore la crise de la « narration paternaliste », le caractère « efféminé » de la narration s’exprimant par la perte de l’unité et par la dissolution de la perspective centrale. Sont convoqués les exemples d’Arthur Schnitzler et de Robert Walser. Que les topoï jusque-là évoqués d’une jeunesse fatiguée, en crise et en rupture avec les pères concernent principalement les couches aisées de la société devient particulièrement visible lorsque Dahlke se penche sur la littérature ouvrière (Hans Marchwitza, Willi Münzenberg). Ici, les conditions sociales sont telles que la généalogie et l’expérience sont encore porteurs de sens et même nécessaires pour la survie au quotidien. Il n’y a pas de place pour le conflit entre pères et fils et l’expérience propre de la jeunesse est d’abord d’être ouvrière, et ensuite jeune.
Dans sa dernière partie, Dahlke expose les différents discours qui réagissent avec des « stratégies de virilisation » (Ermannungsstrategien) aux phénomènes de déstabilisation liés à la modernité, c’est-à-dire la perte de la masculinité et la féminisation. Rentrent ici en compte l’œuvre d’Otto Weininger, à la fois misogyne et antisémite, et les écrits de Hans Blüher, responsable de l’idéologie du mouvement Wandervogel, une communauté masculine où un Führer charismatique remplace la fonction du père et dont sont issus dès 1915 les milices des « Freikorps ». D’autres études concernent les topoï de la masculinité et de la guerre (chez Rilke, Hans Breuer – « Zupfgeigenhansel » – et Walter Flex), ou encore celui de l’aventurier (Georg Simmel, Fridtjof Nansen). Deux chapitres sont consacrés à Siegfried Bernfeld, futur théoricien de l’éducation antiautoritaire, et à Walter Benjamin dont on connaît l’engagement dans la « Jugendkultur-bewegung ». L’étude de Birgit Dahlke, innovatrice par le croisement interdisciplinaire de deux concepts clé du « fin de siècle », « jeunesse » et « masculinité », est d’une très grande richesse aussi bien intellectuelle que documentaire. Non seulement l’auteure suit les discours de l’époque dans les moindres détails, mais elle mentionne et commente également l’abondante littérature critique sur le(s) sujet(s). C’est là que parfois l’on perd de vue les thèses centrales du livre qui, vu l’ampleur du corpus, aurait gagné à établir des liens supplémentaires entre les différents sujets traités.
– Carola HÄHNEL-MESNARD –
Theodor LESSING. – Nachtkritiken – Kleine Schriften 1906-1907. Hrsg. Von Rainer Marwedel, Göttingen (Wallstein) 2006, 620 p.
En 1990 Rainer Marwedel s’est vu décerner le prix Carl von Ossietzky, la ville de Oldenburg désirant saluer ainsi l’engagement et les recherches de ce spécialiste en Sciences Politiques et Sociales concernant Theodor Lessing. De cet auteur inclassable, publiciste, essayiste, professeur de philosophie, écrivain, psychologue, on ne retient désormais que le seul titre d’un livre, Der jüdische Selbsthass, paru en 1930, et la terrible fin, l’assassinat dès le 30 août 1933 dans le refuge de Marienbad par des hommes de mains des nazis. Rainer Marwedel nous propose avec cet ouvrage composé essentiellement de critiques théâtrales une facette méconnue de Theodor Lessing – mais on retrouve le même ton intransigeant et la même plume acérée que dans les articles et essais regroupés par Rainer Marwedel en 1986 sous le titre Ich warf eine Flaschenpost ins Eismeer der Geschichte – Essays und Feuilletons (Luchterhand, Darmstatd). On prendra plaisir à lire de nombreux développements sur Carla Mann, sur son frère Heinrich aussi, sur Hugo von Hofmannsthal. Des pièces de Goethe, Schiller, Lessing ou Hebbel sont présentées, de Grillparzer, Sudermann, Ibsen ou Wilde aussi. On lira des lignes courageuses dévoilant l’engagement entier de Theodor Lessing dans le combat pour l’émancipation des femmes et son engagement sceptique dans le mouvement des Landerziehungsheime. Il est à espérer que ce recueil annonce la publication plus systématique de l’œuvre de Theodor Lessing et qu’un projet fédérateur pour une édition complète voie enfin le jour.
– Martine BENOIT –
Christoph Peters, Une chambre au paradis, (trad. de l’allemand par Elisabeth Landes), Paris (Sabine Wespieser Editeur) 2007, 365 p. (titre original allemand : Ein Zimmer im Haus des Krieges, BTB Verlag 2006)
Ce roman comprend deux parties différentes par l’écriture et la perspective du récit, mais qui se complètent. La première relate du point de vue de Jochen « Abdallah » Sawatzky une tentative d’attentat contre le temple de Louxor en Egypte, un attentat islamiste qui doit provoquer le renouveau spirituel de l’Egypte en détruisant un site païen qui attire essentiellement des touristes occidentaux. L’histoire récente connaît quelques exemples iconoclastes de ce genre qui visent la religion des autres en même temps qu’un secteur essentiel de l’économie des pays émergents, le tourisme. Jochen est un ancien drogué converti à l’islam dans lequel il a trouvé le réconfort qui lui manquait dans une société allemande matérialiste, individualiste, hédoniste et incapable de transcendance. Ecrit comme un morceau de caméra subjective, cette première partie essaie de faire comprendre l’exaltation du guerrier et son fanatisme religieux, mais aussi ses craintes de l’échec et ses peurs viscérales pendant le combat, sa désillusion face à l’échec, mais aussi sa réaction de fierté face à la prison. C’est assez bien réussi. La seconde partie, de loin la plus longue, retrace sur le double mode des rapports d’ambassade et de la relation des entretiens entre le terroriste emprisonné et l’ambassadeur d’Allemagne au Caire qui se charge luimême du dossier, un face à face étonnant qui se déroule sur le mode de la compréhension sympathique et critique entre les deux protagonistes. Point n’eût été besoin que ce soit l’ambassadeur lui-même qui rende visite au prisonnier malmené dans le quartier de haute sécurité par des policiers égyptiens encagoulés, un conseiller aurait fait l’affaire, c’eût même été plus crédible. Mais pour que le récit prenne tout son sens, il fallait qu’il y ait ce face à face. L’ambassadeur Claus Cismar est un ancien soixante-huitard que la détermination de Jochen « Abdallah » confronte à sa propre évolution : face à lui, il a le sentiment d’avoir perdu la foi qui l’animait du temps de la contestation étudiante au profit de sa carrière. Même s’il ne l’approuve pas, il éprouve de la sympathie pour le prisonnier, il est même subjugué au point d’en devenir malade. Mais l’engagement de l’ambassadeur n’interrompt pas la marche de l’histoire : Jochen « Abdallah » est condamné à mort et exécuté par pendaison, le gouvernement égyptien n’a pas souhaité, même pour un Allemand, dévié de sa lutte contre l’intégrisme qui menace la stabilité politique du pays. Pourtant, l’ambassadeur muté a droit, en fin de récit, à quelques remarques assassines de la part de son successeur par intérim qui relève qu’il aurait sans doute été possible d’empêcher cette exécution si l’Ambassade avait respecté les règles habituelles de la diplomatie : le comportement de l’ambassadeur a irrité le côté égyptien et interdit au côté allemand de construire une ligne de défense plus solide ! C’est bien là l’ironie de l’histoire : l’exsoixante- huitard Claus Cismar, par manque de professionnalisme et engagement trop personnel, exhausse objectivement le vœu de Jochen « Abdallah » d’accéder à la chambre qui l’attend au paradis quand l’ambassadeur Cismar avait mission de lui éviter la pendaison.
En racontant l’histoire d’une conversion et d’un examen de conscience, C. Peters, en grand connaisseur de l’Egypte et de l’islam, cherche à faire comprendre les ressorts de l’illumination religieuse et à montrer que, si entre l'intégrisme islamiste et « Mai 68 » il n’y a pas de réelle commune mesure, dans un cas comme dans l’autre il y avait au moins recherche d’un idéal. Dans un cas comme dans l’autre également, l’idéal se heurte à la réalité et à la trahison. Ce roman est une réflexion critique sur la légitimité de la violence, sur les différentes formes que celle-ci peut prendre – il renoue ici, sans le trancher, avec le débat mené par le mouvement étudiant allemand des années 60 sur la violence contre les choses et la violence contre les personnes – et sur le confort moral des sociétés occidentales qui ne se soucient pas réellement de comprendre les ressorts de la violence et ses origines sociales et idéologiques. Un roman, très bien traduit par E. Landes, qui, bien qu’il donne à l’occasion dans l’imagerie d’Epinal, prête à réfléchir hors des schémas préconçus.
– Jérôme VAILLANT –
Comptes rendus
Béatrice Angrand, en collaboration avec Aurélie Marx, L'Allemagne, Le cavalier Bleu (Paris, 2006).
Comment faire tenir en 124 pages les idées reçues sur l’Allemagne et leurs correctifs – tel est le programme de ce petit ouvrage à offrir à des amis qui voudraient découvrir le pays, sa culture et son histoire rapidement ou à d’autres qui voudraient mettre à l’épreuve leurs propres préjugés. Le livre se découpe en trois grands chapitres, avec un propos introductif et une conclusion. Les trois grands thèmes abordés sont l’histoire, l’économie, la société. Chaque chapitre est subdivisé en sous-chapitres qui ont pour sujet des idées reçues sur l’Allemagne comme par exemple : les Allemands aiment l’ordre ; les Allemands ne sont pas raffinés ; l’allemand n’est pas une langue attractive, etc. ... On pourra regretter certaines coquilles histori- ques, on s’attardera plus sur le message des auteures, Béatrice Angrand, conseillère pour les relations franco-allemandes chez ARTE, et Aurélie Marx, normalienne, agrégée d’allemand. Elles insistent sur l’importance du couple franco-allemand, de la « Deutsch- Französische Freundschaft » en Europe, laquelle doit passer par l’« ardente obligation » d’une « connaissance bienveillante ». Vaste et intéressant programme en effet.
– Martine BENOIT –
Birgit Dahlke, Jünglinge der Moderne. Jugendkult und Männlichkeit in der Literatur um 1900 Köln, Böhlau Verlag, 2006, 273 p.
Principalement connue pour ses travaux sur la littérature de RDA, et notamment les auteures non-officielles des années 1980, Birgit Dahlke se consacre dans sa thèse d’habilitation à la littérature du « fin de siècle » et plus particulièrement à l’alliance entre « culte de la jeunesse » et masculinité à cette époque. Le sous-titre de l’ouvrage est d’ailleurs trompeur, à moins d’entendre par littérature, de prime abord, un ensemble beaucoup plus vaste que les belles-lettres. En effet, dans une approche culturaliste reflétant l’actuel « cultural turn » des études germaniques en Allemagne, Dahlke élargit son corpus audelà de la « littérature » pour tenir compte aussi bien des discours pédagogiques et psychologiques que des œuvres de la philosophie culturelle ou des études sur la sociologie de la jeunesse de l’époque. Le texte littéraire devient une source de l’histoire culturelle parmi d’autres. Et pour cause : selon l’auteure, l’extrême valorisation de la jeunesse (masculine et bourgeoise) suite à la modernisation de la société, et la crise de l’identité masculine liée à l’émancipation de la femme qui se fait sentir parallèlement, ne peuvent s’expliquer qu’en recourant aux textes littéraires qui en font leurs sujets. Les différents discours se chevauchent, s’entrecroisent ou entrent en conflit ; texte et contexte entrent dans un « rapport dynamique » et font apparaître toutes les dimensions de la tension entre « espérance » et « conscience de crise » qui caractérise le discours sur la jeunesse du « fin de siècle ».
Le cadre théorique pour les deux concepts clé de l’ouvrage, « masculinité » et « jeunesse », provient d’une part des théories sur la masculinité circulant depuis les années 1970 – en cela Dahlke reste fidèle aux approches « gender » qui ont marqué ses travaux antérieurs. D’autre part, en ce qui concerne le concept de « jeunesse », Dahlke le considère comme un « symbole agrégé » (aggregiertes Symbol), concept forgé dans un contexte idéologiquement très marqué par le philosophe cybernéticien est-allemand Georg Klaus dans son ouvrage « Sprache der Politik » (1971) et récemment réintroduit dans le débat littéraire par Dieter Schlenstedt. Sans pouvoir discuter la pertinence de ce concept et son emprunt à un ouvrage fortement marqué, il est intéressant de voir qu’il y a depuis quelque temps comme une volonté de la part de chercheurs est-allemands d’introduire et de faire valoir dans le discours scientifique actuel des concepts et notions forgés à l’époque de la RDA.
Revenons au contenu du livre. Dans une première partie, Dahlke fait le tour des débats de l’époque concernant la « jeunesse », en passe de devenir un véritable mythe. Entre catégorie esthétique et vecteur de la critique culturelle contre la tradition, l’ancien et les pères, la « jeunesse » devient la « signature » d’une époque en changement où les techniques médicales du rajeunissement côtoient des mouvements comme la réforme de l’existence (Lebensreform), Wandervogel ou le nudisme, donnant tous une première importance à la « jeunesse ». Outre le fait de passer en revue l’histoire du concept de jeunesse et de s’intéresser à l’histoire sociale, l’auteure se consacre au discours de la psychologie sur le danger de l’adolescence (Stanley Hall), au (non)traitement de l’adolescence dans la psychanalyse (Freud) et aux conceptions androgynes de la jeunesse.
Les analyses de la deuxième partie se consacrent principalement à la littérature. D’abord, Dahlke cerne la « rhétorique de l’épuisement et de la fatigue » telle que l’on peut l’apercevoir dans le roman de l’adolescence. Les jeunes protagonistes échouent dans des situations de crise, reflétant les peurs de la modernisation et l’expérience de la rupture propre à l’époque. Parmi les auteurs étudiés, on trouve aussi bien Max Halbe, Emil Strauß et Friedrich Huch que Hesse, Wedekind, Musil et Mann. Une autre analyse littéraire est consacrée à Stefan George et son cercle ainsi qu’à Rudolf Borchardt. Alors que la littérature relaye le thème de l’épuisement et de la fatigue, on peut apercevoir comme un contre-mouvement dans l’art nouveau, notamment avec l’artiste Fidus qui réagit par un « pathos de l’éveil » et un culte de la lumière. D’autres sous-chapitres éclairent les ruptures dans la narration généalogique, lorsque la position du père n’est plus qu’une lacune, ou encore la crise de la « narration paternaliste », le caractère « efféminé » de la narration s’exprimant par la perte de l’unité et par la dissolution de la perspective centrale. Sont convoqués les exemples d’Arthur Schnitzler et de Robert Walser. Que les topoï jusque-là évoqués d’une jeunesse fatiguée, en crise et en rupture avec les pères concernent principalement les couches aisées de la société devient particulièrement visible lorsque Dahlke se penche sur la littérature ouvrière (Hans Marchwitza, Willi Münzenberg). Ici, les conditions sociales sont telles que la généalogie et l’expérience sont encore porteurs de sens et même nécessaires pour la survie au quotidien. Il n’y a pas de place pour le conflit entre pères et fils et l’expérience propre de la jeunesse est d’abord d’être ouvrière, et ensuite jeune.
Dans sa dernière partie, Dahlke expose les différents discours qui réagissent avec des « stratégies de virilisation » (Ermannungsstrategien) aux phénomènes de déstabilisation liés à la modernité, c’est-à-dire la perte de la masculinité et la féminisation. Rentrent ici en compte l’œuvre d’Otto Weininger, à la fois misogyne et antisémite, et les écrits de Hans Blüher, responsable de l’idéologie du mouvement Wandervogel, une communauté masculine où un Führer charismatique remplace la fonction du père et dont sont issus dès 1915 les milices des « Freikorps ». D’autres études concernent les topoï de la masculinité et de la guerre (chez Rilke, Hans Breuer – « Zupfgeigenhansel » – et Walter Flex), ou encore celui de l’aventurier (Georg Simmel, Fridtjof Nansen). Deux chapitres sont consacrés à Siegfried Bernfeld, futur théoricien de l’éducation antiautoritaire, et à Walter Benjamin dont on connaît l’engagement dans la « Jugendkultur-bewegung ». L’étude de Birgit Dahlke, innovatrice par le croisement interdisciplinaire de deux concepts clé du « fin de siècle », « jeunesse » et « masculinité », est d’une très grande richesse aussi bien intellectuelle que documentaire. Non seulement l’auteure suit les discours de l’époque dans les moindres détails, mais elle mentionne et commente également l’abondante littérature critique sur le(s) sujet(s). C’est là que parfois l’on perd de vue les thèses centrales du livre qui, vu l’ampleur du corpus, aurait gagné à établir des liens supplémentaires entre les différents sujets traités.
– Carola HÄHNEL-MESNARD –
Theodor LESSING. – Nachtkritiken – Kleine Schriften 1906-1907. Hrsg. Von Rainer Marwedel, Göttingen (Wallstein) 2006, 620 p.
En 1990 Rainer Marwedel s’est vu décerner le prix Carl von Ossietzky, la ville de Oldenburg désirant saluer ainsi l’engagement et les recherches de ce spécialiste en Sciences Politiques et Sociales concernant Theodor Lessing. De cet auteur inclassable, publiciste, essayiste, professeur de philosophie, écrivain, psychologue, on ne retient désormais que le seul titre d’un livre, Der jüdische Selbsthass, paru en 1930, et la terrible fin, l’assassinat dès le 30 août 1933 dans le refuge de Marienbad par des hommes de mains des nazis. Rainer Marwedel nous propose avec cet ouvrage composé essentiellement de critiques théâtrales une facette méconnue de Theodor Lessing – mais on retrouve le même ton intransigeant et la même plume acérée que dans les articles et essais regroupés par Rainer Marwedel en 1986 sous le titre Ich warf eine Flaschenpost ins Eismeer der Geschichte – Essays und Feuilletons (Luchterhand, Darmstatd). On prendra plaisir à lire de nombreux développements sur Carla Mann, sur son frère Heinrich aussi, sur Hugo von Hofmannsthal. Des pièces de Goethe, Schiller, Lessing ou Hebbel sont présentées, de Grillparzer, Sudermann, Ibsen ou Wilde aussi. On lira des lignes courageuses dévoilant l’engagement entier de Theodor Lessing dans le combat pour l’émancipation des femmes et son engagement sceptique dans le mouvement des Landerziehungsheime. Il est à espérer que ce recueil annonce la publication plus systématique de l’œuvre de Theodor Lessing et qu’un projet fédérateur pour une édition complète voie enfin le jour.
– Martine BENOIT –
Christoph Peters, Une chambre au paradis, (trad. de l’allemand par Elisabeth Landes), Paris (Sabine Wespieser Editeur) 2007, 365 p. (titre original allemand : Ein Zimmer im Haus des Krieges, BTB Verlag 2006)
Ce roman comprend deux parties différentes par l’écriture et la perspective du récit, mais qui se complètent. La première relate du point de vue de Jochen « Abdallah » Sawatzky une tentative d’attentat contre le temple de Louxor en Egypte, un attentat islamiste qui doit provoquer le renouveau spirituel de l’Egypte en détruisant un site païen qui attire essentiellement des touristes occidentaux. L’histoire récente connaît quelques exemples iconoclastes de ce genre qui visent la religion des autres en même temps qu’un secteur essentiel de l’économie des pays émergents, le tourisme. Jochen est un ancien drogué converti à l’islam dans lequel il a trouvé le réconfort qui lui manquait dans une société allemande matérialiste, individualiste, hédoniste et incapable de transcendance. Ecrit comme un morceau de caméra subjective, cette première partie essaie de faire comprendre l’exaltation du guerrier et son fanatisme religieux, mais aussi ses craintes de l’échec et ses peurs viscérales pendant le combat, sa désillusion face à l’échec, mais aussi sa réaction de fierté face à la prison. C’est assez bien réussi. La seconde partie, de loin la plus longue, retrace sur le double mode des rapports d’ambassade et de la relation des entretiens entre le terroriste emprisonné et l’ambassadeur d’Allemagne au Caire qui se charge luimême du dossier, un face à face étonnant qui se déroule sur le mode de la compréhension sympathique et critique entre les deux protagonistes. Point n’eût été besoin que ce soit l’ambassadeur lui-même qui rende visite au prisonnier malmené dans le quartier de haute sécurité par des policiers égyptiens encagoulés, un conseiller aurait fait l’affaire, c’eût même été plus crédible. Mais pour que le récit prenne tout son sens, il fallait qu’il y ait ce face à face. L’ambassadeur Claus Cismar est un ancien soixante-huitard que la détermination de Jochen « Abdallah » confronte à sa propre évolution : face à lui, il a le sentiment d’avoir perdu la foi qui l’animait du temps de la contestation étudiante au profit de sa carrière. Même s’il ne l’approuve pas, il éprouve de la sympathie pour le prisonnier, il est même subjugué au point d’en devenir malade. Mais l’engagement de l’ambassadeur n’interrompt pas la marche de l’histoire : Jochen « Abdallah » est condamné à mort et exécuté par pendaison, le gouvernement égyptien n’a pas souhaité, même pour un Allemand, dévié de sa lutte contre l’intégrisme qui menace la stabilité politique du pays. Pourtant, l’ambassadeur muté a droit, en fin de récit, à quelques remarques assassines de la part de son successeur par intérim qui relève qu’il aurait sans doute été possible d’empêcher cette exécution si l’Ambassade avait respecté les règles habituelles de la diplomatie : le comportement de l’ambassadeur a irrité le côté égyptien et interdit au côté allemand de construire une ligne de défense plus solide ! C’est bien là l’ironie de l’histoire : l’exsoixante- huitard Claus Cismar, par manque de professionnalisme et engagement trop personnel, exhausse objectivement le vœu de Jochen « Abdallah » d’accéder à la chambre qui l’attend au paradis quand l’ambassadeur Cismar avait mission de lui éviter la pendaison.
En racontant l’histoire d’une conversion et d’un examen de conscience, C. Peters, en grand connaisseur de l’Egypte et de l’islam, cherche à faire comprendre les ressorts de l’illumination religieuse et à montrer que, si entre l'intégrisme islamiste et « Mai 68 » il n’y a pas de réelle commune mesure, dans un cas comme dans l’autre il y avait au moins recherche d’un idéal. Dans un cas comme dans l’autre également, l’idéal se heurte à la réalité et à la trahison. Ce roman est une réflexion critique sur la légitimité de la violence, sur les différentes formes que celle-ci peut prendre – il renoue ici, sans le trancher, avec le débat mené par le mouvement étudiant allemand des années 60 sur la violence contre les choses et la violence contre les personnes – et sur le confort moral des sociétés occidentales qui ne se soucient pas réellement de comprendre les ressorts de la violence et ses origines sociales et idéologiques. Un roman, très bien traduit par E. Landes, qui, bien qu’il donne à l’occasion dans l’imagerie d’Epinal, prête à réfléchir hors des schémas préconçus.
– Jérôme VAILLANT –