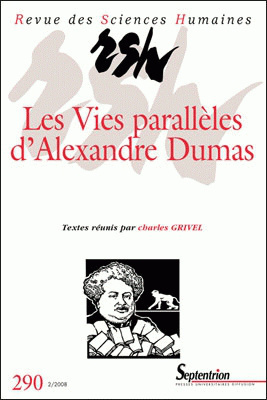Revue des Sciences Humaines, n°290/avril - juin 2008
Les vies parallèles d'Alexandre Dumas
First Edition
Il y a pléthore, ou alors embonpoint. Visions succédanées, ou alors successives. Des substituts font la chaîne. Mille et quelques personnages, célèbres ou piètres, fantômes assurément tous, des héros grosse pointure, d'Artagnan, Monte-Cristo, Salvador, des bêtes d'appui, chiens, lièvres, fourmis, rhinocéros, singes, toute une peuplade de figurants, « historiques », « biographiques », mais pourtant interchangeables en ce qu'ils... agissent, dispensent et croisent, sur toujours les mêmes schèmes, l'aventure, la performance, l'incroyable « coup » du sort. Emballement du récit. Un trait en dissimule un autre. Tout et tous se pressent au portillon de la demande. La donne. La collection. Le décalque. Les multiples visages de l'Un. Monnayage, démultiplication. La reproduction infinie de l'être qui écrit. Une filiation ininterrompue du moi, de moi, de l'ensemble des circonstances qui l'ont vu naître à celles qui l'ont vu s'échapper par derrière. Alexandre, tous, de père en fils, y compris le serviteur, l'intendant et la bête, à partir du grand capitaine, le grand-père, celui qui est allé planter le sucre aux Antilles : blanc tu pars, noir tu reviens ! Dumas gigogne : tous les offices - amant, père et fils, cuisinier, dramaturge, conférencier, conteur, journaliste, député, propriétaire, copieur et voyageur dans tous les pays possibles à la fois. Mais écrivain de toutes ses mains. Dumas, l'homme simultané. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comme il dit. Le nègre de ses « nègres » a voulu faire main basse sur toute l'Histoire de France et d'ailleurs. Il sillonne le Caucase, les terres d'Astrakan, les bords du Rhin, Naples, Mannheim et la Suisse et Paris, d'autrefois à aujourd'hui, à cette fin principale. Tous les personnages « historiques » de ses livres sont l'émanation du moi biographique. Le « Dictionnaire Dumas » d'Hamel et Méthé démontre au moins, malgré qu'il en ait, cela. Abondance des « Mémoires » signés Alexandre, qui tous débordent de leur cadre - c'est ce que je lis qui me dévore, la matière échappe à la matière -, mais ne dépassent pourtant pas la moitié de sa vie, car grande est aussi sa réserve. Sur les murs du cabinet de travail, au château d'If, impossible prison, de l'autre côté de l'étang, dans le parc de Monte-Cristo, qu'il fit construire à Marly, chaque moellon porte le nom gravé des principaux héros de l'oeuvre. J'écris au-dedans de mon oeuvre. Je suis l'écriture de chacune de mes parties. Leur nom est l'indice pluriel de ce moi que je multiplie. Dumas compulsif, abondant. De cette oeuvre intempérée, figuratrice de qui lui donna vie, dissipatrice et dissimulatrice, nous entendons explorer, ici, le jeu.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Revue des Sciences Humaines
- Title Part
-
Numéro 290
- Edited by
- Charles Grivel,
- Journal
- Revue des Sciences Humaines | n° 290
- ISSN
- 00352195
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts > Literature
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts
- Title First Published
- 2008
Paperback
- Publication Date
- 2008
- ISBN-13
- 9782913761377
- Extent
- Main content page count : 246
- Code
- 1102
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 459 grams
- List Price
- 23.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3