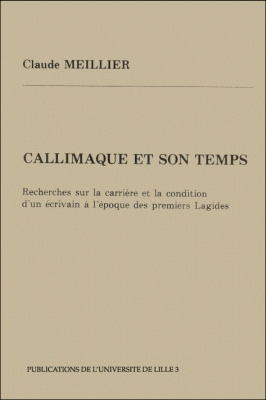Callimaque et son temps
Recherches sur la carrière et la condition d'un écrivain à l'époque des premiers Lagides
First Edition
Livre épuisé
La littérature, et notamment la poésie, occupent à l'époque héllénistique une place importante dans la société grecque. Les renouvellements esthétiques et le développement des formes poétiques originales ne se font pas en dehors du contexte social, s'il est vrai que le fait littéraire gagne en spécificité, comme le montrent les discussions et les rivalités des écrivains et des érudits. Callimaque est l'un des poètes qui ont le plus contribué aux nouveautés poétiques de son époque. Son oeuvre n'est pas simplement littérature pure et imprégnée d'érudition. Elle est liée aux nouvelles institutions de la royauté lagide, dans l'Alexandrie du IIIe siècle avant JC, liée aussi aux traditions des cités et principalement de sa cité d'origine, Cyrène. Il n'y a pas de rupture brutale, à la suite de l'empire d'Alexandre et de l'instauration des monarchies héllénistiques, dans la vie des cités, dans leur organisation sociale et enfin dans leur culture propre. Une bonne partie de la poésie de Callimaque qui nous a été conservée est poésie de circonstance, en relation aussi bien avec la vie publique qu'avec les occasions diverses de la vie individuelle. A ce titre, elle peut même être considérée comme un témoignage historique intéressant, en particulier sur les cultes et la religion (dont l'importance n'est pas à rappeler dans la civilisation grecque), et notamment sur les cultes royaux dont elle traduit l'idéologie. Le poète Callimaque est donc un poète moins artificiel que ne le feraient croire les subtilités de son art. Il est représentatif de son époque où la poésie, tout en étant raffinée, savante même, selon une tradition constante de la littérature grecque, est également reconnue comme une valeur sociale pour ainsi dire indispensable, ce dont témoigne l'intérêt qui lui était porté par les rois et les cités.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Author
- Claude Meillier,
- Collection
- Littérature
- ISSN
- 19658508
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts > Literature
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and the Arts
- Title First Published
- 1979
Paperback
- Publication Date
- 1979
- ISBN-13
- 9782859391195
- Extent
- Main content page count : 368
- Code
- 108
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 370 grams
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3