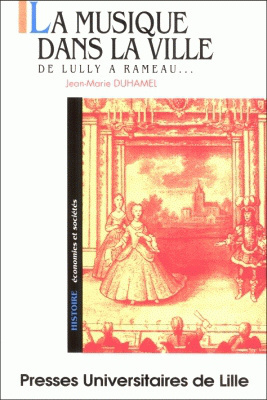La musique dans la ville
De Lully à Rameau...
Première édition
Au XVIIIe siècle, la musique est un élément important de la culture des élites. Bien plus qu'un divertissement élégant ou un accessoire artistique inévitable, elle participe pleinement au mouvement des Lumières: depuis la Cour de Versailles... Lire la suite
Au XVIIIe siècle, la musique est un élément important de la culture des élites. Bien plus qu'un divertissement élégant ou un accessoire artistique inévitable, elle participe pleinement au mouvement des Lumières: depuis la Cour de Versailles jusqu'aux villes de provinces, elle rythme les travaux et les jours, le nouvel art de vivre qui se met en place. Nobles et bourgeois, hommes de lettres "amateurs et connaisseurs", pour beaucoup musiciens eux-mêmes, se retrouvent dans les opéras, les salles de concert privés ou semi-publics, les académies, les salons, et débattent, longuement et avec passion, dans les livres, journaux, mémoires et corespondances de questions essentielles: faut-il préférer la musique française ou la musique italienne? Lully ou Rameau? Rameau ou Gluck? Des clans, des partis se forment qui divisent le public et l'opinion. Le goût pour la musique n'a jamais été si universel, répétent au fil du siècle nombre d'observateurs eux-même étonnés d'un tel engouement et de l'importance des querelles musicales.Ce livre d'histoire culturelle - et non de musicologie - tente d'en retracer les étapes.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- Jean-Marie Duhamel,
- Collection
- Économies et sociétés
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Sciences sociales > Economie, management, marketing, mathématiques
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société
- Date de première publication du titre
- 1994
Livre broché
- Date de publication
- 1994
- ISBN-13
- 9782859394547
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 360
- Code interne
- 485
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 652 grammes
- Prix
- 10,67 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3