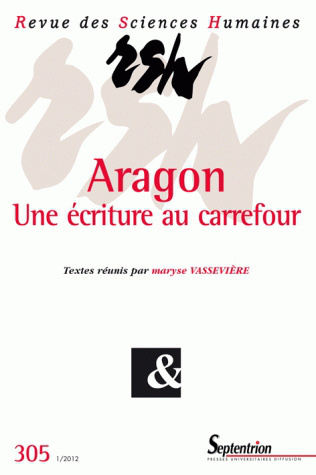Revue des Sciences Humaines, n°305/janvier - mars 2012
Aragon
Une écriture au carrefour
Première édition
C'est un Aragon un peu inattendu avec son écriture au carrefour des genres et des influences qu’on espère donner à découvrir : son lien étonnant à Ponge, le lien profond avec Matisse et même l’approche de la poésie revisitée, avec le rapport à Neruda dans le « rire amer » de la déstalinisation, avec le croisement insoupçonné de la culture musulmane dans Le Fou d’Elsa, ou encore avec le lien avec la chanson devenu chose commune. Sans compter la source inépuisable de l’expérience journalistique pour un grand écrivain directeur des Lettres françaises. Si bien qu’au-delà du XIXe siècle (un colloque a pu s’intituler « Le XIXe siècle d’Aragon ») et de la modernité du XXe siècle qu’Aragon aura contribué à définir, c’est vers le XXIe siècle qu’il pointe son projecteur. Cette modernité sans faille d’Aragon est ici amplement soulignée ainsi que le dialogue souterrain non seulement avec ses contemporains mais aussi avec ses « cadets »… C’est entre le réalisme de la photographie et la tentation du dialogisme carnavalesque qu’oscille toute l’oeuvre d’Aragon, dans une paradoxale continuité, depuis les excès dadaïstes d’Anicet (1921) et les « fantasmagories » surréalistes du Paysan de Paris (1926), jusqu’à la folle indécision narrative des trois derniers romans particulièrement étudiés dans ce volume, en passant par les romans du Monde réel (1934-1951), où le réalisme socialiste affiché ne va pas sans son envers, avec ces failles évidentes qui viennent miner le roman à thèse.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Revue des Sciences Humaines
- Partie du titre
-
Numéro 305
- Édité par
- Maryse Vassevière,
- Revue
- Revue des Sciences Humaines | n° 305
- ISSN
- 00352195
- Langue
- français
- Date de première publication du titre
- 14 mars 2012
Livre broché
- Date de publication
- 14 mars 2012
- ISBN-13
- 978-2-913761-52-0
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 244
- Code interne
- 1335
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 454 grammes
- Prix
- 25,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3