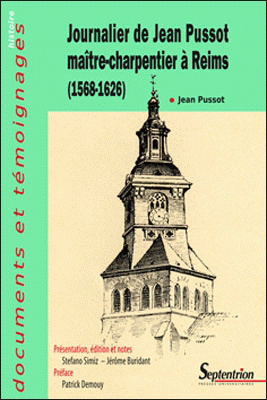Journalier de Jean Pussot maître-charpentier à Reims (1568-1626)
Première édition
De 1568, année de son mariage à l'âge de 24 ans, jusqu'à son décès en 1626, soit 57 années durant sans la moindre interruption, le maître-charpentier rémois Jehan Pussot tient un journalier, d'abord pour lui-même et son entourage immédiat, puis dans l'espoir avoué d'instruire les générations futures. Son écriture, simple et directe, pudique et parfois ironique, mais jamais dénuée de bon sens, se densifie au fil des ans pour refléter l'élargissement constant des centres d'intérêt de notre artisan. Ainsi à la chronique initiale des événements familiaux et des conjonctures saisonnières, Pussot ajoute très tôt l'observation du cortège sans fin des troubles politico-religieux qui frappent la France et le Pays Rémois au dernier tiers du XVIe siècle. À la compassion pour ses contemporains, à l'occasion des tensions ligueuses particulièrement vives dans une cité toute acquise aux Guise, succède le soulagement apporté par la pacification générale de 1598. Dès lors, l'homme de métier et possesseur de vignes goûte les bienfaits de la gestion prospère des affaires, le fervent catholique se fait le témoin vigilant de la marche triomphale du catholicisme réformé, notamment de ses expériences liturgiques et musicales Le fidèle sujet du royaume se réjouit de la réconciliation survenue entre les premiers Bourbons, la noblesse catholique et sa cité des sacres, redevenue l'ornement visible de la monarchie. Lorsque enfin les dernières années se présentent, emporté par une vague nostalgique de souvenirs personnels, il ouvre une fenêtre mémorielle passionnante sur ses vertes années.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- Jean Pussot,
- Préface de
- Patrick Demouy,
- Annotations de
- Stefano Simiz, Jérôme Buridant,
- Collection
- Documents et témoignages
- ISSN
- 12846155
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Histoire moderne
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société
- Date de première publication du titre
- 22 avril 2008
Livre broché
- Date de publication
- 2011
- ISBN-13
- 9782757401781
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 320
- Code interne
- 1249
- Format
- 16 x 24 cm
- Prix
- 30,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3