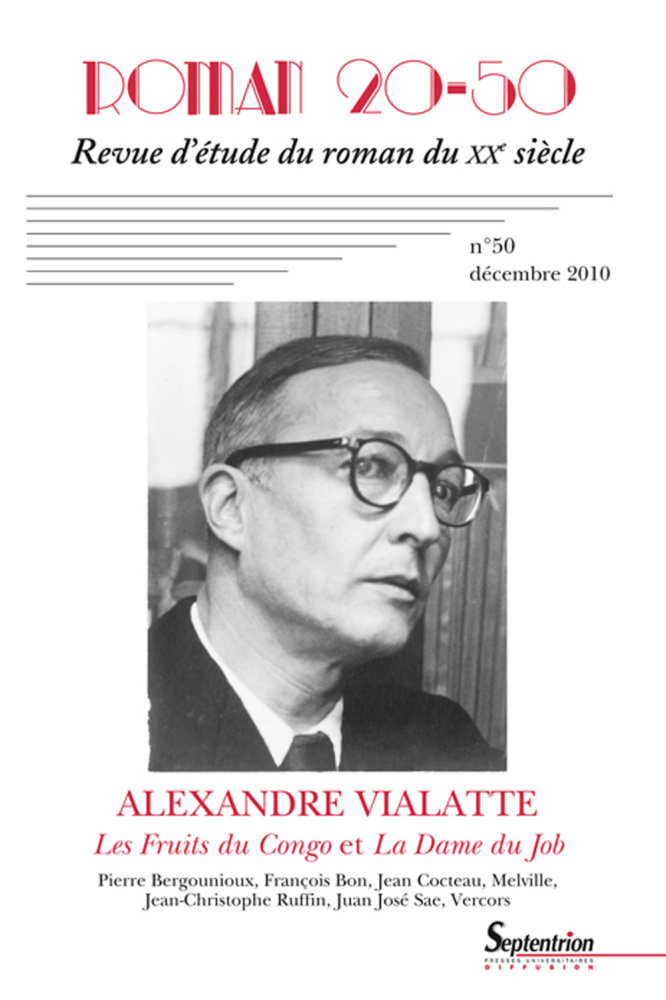Roman 20-50, n°50/décembre 2010
Alexandre Vialatte
Les Fruits du Congo et La Dame du Job
Pierre Bergounioux, François Bon, Jean Cocteau, Melville, Jean-Christophe Ruffin, Juan José Sae, Vercors
Première édition
La Dame du Job et Les Fruits du Congo peuvent être rassemblés non seulement sous le signe du récit d'enfance ou d'adolescence mais surtout sous celui de ce qu'on pourrait appeler « l'invention des mythologies ». Ces deux romans ont en... Lire la suite
La Dame du Job et Les Fruits du Congo peuvent être rassemblés non seulement sous le signe du récit d'enfance ou d'adolescence mais surtout sous celui de ce qu'on pourrait appeler « l'invention des mythologies ». Ces deux romans ont en effet la particularité d'accorder une place prépondérante à ces figures tutélaires - personnages issus de l'imagination des enfants ou adolescents et d'une image (affiche publicitaire, illustration) - que sont la Dame du Job et la grande négresse, ou pour leur forme masculine, plus ténébreuse et moins érotique, l’étrange M. Panado. Ces figures allégoriques très originales font des romans de Vialatte des sortes de fictions au carré où les personnages chimériques deviennent eux-mêmes producteurs des fictions dans lesquelles ils finissent par se perdre. Comme dans le Noé de Giono (1947), le monde inventé se superpose au monde réel pour lui donner une richesse et une profondeur exceptionnelles. On est bien loin ici du « roman traditionnel » balzacien contre lequel le Nouveau Roman va bientôt prendre fait et cause. La brièveté du découpage en séquences, le traitement surprenant de l’événement, l’importance accordée au quotidien, le mélange des genres, la mise en abyme de la représentation, tout concourt à faire de ces deux récits des réussites hors du commun qui méritent d’être découvertes ou redécouvertes.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Roman 20-50
- Partie du titre
-
Numéro 50
- Édité par
- Alain Schaffner,
- Revue
- Roman 20-50 | n° 50
- ISSN
- 02955024
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et arts > Lettres et littérature française
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et arts
- Date de première publication du titre
- 01 décembre 2010
Livre broché
- Date de publication
- 14 janvier 1994
- ISBN-13
- 9782908481518
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 232
- Code interne
- 3517
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 372 grammes
- Prix
- 6,86 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Dossier critique
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline
Etudes réunies par Yves Baudelle
Henri Godard : Céline à l'agrégation), p. 5
Philippe Muray : C’est tout le roman ce quelque chose, p. 9
Jean-Pierre Giusto : Louis-Ferdinand Céline ou le dangereux voyage, p. 19
Michel P. Schmitt : Un texte méchant, p. 31
Gianfranco Rubino : Le hasard, la quête, le temps dans le parcours du moi, p. 43
Philippe Bonnefis : Viles villes, p. 57
Denise Aebersold : Goétie de Céline, p. 71
André Derval : La part du fantastique social dans Voyage au bout de la nuit : Mac Orlan et Céline, p. 83
Judith Karafiath : Les héritiers indignes de Semmelweis : médecins et savants dans Voyage au bout de la nuit, p. 105
Isabelle Blondiaux : La représentation de la pathologie psychique de guerre dans Voyage au bout de la nuit, p. 105
Philippe Destruel : Le logographe en délit, p. 117
Yves Baudelle : L’onomastique carnavalesque dans Voyage au bout de la nuit, p. 133
Catherine Rouayrenc : De certains « et » dans Voyage au bout de la nuit, p. 161
Günter Holtus : Les concepts voyage et nuit dans Le Voyage au bout de la nuit de L.-F. Céline, p. 171
Lectures étrangères
Marc Hanrez : Céline, Sand, Shakespeare, p. 191
Etude de la nouvelle
Marie Bonou : Histoire d’un crime : La Nuit hongroise, p. 197
Romans 20/90
Yves Reuter : Construction/déconstruction du personnage dans Un homme qui dort de Georges Pérec, p. 207