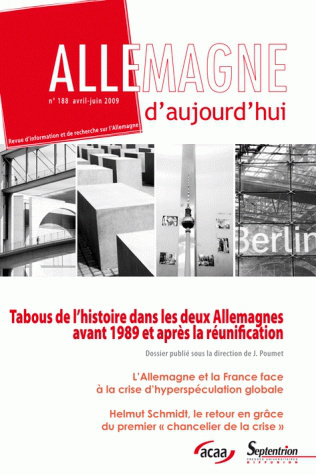Allemagne d'aujourd'hui, n°125/juillet - septembre 1993
Droit d'asile et politique d'immigration
Première édition
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui
- Partie du titre
-
Numéro 125
- Revue
- Allemagne d'aujourd'hui | n° 125
- ISSN
- 00025712
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères > Pays germaniques et scandinaves
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères
- Date de première publication du titre
- 10 septembre 2009
Livre broché
- Date de publication
- 1949
- ISBN-13
- 9782363990518
- Code interne
- 3784
- Format
- 16 x 24 cm
- Prix
- 3,05 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3