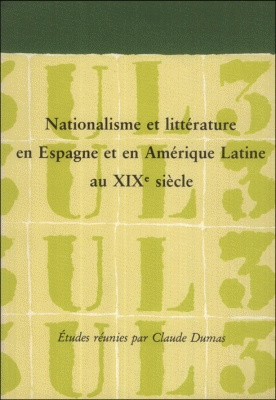Nationalisme et littérature en Espagne et en Amérique Latine au XIXe siècle
Première édition
Le recueil d'articles présenté dans ce volume regroupe les communications prononcées lors du Colloque International organisé en février 1980 par le Centre d'Etudes Ibériques et Ibéro-américaines du XIXe siècle, de l'Université de Lille III, sur le thème:
Le sujet choisi n'était pas sans ambiguïté: il pouvait se référer, en effet, soit aux tentatives - très caractéristiques du domaine américain - faites pour se débarasser des influences culturelles étrangères et formuler une culture indépendante, propre, originale, soit au fait que les Lettres, l'Art et l'Histoire du monde ibérique et ibéro-américain apparaissent comme le véhicule - peu importait alors sa nature - du nationalisme ou du régionalisme au sens le plus défensif, ou agressif, qui est d'ordinaire celui de ces concepts. Il nous était apparu, d'autre part, que, tout bien pesé, cette ambiguïté première avait des chances d'être finalement féconde, dans la mesure où, pour exprimer et transmettre des idées de revendication nationaliste ou régionaliste, le producteur de texte pouvait être amené à chercher une forme nouvelle, originale et qui ne devait rien à personne. Et c'est ce qui arriva. L'Espagne du début et de la fin du siècle, envahie par le Français et subissant l'amputation de la Grande Ile présente, entre autres, des époques de crise riches en attitudes de nationalisme et de régionalisme, dans la pensée et dans la forme; les nations en formation de l'Amérique ibérique, qu'il s'agisse de la première génération de l'Indépendance, de la vision libérale combattante du milieu du siècle ou de la querelle des Anciens et des Modernes qui marque la dernière décennie, en sont un ample et foisonnant terrain d'observation; Les 14 études qui sont réunies (7 pour l'Espagne, 7 pour l'Amérique latine) sont, de cette problématique ambiguë et faussement dialectique, une intéressante et nouvelle illustration.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Avec
- Jean Andreu, Catherine Béroud, Jean-François Botrel, Nelly Clémessy, Jacqueline Covo, Gérard Dufour, Maurice Fraysse, Enrique Miralles Garcia, Grazyna Grudzinska, Jan Kieniewicz, Jean-Marie Lavaud, Eliane Lavaud-Fage, Charles Minguet, Robert Pageard,
- Édité par
- Claude Dumas,
- Collection
- UL3
- ISSN
- 0248997X
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères > Pays hispanophones et lusophones
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères
- Date de première publication du titre
- 1982
Livre broché
- Date de publication
- 1982
- ISBN-13
- 9782865310098
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 296
- Code interne
- 230
- Format
- 16 x 23 cm
- Poids
- 461 grammes
- Prix
- 8,08 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3