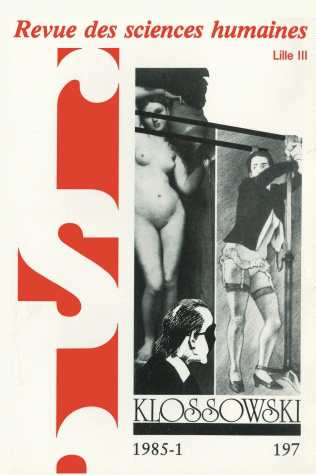Revue des Sciences Humaines, n°197/janvier - mars 1985
Klossowski
Première édition
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Revue des Sciences Humaines
- Partie du titre
-
Numéro 197
- Avec
- ,
- Revue
- Revue des Sciences Humaines | n° 197
- ISSN
- 00352195
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et arts > Lettres et littérature française
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et arts
- Date de première publication du titre
- 1985
Livre broché
- Date de publication
- 1985
- ISBN-13
- 9782363991850
- Code interne
- 3920
- Prix
- 9,14 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3