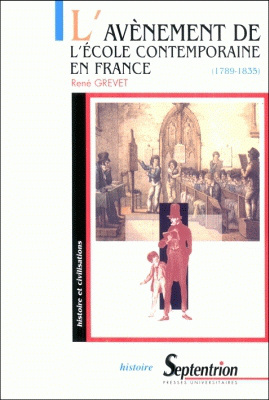L'avènement de l'école contemporaine en France (1789-1835)
Première édition
L'École contemporaine naît avec la Révolution. Cet avènement, préparé par l'ébranlement éducatif du siècle des Lumières, s'inscrit parmi les évolutions caractéristiques de la transition entre l'époque moderne et l'ère contemporaine. C'est donc à une véritable conquête culturelle et scolaire du territoire à laquelle on assiste entre 1789 et 1835. La scolarisation et l'alphabétisation ont progressé, concernant désormais plus de la moitié de la population. L'État a cherché à occuper l'espace éducatif jusque là monopolisé par l'Église et s'est donné progressivement les moyens administratifs d'une politique d'instruction publique. La tutelle étatique s'est ainsi renforcée, symbolisée par l'activité d'un ministère à part entière dès 1828 et par l'existence d'un seul et même budget de l'instruction publique à partir de 1835. L'existence d'un enseignement public, de mieux en mieux encadré par l'État, a favorisé l'apparition d'une mentalité laïque parmi les enseignants. Pourtant le monopole étatique ne s'est pas imposé complètement. Une autre école, héritière des traditions confessionnelles, s'est maintenue et a même prospéré dans l'ouest et le sud. Ce dualisme scolaire, né sous la Révolution, plaçait désormais l'éducation de la jeunesse parmi les enjeux politiques majeurs de l'époque contemporaine.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- René Grevet,
- Collection
- Histoire et civilisations
- ISSN
- 12845655
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Histoire contemporaine
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société
- Date de première publication du titre
- 2001
Livre broché
- Date de publication
- 2001
- ISBN-13
- 9782859397067
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 360
- Code interne
- 750
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 817 grammes
- Prix
- 27,50 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
L'affirmation de la tutelle étatique (1789-1835)
CHAPITRE PREMIER
LE TEMPS DES OUVERTURES :
PROPOSITIONS ET DEBATS (1789-1815)
1 - Premières propositions réformatrices
- Pierre-Claude-François Daunou
- Charles-Maurice de Talleyrand
- Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau
- L'éducation du prince héritier
2 - L'apport de Condorcet (1791-1793)
- Homme de science et homme de lettres
- Principes fondamentaux de l'instruction publique
- Plan d'organisation scolaire
3 - Les débats à la Convention Nationale (1792-1795)
- L'activité du Comité d'Instruction publique
- Une instruction publique sous le contrôle de l'Etat
- Instruction publique ou éducation nationale ?
- Une école gratuite, laïque et obligatoire ?
- La tentation spartiate
4 - A l'époque du Directoire et des Idéologues
- Débats au conseil des Cinq-Cents
- Les Idéologues
5 - Sous le Consulat et l'Empire
- Le projet Chaptal (novembre 1800)
- Le modèle hollandais
- Les propositions de Frédéric Cuvier (1815)
- Le modèle anglais : les débuts de l'enseignement mutuel
CHAPITRE II
LE TEMPS DES LOIS SCOLAIRES :
L'IMPULSION REVOLUTIONNAIRE ET IMPERIALE (1793-1815)
1 - La première législation de l'enseignement primaire (1793)
- Les décrets provisoires
- La loi du 29 frimaire an II (19 décembre 1793)
2 - La législation scolaire de l'an III (1794)
- La loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794)
- La création de l'Ecole Normale (9 brumaire an III)
- La création des écoles spéciales
3 - La législation thermidorienne
- Le décret sur les écoles de services publics (22 octobre 1795)
- La loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)
4 - Une loi de transition (11 floréal an X)
5 - La création de l'Université impériale (1806-1808)
6 - La naissance d'une direction centralisée de l'instruction publique
CHAPITRE III
LE TEMPS DES AMENAGEMENTS :
L'INCONTOURNABLE DUALISME SCOLAIRE (1815-1833)
1 - L'Etat et l'Eglise face à la question scolaire (1815-1833)
- Le monopole universitaire en question
- Un ministère pour l'instruction publique
2 - L'Etat et l'enseignement primaire (1816-1830)
- Un texte fondamental : l'ordonnance du 29 février 1816
- Un texte de réaction : l'ordonnance du 8 avril 1824
- Un texte de compromis : l'ordonnance du 21 avril 1828
3 - La loi Guizot (28 juin 1833)
- La préparation de la loi
- Le contenu de la loi 97
- Analyse de la loi Guizot
CHAPITRE IV :
LE TEMPS DE L'ETAT ADMINISTRATEUR ET PAYEUR
1 - Une administration centralisée
- Les bureaux parisiens
- Les inspecteurs généraux
- Les recteurs d'académie
2 - Le soutien financier de l'Etat
- A la recherche d'un budget pour l'instruction publique
- Un lent accroissement de la participation budgétaire de l'Etat
- Des crédits pour l'enseignement primaire
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE :
La naissance de l'école contemporaine
CHAPITRE V : UNE NOUVELLE ADMINISTRATION DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (1789-1814)
1 - Une décennie d'innovations et de résistances (1789-1799)
- Traditions et premières difficultés (1789-1799)
- L'application de la loi du 29 frimaire an II (19 décembre 1793)
- L'application de la loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794)
- L'application de la loi du 3 brumaire an IV ou le reflux des écoles républicaines
2 - Une période de centralisation et de stabilisation (1810-1814)
- L'enseignement primaire sous administration préfectorale (1800-1808)
- Le rôle de l'Eglise et le retour des congréganistes
- L'enseignement primaire sous tutelle universitaire
- Bilan de la période impériale
CHAPITRE VI :
LE PREMIER ESSOR DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CONTEMPORAIN (1815-1833)
1 - L'action des autorités de tutelle et l'application de la législation scolaire
- L'action des autorités universitaires et préfectorales (1815-1824)
- L'action des autorités religieuses : la période ultra (1824-1828)
- Une intervention plus énergique des autorités ministérielle et universitaire (1828-1833)
2 - Le rôle décevant des autorités locales (1816-1833)
3 - Bilan statistique (1815-1833)
- Le développement limité de l'enseignement mutuel
- Nombre total d'écoles et d'élèves
CHAPITRE VII:
INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES D'UNE REVOLUTION A L'AUTRE
1 - Une profession souvent peu enviable
- Un groupe professionnel relativement stable
- La promotion du métier d'institutrice laïque sous la Révolution
- Des conditions d'existence difficiles
- Un avantage conditionnel : l'exemption du service militaire
2 - Les débuts de la professionnalisation
- Une tradition tenace : l'insuffisance des compétences
- Des exigences professionnelles accrues
- Emulation et récompenses
3 - La lente mise en place d'une formation professionnelle
- L'Ecole normale et les normaliens de l'an III
- Les écoles normales primaires (1808-1833)
CHAPITRE VIII :
LA RECHERCHE ARDUE DE L'EFFICACITE PEDAGOGIQUE
1 - Les instructions officielles
- Les programmes
- Méthodes pédagogiques et livres officiels
2 - La pratique pédagogique
- Des locaux et un équipement insuffisants
- Les méthodes d'enseignement
- Les apprentissages : une organisation pédagogique maladroite ou déficiente
3 - Les résultats : la mesure de l'alphabétisation
- Le test de l'alphabétisation
- L'alphabétisation pendant la période révolutionnaire
- Le sondage Maggiolo pour les années 1816-1820
- L'alphabétisation des années 1820-1830
CHAPITRE IX :
LES ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR, SECONDAIRE ET INTERMEDIAIRE
1 - Un enseignement supérieur assez terne
- Facultés et étudiants
- L'Ecole Normale et les normaliens
2 - Un enseignement secondaire public et privé
- L'expérience des écoles centrales (1795-1802)
- Lycées et collèges (1802-1835)
- Les établissements privés d'enseignement secondaire
3 - Enseignement intermédiaire ou enseignement primaire supérieur ?
CHAPITRE X :
UNE NOUVELLE PERCEPTION DE L'ECOLE
1 - Les deux écoles
- L'école de la Révolution
- Le maintien de la petite école traditionnelle
- L'apparition d'une mentalité laïque
2 - Les visions contrastées de l'école
- Des élites intéressées
- Ecole du peuple, peuple sans école
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE