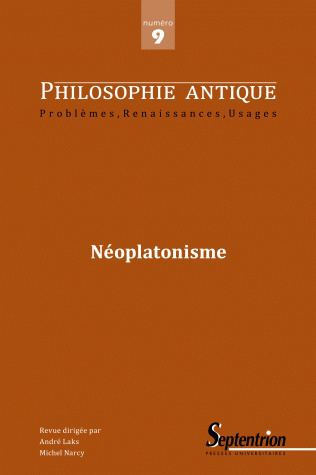Philosophie Antique n°9 - Néoplatonisme
Première édition
La philosophie de Plotin et de ses successeurs exerça un ascendant presque exclusif pendant près de quatre siècles et imprégna durablement la philosophie médiévale. Les études rassemblées dans ce numéro, dues en majorité à de jeunes chercheurs, témoignent à la fois du génie spéculatif des auteurs rassemblés sous l'étiquette de néoplatonisme et de la vitalité de la recherche actuelle dans ce domaine.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Philosophie antique
- Partie du titre
-
Numéro 9
- Édité par
- André Laks, Michel Narcy,
- Revue
- Philosophie antique | n° 9
- ISSN
- 16344561
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée > Philosophie, herméneutique, philologie
- Catégorie (éditeur)
- Bibliothèques > Bibliothèque Arts, Patrim
- Catégorie (éditeur)
- Bibliothèques > Bibliothèque Arts, Patrimoines
- Catégorie (éditeur)
- Bibliothèques > Bibliothèque Éducation, form
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée
- Date de première publication du titre
- 13 novembre 2009
- Type d'ouvrage
- Numéro de revue
- Avec
- Bibliographie
Livre broché
- Date de publication
- 13 novembre 2009
- ISBN-13
- 9782757401248
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 232
- Code interne
- 1185
- Format
- 16 x 24 x 1,4 cm
- Poids
- 369 grammes
- Prix
- 22,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Plotin, la mémoire et la connaissance des intelligiblesphil.ant.res.html#res9
De la transmission à la sympathie : Plotin et la désaffection du milieu perceptif (Enn. IV, 5 [29])
Valérie Cordonier
Plotin critique de la phantasia stoïcienne
Isabelle Koch
À propos du choix d'une variante chez Plotin
Enn. V 3 [49], 7, 3
Pierre Thillet
The Soul and the Virtues in Proclus’ Commentary on the Republic of Plato
Gregory MacIsaac
La riscrittura analitico-sillogistica dell’argomento in favore dell’immortalità dell’anima (Plat. Phaedr. 245 c 5-246 a 2) : Alcinoo, Alessandro d’Afrodisia e Ermia d’Alessandria
Angela Longo
La fantasia et ses diverses expressions dans le monde latin
Béatrice Bakhouche
Cosmogenèse et chronocentrisme chez Calcidius
Alain Galonnier
Comptes rendus
Bulletin bibliographique
Extrait
Plotin, la mémoire et la connaissance des intelligibles
Résumé. Plotin discute à plusieurs reprises de la mémoire, de sa fonction et de son rôle dans la connaissance. Dans la longue section qui va de IV 3 [27], 25 à IV 4 [28], 5, il s'interroge sur « ce qui » se remémore, c'est-à-dire sur le sujet de la mémoire. L’examen de ces chapitres permet de recueillir quelques éléments caractéristiques de la théorie plotinienne de la connaissance. Plotin fait une rigoureuse distinction entre la mémoire et la simple conservation d’impressions sensibles et associe la mémoire à une capacité spontanée de l’âme. L’âme, d’autre part, en tant que sujet de la mémoire, est pourtant toujours caractérisée par un type de pensée discursif et lié au temps. De ce type de connaissance, Plotin distingue la pensée la plus élevée, qui appartient à l’âme grâce à la partie d’elle-même qui n’est pas descendue de l’Intellect, lequel est étranger au temps et à la discursivité. L’étude du sujet de la mémoire fournit des éclaircissements sur la structure de l’âme chez Plotin, sur le rôle de l’imagination (phantasia), sur le caractère intrinsèquement dynamique de l’âme, capable de redéfinir sa propre nature en accord avec la faculté qui joue en elle le rôle de centre unificateur. Au sommet se trouve une condition cognitive dans laquelle l’âme saisit, même « ici-bas », avant sa séparation du corps, les Formes intelligibles, au moyen d’une connaissance appropriée et indépendante de toute forme de mémoire et de discursivité (cf. IV 4 [28], 4-5). Par conséquent, le rôle de la réminiscence dans l’épistémologie plotinienne est plutôt limité.
Summary. On several occasions Plotinus discusses memory : its function and relation to knowledge. In the long section that runs from IV 3 [27], 25 to IV 4 [28], 5, Plotinus considers what it is that remembers, i.e. what constitutes the subject of memory. An examination of these chapters reveals a number of features in the Plotinian theory of knowledge. Plotinus draws a thorough distinction between memory and the mere conservation of sense data, and links the former to an intrinsic power of the soul. The Soul, however, as the subject of memory, is always characterized by some kind of discursive thought, and bound up with time. Plotinus distinguishes this kind of knowledge from the highest thought, which belongs to the part of the Soul that has not descended from the Intellect, and is extraneous to time and discursivity. In addressing the issue of the subject of memory, Plotinus also draws light on the structure of the Soul and the role of imagination (phantasia). Soul emerges as an intrinsically dynamic essence, which has the power of redefining its own nature in concert with the faculty which acts as its unifying centre. At the highest level is a cognitive condition in which the Soul, even "here below", prior to its separation from the body, gathers the intelligible Forms by means of an appropriate knowledge, independent of any kind of memory and discursivity (see IV 4 [28], 4-5). As a result, the role of recollection in Plotinian epistemology is rather limited.
Plotin critique de l’épistémologie stoïcienne
Résumé. Les critiques que Plotin adresse à l'épistémologie stoïcienne visent à établir que les stoïciens ont tort de corporaliser l’âme, car cela leur interdit de concevoir correctement les perceptions sensibles et les intellections. On peut penser qu’il n’y a rien d’intéressant à attendre, philosophiquement, de cette polémique menée par un partisan de l’incorporéité de l’âme contre les matérialistes de l’hegemonikon. Car l’opposition des principes respectifs est telle que l’adversaire peut ne pas s’estimer réfuté parce qu’il ne partage aucune des prémisses de son objecteur. Il semble que Plotin a eu conscience de ce problème, et qu’il a cherché à formuler des objections contre le corporalisme stoïcien telles qu’elles ne le prennent pas pour cible immédiate tout en l’atteignant indirectement par leurs implications. Mon propos est d’examiner cette démarche sur deux cas exemplaires : la critique de l’explication stoïcienne de la sensation par une transmission ; et celle de l’analyse de la connaissance en termes de réception d’empreintes.
Summary. The plotinian criticisms against the Stoic epistemology try to demonstrate that Stoics are wrong in corporalizing the soul, because this does not allow them to conceive adequately sense perceptions and intellections. We can think that there is nothing interesting to expect, philosophically speaking, from this controversy raised by a supporter of the incorporeality of the soul against the Stoics’ materialistic views about the hegemonikon, their opposition being so fundamental that the opponents could consider themselves unrefuted because they do not share any premise with the objector. Plotinus seems to have been aware of this difficulty, and he tried to formulate some objections against the Stoic corporalism that do not aim immediately at it but actually involve some indirect strikes. My topic consists in investigating this process about two exemplary cases: the criticism of the Stoic explanation of sense perception as occurring through a transmission; and the criticism of the analysis of knowledge as a reception of imprints.
The Soul and the Virtues in Proclus’ Commentary on the ‘Republic’ of Plato
Résumé. Dans la septième dissertation de son Commentaire sur la République de Platon, Proclus fournit les éléments d'une philosophie politique néoplatonicienne très structurée. Fidèle, de façon générale, à la description platonicienne de l’âme tripartite et des quatre vertus cardinales, il introduit cependant d’importantes nuances dans cette théorie. L’idée de la prédominance d’une partie de l’âme sur une autre et l’idée de « vies mixtes » où deux parties de l’âme prédominent en même temps élargissent la description platonicienne des différents types politiques. En outre, en s’efforçant de donner diverses explications métaphysiques de la nature et du nombre des parties de l’âme et des vertus, Proclus inscrit la philosophie politique platonicienne plus ou moins tout d’une pièce dans une hiérarchie cosmique néoplatonicienne.
Summary. In the 7th essay of his Commentary on the Republic of Plato, Proclus supplies the elements of a fairly robust Neoplatonic political philosophy. In general he agrees with Plato’s account of the tripartite soul and the four cardinal virtues, while introducing important nuances into the theory. The idea of the dominance of one part of the soul over another, and the idea of 'mixed lives’, where two parts dominate at once, extend Plato’s account of the various political types. Further, in his attempt to give various metaphysical explanations for the nature and number of the parts of the soul and the virtues, Proclus inserts Platonic political philosophy more or less whole-cloth into a Neoplatonic cosmic hierarchy.
De la transmission à la sympathie : Plotin et la désaffection du milieu perceptif (Enn. IV, 5 [29])
Résumé. Dans son Traité 29, « Sur la vision », Plotin aborde à ce propos une difficulté consistant à savoir quelle part y joue le « milieu » séparant l'objet senti de l’organe. Cette question occupe les quatre premiers chapitres du traité : afin d’y préciser le rôle du milieu dans la perception visuelle, Plotin en admet provisoirement la nécessité, dressant au premier chapitre la liste des possibilités théoriques envisageables à partir de cette hypothèse de travail. Afin de mieux voir les étapes et les enjeux de cette argumentation dense, elliptique et à peine effleurée par les études sur la question, je l’analyse ici à la lumière de textes antérieurs portant sur les modalités de la sensation comme telle et sur le problème, plus général, de la transmission d’une affection à travers un milieu donné. Ces questions, abordées avant Plotin dans des cadres divers et à partir de problématiques variant d’un auteur à l’autre (Platon, Aristote et ses successeurs dans le Lycée, Chrysippe de Soles, Plutarque de Chéronée, Pline l’Ancien, Galien de Pergame), ont été retravaillées par Alexandre d’Aphrodise à propos d’un thème précis, pour donner lieu à un modèle original de transmission dont j’aimerais montrer qu’il est d’un apport décisif dans le Traité 29, puisqu’il donne à Plotin l’instrument indispensable pour, en l’approfondissant afin de mieux le dépasser, élaborer par là sa propre théorie de la vision, solidaire d’un processus de désaffection du milieu perceptif amorcé avant lui.
Summary. In his Treatise 29, On Vision, Plotinus addresses the difficulty of knowing the actual function of the medium separating the sensible object from the eye. The first four chapters of the treatise are dedicated to this question: in order to specify the role of the medium in visual perception, Plotinus provisionally admits its necessity and, in the first chapter, draws up a list of the various theoretical models conceivable on the basis of this working hypothesis. In order to get a better view of the stages and issues of this dense and elliptical argument, barely touched upon in studies of this issue, I analyze it in light of some earlier texts about the modalities of sensation as such and the problem, more generally, of transmitting an affection through a medium. These questions were addressed before Plotinus within various conceptual frameworks and according to the views of various authors (Plato, Aristotle and his Peripatetic followers, Chrysippus, Plutarch of Chaeronea, the Elder Pliny and Galen), and they were reworked by Alexander of Aphrodisias on a specific theme related to cosmology. I hope to show that the new model of transmission that he proposed allowed Plotinus to elaborate his own theory of vision, on the basis of a process of disaffection of the perceptive medium that was already initiated before him.
La réécriture analytico-syllogistique d’un argument platonicien en faveur de l’immortalité de l’âme (Plat. Phaedr. 245c5-246a2) : Alcinoos, Alexandre d’Aphrodise, Hermias d’Alexandrie
Résumé. Les preuves de l'immortalité de l’âme, qui sont un des thèmes centraux de l’enseignement de Platon, ont fait l’objet d’une réflexion d’ordre logique et formel sur la manière dont elles sont (ou devraient être) exprimées. En particulier l’argument en faveur de l’immortalité de l’âme contenu dans le Phèdre (245c5-246a2), fondé sur la notion d’âme automotrice et principe de mouvement, a été assidûment analysé, pour ce qui est de sa formulation, par plusieurs représentants de la tradition platonicienne (Alcinoos, Hermias d’Alexandrie), ainsi qu’à l’intérieur de la tradition péripatéticienne (Alexandre d’Aphrodise). Par conséquent, il représente, à l’avis de l’auteur, un point privilégié d’observation de la façon dont les platoniciens s’approprient la logique aristotélicienne et récrivent, à partir de l’époque impériale, certains arguments platoniciens. En outre, il apparaît qu’Alexandre d’Aphrodise, bien qu'étant de tradition péripatéticienne, a grandement contribué à la reformulation des arguments de Platon selon les canons de la logique aristotélicienne par les platoniciens contemporains et postérieurs. Il semble aussi qu’Hermias, dans ses scholies sur le Phèdre, réagit justement à certaines affirmations d’Alexandre. Dans cet article, on montre quels sont les points de contact ainsi que les différences dans la réécriture analytico-syllogistique de l’argument du Phèdre en faveur de l’immortalité de l’âme par Alcinoos et Hermias, sans négliger l’apport d’Alexandre.
Summary. The way in which Plato’s proofs of the immortality of the soul, one main theme of his teaching, are (or should be) formulated have been examined from a logical and formal point of view. In particular, several representatives of the Platonic tradition (Alcinoos, Hermias of Alexandria) and of the Peripatetic tradition as well (Alexander of Aphrodisias) have thoroughly analysed the formulation of the argument for the immortality of the soul given in Plato’s Phaedrus (245c5-246a2), based on the definition of soul as self-moving and principle of move. Thus, according to the present writer, this argument is one of the passages most fitted to observe how Platonists appropriate Aristotelian logic and, from imperial era onwards, rewrite some Platonic arguments. Moreover, Alexander of Aphrodisias, yet pertaining to the Peripatetic tradition, seems to have played a major part in the reformulation of Plato’s arguments according to the rules of Aristotelian logic by contemporary and later Platonists. It seems also that Hermias, in his scholia on the Phaedrus, actually reacts to some claims of Alexander. This paper aims to show in a detailed manner where Alcinoos, Hermias and Alexander meet together or diverge from each other in their analytico-syllogistical rewriting of the argument of the Phaedrus for the immortality of soul.