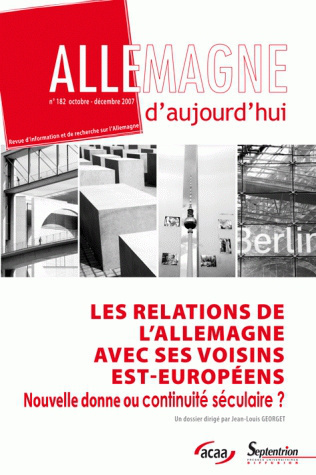Allemagne d'aujourd'hui, n°182/octobre - décembre 2007
Les relations de l'Allemagne avec ses voisins est-européens. Nouvelle donne ou continuité séculaire ?
Première édition
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui
- Partie du titre
-
Numéro 182
- Revue
- Allemagne d'aujourd'hui | n° 182
- ISSN
- 00025712
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères > Pays germaniques et scandinaves
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères
- Date de première publication du titre
- 01 octobre 2007
Livre broché
- Date de publication
- 01 octobre 2007
- ISBN-13
- 9782859399900
- Code interne
- 1035
- Format
- 21 x 13,5 cm
- Poids
- 273 grammes
- Prix
- 11,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
DOSSIER L'Allemagne et les pays d'Europe de l’Est : continuité séculaire ou nouvelle donne ?
Jean-Louis Georget
Allemagne-Pologne depuis 1945 : parcours de la reconnaissance
Thomas Serrier
Les expulsés, éternelle pomme de discorde entre l’Allemagne et la Pologne ?
F. Lelait
La crise actuelle des relations germano-polonaises D. Bingen
L’avenir du Triangle de Weimar dans la future Europe. Le triangle de Weimar au 17e Forum économique de Krynica
F. Plasson
Des rapports complexes. L'Allemagne et l’Autriche du Saint Empire romain germanique à l’Union européenne E. Bruckmüller
La tradition bohémiste et le discours de la réconciliation germano-tchèque depuis 1989 H. Leclerc
La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne
C. Jacques
« Normales » ? Les relations germano-roumaines avant et après la chute du Mur P. de Tregomain
Les relations germano-bulgares. Un cas particulier au XXe siècle B. Mirtschev
Les relations littéraires entre la Croatie et l’espace germanophone V. Obad
Chronique des Länder en 2007
H. Menudier
Actualité politique et sociale, octobre 2007
B. Lestrade
Comptes rendus Guntolf Herzberg, Kurt Seifert, Rudolf Bahro- Glaube an das Veränderbare (A.M. PAILHES). – Wolfgang Wippermann, Die Deutschen und der Osten. – Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundes-republik Deutschland von ihren Anfängen
Pierre Angel (1913-2007)
De Jérusalem à Berlin. La littérature israélienne en Allemagne B. Pivert
Entretien avec Patricia Reimann
Des profondeurs de l’âme à la chair du quotidien. Deux images de l’Allemagne en France : L’âme allemande (1933) de Louis Reynaud et Cousins par alliance (2002) de Béatrice Durand E. Guillet
Notes de lecture de J.-C. François
Chronique culturelle et littéraire
C. Hähnel-Mesnard
Simone Barck (1944-2007)
RAPPEL. Le dossier publié sous la direction de Jacques Poumet dans le N° 181 (juillet-septembre 2007), Usages du passé dans les nouveaux Länder est issu d’un colloque réalisé avec le concours du CIERA et le soutien du Centre de recherche Langue
Extrait
DOSSIER L’Allemagne et les pays d’Europe de l’Est : continuité séculaire ou nouvelle donne ?
Présentation
2007 a vu encore une fois l'Union européenne élargir son horizon puisque la Bulgarie et la Roumanie y ont adhéré. Cette entrée n’a pas été, tant en Allemagne que dans le reste de l’Europe, l’occasion d’événements festifs. Elle a au contraire ravivé préjugés et craintes, soulevant en dernier lieu la fameuse question, toujours en suspens, des limites de l’Europe. Cette question date en fait des années 90. Elle avait eu pour fondement les hésitations autour de la façon dont devait avoir lieu le rattachement, conséquence logique du bouleversement géopolitique majeur qu’elle venait de subir, des différents prétendants à l’Union européenne, incontournable à moyen terme. Après l’accord partiel signé avec la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Hongrie dans les années 1991-93 furent définis les critères de Copenhague. Ils mettaient en place un système privilégiant avant tout les aspects économiques de la question, instaurant de fait de façon détournée une hiérarchie entre les nouveaux impétrants. Si les discussions entre les chefs d’Etat du Conseil européen, ministres des Affaires étrangères et directions générales de la Commission européenne d’une part, partisans d’une entrée soutenue par des aides substantielles, et les directions spécialisées des ministères nationaux et la Commission européenne soutenues par les syndicats de producteurs d’autre part, défenseurs d’une aide a minima furent rudes, les seconds finirent par l’emporter. Les décideurs politiques avaient fini par se ranger aux arguments des technocrates, ce qui n’augurait rien de bon.
L’intégration eut donc lieu dans des conditions peu favorables, caractérisées par un climat de déception et de méfiance généralisé de la part des nouveaux venus, déçus par tant de réserve, et les anciens pays, craignant entre autres arguments la paralysie du système. Elle eut pour effet paradoxal de réactiver des histoires croisées sous-jacentes plutôt que de générer l’euphorie qui avait prévalu lors de l’entrée de l’Espagne et du Portugal, voire de la Grèce quelques décennies auparavant. Il était inévitable que l’Allemagne, dont les nouveaux entrants avaient beaucoup attendu, se retrouve au cœur de ce retour du politique. Comme l’explique bien François Bafoil dans son article sur l’évolution économique des voisins orientaux de l’Allemagne, ce qui devait s’avérer être une tentative moderne, originale et européenne pour dessiner une politique redistributive s’est finalement avéré être le plaquage de modèles et schémas éculés sur une réalité qui, se repliant dès lors sur des histoires nationales interrompues, s’est révélée être plus résistante que prévue aux calculs des experts internationaux.
Poser la question des rapports de l’Allemagne à ses voisins dans leur multiplicité, c’est tenter de dresser, au cas par cas, un bilan de la question. Aux échanges désormais apaisés avec l’Autriche, qui ont connu de multiples soubresauts entre Sadowa, leur point de bascule, et la reconstruction d’une amitié non exempte d’aspérités après la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’opposent d’autres chantiers plus brûlants, comme ceux des rapports agités avec la Pologne, qui ont fait les Unes des presses allemandes et polonaises depuis des mois. Dieter Bingen met ainsi en lumière les étapes de l’accession de la Pologne à la majorité politique en regard de l’Allemagne, mais aussi plus généralement de l’Europe et des Etats-Unis. Il montre combien les enjeux intérieurs, dont les ressorts réels ont parfois été occultés après la chute du mur de Berlin, contraignent les positions parfois radicales en matière de politique extérieure. Thomas Serrier approfondit la question de l’unicité des liens entre les deux pays, les insérant dans leur diachronie et leurs contextes politiques successifs. Car c’est bien de la reconnaissance plus que de la connaissance que les Polonais cherchent dans le regard des Allemands, l’une n’allant naturellement pas sans l’autre. Les hésitations mutuelles dans ce va-et-vient permanent, confinant parfois à la maladresse ou à la mauvaise foi, ont fait le lit de ces points de cristallisation aux contours très symboliques comme celui des réfugiés. Florence Lelait met en valeur cette question centrale des relations germano-polonaises, démontrant la manière dont le cadre européen qui en constitue l’indépassable horizon et la démographie tendent progressivement à en apaiser les plaies, ravivées occasionnellement quand le besoin s’en fait sentir.
Au contraire de ce qui se produit avec la Pologne, l’Allemagne et la République tchèque ont, comme le décrit Christian Jacques, rapidement trouvé des terrains d’entente, après une phase de défiance temporaire due aux derniers contentieux de la question des Sudètes. Point de triangle de Weimar ici, dont le contenu évolue continûment, comme le signale Frédéric Plasson. La différence de taille entre les deux voisins de la RFA n’est sans doute pas étrangère à cette normalisation rapide dans un cas et à la persistance d’aspérités dans l’autre. Ce travail de rapprochement est maintenant si avancé qu’il fait émerger un trait d’union renvoyant à une époque magnifiée qui prévalait avant le tournant national de la Révolution de 1848 : le bohémisme. Dans son article, Hélène Leclerc montre combien cette idée, mélange de pragmatisme et d’utopie puisque relais du discours européen, peut générer une forme de redécouverte mutuelle aboutissant à une véritable réflexion sur la perception d’un passé bilingue et la construction d’une histoire croisée sur des bases complémentaires.
Les relations entre l’Allemagne et les trois régions roumaines que sont la Transylvanie, le nord de la Bucovine et la Bessarabie, si elles n’engagent pas de question frontalière, sont elles aussi historiquement déterminées. Pierre de Trégomain s’attache à en rappeler les différentes étapes, depuis la colonisation souabe, en passant par les différents aléas du conflit engendré par le principe wilsonien de l’attribution d’un Etat à chaque nationalité, jusqu’au retour dans les années 70 des enfants prodigues, qui avaient fini par former une enclave germanophone et homogène au sein de l’Etat roumain, dans les girons allemand et autrichien. Ce fut la condition du nouveau départ pris par les deux pays, dont les perceptions réciproques sont basées sur une acceptation de l’altérité et sur une image positive. Nouveau partenaire également mais dont l’histoire commune mouvementée est plutôt récente eu égard aux pays précédemment évoqués, la Bulgarie, qui réactive le paradigme Stambolov, c’est-à-dire le fait de se tourner vers les partenaires occidentaux au détriment de l’ancien voisin et maître russe. Cela la pousse notamment vers l’Allemagne aux côtés de laquelle elle a connu, dans les tourmentes des guerres européennes, de lourdes défaites. Comme le montre Bogdan Mirtschev, cette relation recèle des facettes multiples, depuis l’aspect dynastique jusqu’à l’amitié modèle qu’a entretenue Sofia avec les deux Allemagnes pendant toute la période de la Guerre froide. Cependant, l’Europe risque de banaliser ce partenariat, ce dernier ne devenant dès lors que l’un des éléments d’une intégration réussie dans un agrégat plus vaste.
Dernier pays traité dans ce dossier, qui lui aussi frappe aux portes de l’Union européenne, et dont l’entrée a été conditionnée au travail de mémoire qu’il doit faire sur lui-même à propos de la tragédie récente qu’a été l’éclatement de l’ex-Yougoslavie : la Croatie. Les liens entre ce pays adriatique et l’espace germanophone, notamment avec l’Empire des Habsbourg, sont séculaires puisque des villes comme Osijek, mais aussi Zagreb participèrent largement, dans un climat relativement pacifique comme le souligne Vlado Obad, à l’élaboration de ce qu’il convient d’appeler une germanité des marges. Par le prisme original de la production en matière de traductions, il s’attache à mettre en exergue les différentes phases d’intensité des échanges germano-croates, montrant comment la prise en charge de son propre bilinguisme peut parfois s’avérer être une impasse coupée des réalités du pays de référence.
Diversité, multiplicité, intensité dans la qualité du lien avec l’Allemagne. : ce qui se dessine dans ce dossier est autant une image projetée des différents pays plus ou moins récemment entrés dans l’UE qu’une redéfinition de l’Allemagne elle-même, qui se reflète de façon kaléidoscopique dans cette Europe de l’Est. Cet effet de miroir est d’ailleurs à l’origine d’une réflexion forte sur le rôle de l’Allemagne dans ce contexte nouveau, qui suscitera chez certains politistes une forme de néo-conservatisme nationaliste, mais chez d’autres une approche au contraire extrêmement prudente. Ces nouveaux entrant se redécouvrent quant à eux une voix et un passé communs passant souvent par la médiation du grand voisin. Il va sans dire que l’on en est sans doute aux prémisses anciennes d’une histoire quant à elle à écrire.
Allemagne-Pologne depuis 1945 : parcours de la reconnaissance
Die Irritationen, die in den letzten Jahren den deutsch-polnischen Dialog erschwert haben, speisen sich oft unmittelbar aus geschichtlichen Stoffen bzw. treten beinahe reflexartig im historischen Gewand hervor. So werfen die geerbten Traumata aus der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit ihren langen Schatten bis in die Gegenwart hinein. Der heutzutage viel diskutierte Begriff einer Politik der Anerkennung dient in dem vorliegenden Beitrag zu einer Bündelung verschiedener Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg (Territorium, Grenzfrage, Reparationen, Pflege der Kulturgüter) und zu einer Analyse der zwischen ihnen bestehenden Konnexe.
German - Poland since 1945. Paths to Recognition.
The tensions, which have hindered German-Polish dialogue over the past few years have often stemmed directly from historical grievances (or they have almost instinctively been presented as such). Thus, we continue to see the traumatic legacy of the war and immediate post-war period cast its shadow over the present day. The following article addresses the hotly discussed concept of a "Policy of Recognition" involving various aspects of German-Polish relations since the 2nd World War (territory, the question of borders, reparations and the maintenance of cultural artefacts) and analysing the ways in which they interrelate.
L’avenir du Triangle de Weimar dans la future Europe. Le triangle de Weimar au 17e Forum économique de Krynica
Le Triangle de Weimar au 17e Forum économique de Krynica
Le Forum de Krynica a réuni du 5 au 8 septembre 2007 pour la 17e fois consécutive des représentants des élites économiques, politiques et intellectuelles des Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO) essentiellement, mais aussi de leurs partenaires internationaux. L’objectif est un échange sur les questions globales en matière d’acquis démocratiques, d’intégration, de coopération politique et économique. Le potentiel de ce genre de plateformes de rencontre est la mise en réseau de partenaires potentiels de coopération, au fil des rencontres spontanées ou planifiées, formelles ou non. Le panel de discussion « The Future of the Weimar Triangle after The Elections in the Member States » était modéré par Klaus-Heinrich Standke, président du « Comité pour la promotion de la coopération franco-germano-polonaise (Triangle de Weimar) » . Gunther Krichbaum, président du comité aux Affaires de l’Union Européenne du Bundestag, donna le point de vue allemand, alors que Marek Belka, ancien Premier ministre (2004-2005), ministre des Finances (1997 et 2001-02) et conseiller du Président de Pologne (1996-97 et 1998-2001) exprima le point de vue polonais.
Le rôle conféré au Triangle de Weimar s’inscrit dans la tradition même de sa mise en place ; il est, d’un commun accord, considéré aujourd’hui comme il y a quinze ans comme un moyen de promotion de l’intégration européenne au sens large du terme et comme un moyen d’approfondissement de la coopération par un dialogue renforcé et institutionnalisé.
Responsabilité européenne
Gunther Krichbaum insista sur le fait que le Triangle de Weimar reste « indispensable pour une européanisation des solutions de l’UE ». Marek Belka constata qu’au-delà de sa fonction historique, le Triangle pouvait et devait à tout prix participer à l’augmentation du « capital confiance entre partenaires », mais précisément et avant tout au sein du Triangle de Weimar lui-même. Il s’agit à chacun de ces deux niveaux de combattre les « suspicions potentielles » et notamment, pour cela, de promouvoir la « transparence » des relations entre ces partenaires.
Deux chantiers en cours nécessitent particulièrement la restauration d’un tel capital confiance. D’une part, les relations germano-polonaises sont depuis plusieurs années envenimées par des éléments populistes largement relayés par la presse des deux pays, influençant fortement les opinions publiques. Certains de ces éléments ont été propulsés au niveau gouvernemental par le gouvernement polonais et nuisent à présent aux contacts bilatéraux et européens. D’autre part, la Pologne et l’Allemagne observent tout particulièrement aussi bien les progrès de la démocratisation en Ukraine que les efforts grandissants de certains groupes du Belarus d’arracher leur pays à la dictature. Les voix évoquant une approche commune germano–polonaise sur ces deux axes se font de plus en plus nombreuses. La réconciliation polono-ukrainienne est, de son côté, pour certains observateurs, la plus « grande contribution de la Pologne à l’UE »
Les discussions de Krynica ont montré que le bilatéralisme germano-polonais et une approche commune à l’Est des deux pays sont inextricablement liés. Cornelius Ochmann, de la Fondation Bertelsmann, lors de la discussion sur les relations entre l’Allemagne et la Pologne dans le contexte européen, argumentait qu’une Ostpolitik allemande était vouée à l’échec sans une amélioration significative des relations germano-polonaises. Or, le Triangle de Weimar était presque implicitement présent dans la plupart des commentaires sur ces deux sujets : en effet, la plupart des observateurs voient une des solutions dans une médiation de la France entre la Pologne et l’Allemagne.
La France et une réactivation de la dynamique weimarienne
Même si ce concept reste tout à fait imprécis, il est intéressant de constater que la France, non impliquée à l’état actuel, est d’ores et déjà citée comme un des possibles acteurs dans une action germano-polonaise, en agissant positivement par le simple fait de sa présence et de la reconnaissance de ses valeurs « philosophiques » . Une telle trilatéralisation du dialogue constitue l’essence même du Triangle de Weimar. Certains vont jusqu’à voir une « responsabilité » française ». Mais le Triangle est également observé à partir d’autres horizons, même hors des cercles traditionnellement « weimariens ». Ainsi, Géza Jeszenszky et Borys Tarasjuk, anciens ministres des Affaires étrangères de Hongrie et d’Ukraine, octroient un potentiel tout particulier à des modèles de coopération tri- ou multipartites comme le Triangle de Weimar . Ils voient par ailleurs dans le nouveau président français un fort potentiel de réactivation de mécanismes de coopération Est–Ouest. Nicolas Sarkozy lui-même s’est référé lors de son discours aux Nations Unies à ces « valeurs philosophiques [de dialogue] de la France » citées ci-dessus . Une multilatéralisation de la diplomatie peut être interprétée à ce niveau comme une des intentions du président. Et comme le confirmait K.H. Standke, Nicolas Sarkozy n’aura pris, il y a un an, qu’une seule et brève, pour autant très claire position sur le Triangle de Weimar allant dans ce même sens ; il verrait la coopération de la France avec certains partenaires privilégiés tout à fait réalisable, mais aimerait l’élargir à d’autres pays, comme par exemple l’Espagne et le Royaume-Uni . C’est également la position de nombreux experts qui considèrent le Triangle de Weimar comme un moyen de ramener les relations germano–polonaises à un niveau de rationalité par le biais d’une Ostpolitik commune, mais pas comme un instrument d’Ostpolitik par excellence, car il exclurait du processus certains pays fortement impliqués comme l’Autriche ou la Roumanie .
Rôle des gouvernements
Malgré ce qui est perçu comme une faiblesse des activités du Triangle au niveau institutionnel des gouvernements, « l’Esprit de Weimar » est vivant au niveau non gouvernemental. Gesine Schwan soulignait que les contacts économiques et humains fleurissent, même sur des sujets aussi délicats que celui des Expulsés - la coopération universitaire, les régions, la jeunesse sont les domaines les plus à mettre en avant . Même si un rôle de «payeur passif », comme celui de l’Allemagne et de la France pour l’OFAJ, ne suffit certes pas, les gouvernements restent, pour Gunther Krichbaum, indispensables pour l’implémentation des structures législatives permettant seules le bon fonctionnement de la plupart des actions non-gouvernementales. La relation entre le Traité de l’Élysée et le Triangle de Weimar a pu être mise en avant. Ainsi, l’idée d’une « Fondation du Triangle de Weimar » a été avancée par K.H. Standke, qui permettrait aux gouvernements participant au Triangle de Weimar de récompenser officiellement des initiatives promouvant les idéaux weimariens, avec comme double effet d’attirer l’attention de l’opinion publique et de sponsors. Bien plus que de savoir si les gouvernements des trois pays du Triangle de Weimar lui accorderont un potentiel futur, il convient d’observer les prochains temps, s’ils :
1. accorderont une importance suivie d’actes tripartites concrets au processus d’intégration européenne, sur certains des chantiers ouverts en ce moment
2. et si oui, si le Triangle de Weimar leur semblera l’outil adéquat, du moins dans sa forme actuelle.
L’« utilité et l’importance d’être plus présents à Krynica et sur d’autres forums de ce type » ont été réaffirmées par de nombreux participants, notamment français. Les organisateurs du Forum de Krynica, quant à eux, comptent renforcer substantiellement la thématique de ce type d’outils de coopération en faveur d’une promotion de l’intégration européenne. Grazyna Sleszynska, de l’IWS , confirme un renforcement et une optimisation des initiatives à l’égard de participants des trois pays du Triangle pour 2008. Les débats y seront donc bien plus spécialisés l’an prochain et pourront le cas échéant remplir l’objectif de fournir de nouvelles impulsions susceptibles de redynamiser le Triangle de Weimar.
Le comité organise de nombreux séminaires, rencontres et colloques réunissant des experts, personnalités, des politiques, des représentants d’associations sur le thème du Triangle de Weimar. Les comptes rendus des rencontres ainsi qu’une intéressante bibliographie du Triangle de Weimar, les actualités du comité sur http://www.weimarer-dreieck.com/
« …notwendig für die weitere Europäisierung der EU-Lösungen » : G. Krichbaum, lors de la discussion après le panel sur le futur du Triangle de Weimar.
« …the trust in other partners »… « potential suspicious », « transparency » : M. Belka, cf. note précédente.
Remplacé le 20.10.2007 lors d’élections anticipées par un gouvernement bien plus libéral et pro-européen.
Rainer Lindner, président du panel « Poland, Germany, Eastern Europe – Common responsability ».
Aliaksandr Milinkevich, leader du parti d’opposition biélorusse « For Freedom », Forum de Krynica.
Matthias Platzek, Premier Ministre du Land de Brandebourg, dans un bref entretien avec l’auteur. M. Platzek, fervent avocat des relations germano – polonaises, encouragea l’auteur à fermement appuyer la « responsabilité » de la France au vu du potentiel d’une telle médiation au profit d’une reprise du dialogue entre partenaires du Triangle de Weimar.
Géza Jeszenszki, et Borys Tarasjuk, lors d’entretiens avec l’auteur lors du Forum.
M Jeszenszky est expert et fervent promoteur du Groupe de Visegrad (voire p.e. : http://www.eurotopics.net/de/presseschau/autorenindex/autor_jeszenszky_geza/
M Tarasjuk propose depuis plusieurs années un modèle quadrilatéral sur la base du Triangle de Weimar + Ukraine, une idée lancée notamment lors des deux conférences « The Weimar Triangle in the New Europe – Models of cooperation between East and West », initiée et coordonnée par l’auteur à la Villa Decius, Cracovie, en 2002 et 2003. Le concept de M Tarasjuk doit permettre d’appliquer concrètement les expériences de la transformation polonaise à l’Ukraine, avec le soutien institutionnalisé et officiel de la France et de l’Allemagne. Voire pour ceci les publications de la Villa Decius, « Conversations in Villa Decius » numéros 3 et 4.
Reportage radiophonique sur France Inter, Journal, 25.09.2007
Klaus-Heinrich Standke, c.f. note 1. Monsieur Standke tint toutefois à préciser que Nicolas Sarkozy fit cette déclaration il y a plus d’un an. M. Standke précise de plus, que « der Vertreter des AA hat bei der Jubiläumsveranstaltung der FAF in Wetzlar am 28.9. mir gegenüber ausgeschlossen, daß sich die Bundesregierung auf erweiterte geographische Konstellationen über das Weimarer Dreieck hinaus einlassen würde. »; K.H. Standke dans un email à l’auteur.
Ainsi par exemple Rainder Steenblock, porte parole aux affaires européennes du groupe parlementaire Die Grünen, Bundestag, lors du Forum de Krynica.
Voir par exemple le site internet du Comité pour la promotion de la coopération franco-germano-polonaise (« Triangle de Weimar »). http://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/Aktuelles.html particulièrement le rapport sur le prix Adam Miczkiewicz, décerné cette année communément aux Offices germano-polonais et franco-allemand pour la Jeunesse pour leur engagement dans le cadre du Triangle de Weimar. Un rapport détaillé est également disponible sur ces pages.
Email d’un diplomate français présent à Krynica et désirant ne pas être cité nommément. Ce diplomate confirma notamment avoir ressenti, malgré une présence française déjà bien en place au Forum, une sorte d’appel indirect de nombreux participants à la France à s’impliquer davantage. Ce genre de « messages » donnent toute leur importance aux « fora de ce genre », notamment pour une plus grande transparence au sein du Triangle de Weimar.
Grazyna Sleszynska, coordinatrice des participants français à l’IWS (Institut pour les Etudes d’Europe de l’Est), se tient par ailleurs à disposition de par email : g.sleszynska@isw.org.pl
La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne
L'Allemagne et la République tchèque : Histoires de « bons voisinages »
Cet article se propose de retracer dans ses grandes lignes, l’évolution des relations tchéco-allemandes de 1990 à nos jours.Après la chute des régimes de type soviètique en Europe centrale et les bouleversements géopolitiques, les gouvernements de l’Allemagne unifiée et de la Tchécoslovaquie étaient appelés à redéfinir leurs relations. Après l’euphorie du départ et malgré les déclarations des deux parties, d’éviter à l’avenir tout conflit, la question de la gestion du « passé douloureux » commun prit rapidement en importance. Ceci eût au niveau des relations bilatérales un impact négatif que peu avaient au départ soupçonné. Aujourd’hui, quatre ans après l’élargissement de l’UE et après l’entrée de la République tchèque dans l’espace Schengen, les relations entre les deux Etats semblent s’être apaisées. Mais qu’en est-il exactement ?
Si cet article se penche sur les débats autour du passé, il ne s’agit pas pour autant de réduire les relations germano-tchèques à cette unique dimension. Cette analyse interroge quant à aux véritables enjeux des différents acteurs du processus de rapprochement en tenant compte des aspects économiques, politiques et sociaux.
Deutschland und die tschechische Republik : Geschichten einer « guten Nachbarschaft ».
Dieser Artikel befasst sich also mit den Hauptlinien der Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen von 1990 bis heute. Nach dem Fall der kommunistischen Regime in Zentraleuropa und den gewaltigen geopolitischen Änderungen haben die Regierungen des vereinigten Deutschlands und der Tschechoslowakei die neuen Grundlagen ihrer zukünftigen Beziehungen neu definieren müssen. Nach der anfänglichen Euphorie und trotz der Bekundungen beiderseits, jeglichen Konflikt vermeiden zu wollen, tauchte die Frage nach dem « angebrachten » Umgang mit der gemeinsamen und leidvollen Vergangenheit sehr schnell auf. Dies sollte die Beziehungen zwischen beiden Staaten für die folgenden Jahre in einem Masse, die kaum jemand hätte vermuten können, negativ beeinflussen. Heute, vier Jahre nach der EU Erweiterung und unmittelbar nach dem Eintritt der tschechischen Republik in den Schengener Raum, scheinen sich aber die Beziehungen zu dem Nachbarstaat beruhigt zu haben. Wenn dieser Artikel sich mit den Auseinandersetzungen um die Vergangenheit befasst, wird hier dennoch nicht versucht, die deutsch-tschechischen Beziehungen auf diese Dimension zu reduzieren. Diese Analyse hinterfragt die eigentlichen Beweggründe der verschiedenen Akteure des Annäherungsprozesses, wobei die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Aspekte in Betracht gezogen werden.
Germany and the Czech Republic : A story of "Good Neighbours"
This article aims to retrace the principal causes of the evolution of Czech-German relations from 1990 to today. After the fall of Soviet regimes in Central Europe, and the attendant geopolitical disruptions, the governments of the reunified Germany and Czechoslovkia were required to reexamine their relationship. After the initial euphoria, and in spite of declarations from both sides to avoid future conflict, the question over treatment of this common "painful history" rapidly gained importance. In respect of bilateral relations, this had a negative impact that few could have predicted. Today, four years since the enlargement of the EU, and after the Czech Republic's entry into the Schengen Common Travel Area, relations between the two states seem to have eased. But what exactly is the situation? If this article begins by examines the debate over the past, this is not in order to reduce Czech-German relations to this sole context. This analysis demands where the real issues lie, in relation to the different actors involved in this process of reconciliation, taking into account political, economic and social aspects.
Chronique des Länder en 2007
Des élections régionales se sont déroulées à Brême en 2007 et celles de 2008 se préparent déjà activement dans plusieurs Länder. Quels sont les événements politiques et économiques importants qui ont marqué la vie des Länder au cours de cette année ? Les interactions entre les Länder et le Bund ne sont plus à démontrer.
Elections régionales
La ville libre hanséatique de Brême a été le seul des seize Länder à renouveler en 2007 sa diète régionale, appelée non pas Landtag mais Bremische Bürgergesellschaft. Brême a la particularité d'être le plus petit des Länder et de se composer de deux entités urbaines séparées sur le plan géographique par la Basse-Saxe, la ville de Brême et le port de Bremerhaven. Jusqu’en 1999 la diète comptait 100 sièges (80 pour Brême et 20 pour Bremerhaven) ; depuis 2003, elle a été réduite à 83 sièges (68 et 15).
Les élections régionales du 13 mai 2007 ont été marquées par le fort recul de la participation électorale et des deux principaux partis, SPD et CDU, associés dans une grande coalition depuis 1995. Le SPD conserve toutefois sa place de premier parti, jamais remise en cause depuis 1947. Le chef du gouvernement régional, Jens Böhrnsen, SPD, a préféré cette fois-ci renouveler l’ancienne alliance avec les Verts. Il n’existait plus de gouvernement SPD-Verts depuis 2005 après la fin des coalitions régionales (Schleswig-Holstein et Rhénanie du Nord-Westphalie) et fédérale (gouvernement Schröder/Fischer). C’est à Brême que les Verts entrèrent dans la première diète régionale en 1979. Le Land a encore innové en 2007 en donnant un excellent résultat, pour la première fois à l’Ouest, au nouveau parti Die Linke, fondé au niveau fédéral les 16 et 17 juin 2007. Jens Böhrnsen, qui cumule les fonctions de maire de Brême et de chef du gouvernement régional, prend en charge également les affaires religieuses et culturelles. Il assume aussi d’importantes responsabilités au niveau fédéral comme vice-président de la Commission commune Bundestag-Bundesrat pour la modernisation des relations financières Bund-Länder et comme président de la Commission de conciliation entre le Bundestag et le Bundesrat pour la présente législature du Bundestag (2005-2009).
Les campagnes électorales ont été lancées dès 2007 dans les quatre Länder qui vont renouveler leurs diètes régionales en 2008 : Basse-Saxe et Hesse le 27 janvier, Hambourg le 24 février et Bavière le 28 septembre. Les trois premiers Länder ont été conquis assez récemment par la CDU sur le SPD et l’enjeu du scrutin sera de savoir si la CDU se maintiendra en première position, l’issue en Hesse est ouverte .La CDU avait profité du mécontentement suscité par les réformes du chancelier Schröder ; maintenant elle sera confrontée aux critiques des électeurs qui lui reprochent d’être trop timorée sur le plan social. Le problème de la CSU est de conserver la majorité absolue qu’elle détient depuis 1962 – un record absolu dans l’histoire politique de la République fédérale.
Après de longues batailles juridiques, le Tribunal administratif fédéral de Leipzig a autorisé en Basse-Saxe l’utilisation des mines de sel de Salzgitter comme lieu de stockage définitif des déchets nucléaires faiblement ou moyennement radioactifs. La bataille n’est pas terminée pour autant car il faut déterminer les prises en charge financières de l’Etat fédéral, du Land et des entreprises concernées.
Elections régionales à Brême
23.5.2003 3.5.2007 +/-
Inscrits 481 743 496 073 -14 330
Participation 61,32% 57,57% -3,74 pts.
Voix nulles 1,23% 1,37% +0,14 pts.
Exprimées 291 766 276 022 -15 744
% voix % voix
SPD 42,32 36,74 - 5,58
CDU 29,76 25,66 - 4,09
Verts 12,80 16,49 + 3,69
FDP 4,21 5,98 + 1,77
DVU 2,28 2,74 + 0,46
Die Linke 1,67 8,44 + 6,77
Autres 6,94 3,94 - 3,0
Les sièges
* 2007
SPD 40 33
CDU 29 23
Verts 12 14
FDP 1 5
DVU 1 1
Die Linke 0 7
_______________________________
* 83
En Hesse, le chef du gouvernement régional, Roland Koch, à la tête d’une majorité absolue CDU, se voit reprocher d’avoir proposé le remboursement des frais de campagne pour les élections communales de la Freie Wählergemeinschaft contre une non participation aux élections régionales (pour ne pas gêner la CDU). Le rapport final de la Commission parlementaire a été remis fin juin 2007 ; pour le SPD, les accusations sont fondées, la CDU les récuse fermement.
Deux femmes se font remarquer dans la vie politique du Land. En janvier 2007, Petra Roth, CDU, a été brillamment réélue avec 60,5% des voix pour un troisième mandat de maire à Francfort-sur-le-Main. Andrea Ypsilanti, sociologue de formation, députée régionale, présidente régionale du SPD, conduira son parti aux prochaines élections. Représentante de l’aile gauche, elle pourrait mettre en difficulté Roland Koch, à qui on prête l’intention d’entrer à la Commission européenne à Bruxelles. La Hesse a longtemps été dirigée par le SPD avant de passer à la CDU.
A Hambourg, le chef du gouvernement régional, appelé président du Sénat (nom du gouvernement) et Maire, s’appuie aussi sur une majorité absolue de la CDU qui sera difficile à maintenir. Après bien des déchirements internes, le SPD a surpris en désignant comme tête de liste aux élections régionales Michael Naumann, éditeur de l’hebdomadaire Die Zeit, éphémère ministre des Affaires culturelles du gouvernement Schröder. Après une longue bataille juridique, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les deux dernières plaintes visant à empêcher l’extension des usines Airbus à Hambourg.
La Bavière a souvent fait la une des journaux à cause de la démission forcée du chef du gouvernement régional, Edmund Stoiber, candidat malheureux de la CDU-CSU en 2002. Celui-ci a fortement compromis son autorité en briguant après les élections fédérales de 2005 le poste de ministre fédéral de l’Economie dans le futur gouvernement Merkel, puis en se retirant au milieu des négociations pour des motifs peu convaincants. La fronde contre Edmund Stoiber, qui voulait rester au pouvoir à Munich jusqu’en 2013, a été déclenchée par les critiques provocantes de Gabrielle Pauli, CSU, Landrätin à Fürth depuis 1990 ; personnage fantasque, elle pose pour des magazines dans des tenues osées et elle a même proposé d’instaurer le mariage à l’essai pour une durée de sept ans. Edmund Stoiber a dû finalement annoncer le 18 janvier 2007 qu’il quitterait ses fonctions le 30 septembre suivant.
Erwin Huber, 61 ans, ministre bavarois de l’Economie, a été élu président de la CSU contre Madame Pauli et Horst Seehofer, ministre fédéral de l’Agriculture. Marié et père de deux enfants, Horst Seehofer a hésité entre sa famille en Bavière et sa maîtresse à Berlin (une collaboratrice de la CDU dont il a eu une petite fille en juin 2007) pour rester finalement auprès de sa première famille ; cette liaison très médiatisée ne pouvait guère servir sa candidature. Le populaire ministre de l’Intérieur, Günther Beckstein, 63 ans, a été élu ministre-président de Bavière, le 9 octobre. Il s’est fait connaître pour la fermeté de ses positions en matière de sécurité intérieure et à propos de la politique de l’immigration.
Les Länder de l’Ouest
Le chef du gouvernement du Bade-Wurtemberg, Günther Oettinger, CDU, a beaucoup choqué le 21 avril 2007, avec son éloge funèbre déplacé de Hans Filbinger (ministre-président de 1966 à 1978) dont il a fait un opposant au national-socialisme. Juge dans la marine pendant la guerre, il avait fait fusiller des soldats dans les derniers jours du conflit, coupables de désobéissance ou de désertion. Bien que se considérant comme victime d’une campagne de diffamation, il fut contraint de démissionner en 1978. Président d’honneur de la CDU, il connut une sorte de réhabilitation en appartenant à la délégation régionale de la CDU, chargée d’élire le nouveau président de la République fédérale en 2004. Vivement critiqué par la chancelière Angela Merkel, Günther Oettinger a dû présenter ses excuses. Le Land de Bade-Wurtemberg a voté en 2007 une loi sur l’incompatibilité entre le maintien dans la fonction publique et l’exercice d’un mandat électoral. Le Land de Brême serait le dernier à autoriser les fonctionnaires à rester dans leur administration, même s’ils sont élus.
Suicide ou meurtre ? Vingt ans après les faits, le Schleswig-Holstein se perd en conjectures sur les raisons de la mort violente de son ministre-président de l’époque, Uwe Barschel, CDU, dont le cadavre fut découvert le 11 octobre 1987 dans la baignoire du grand hôtel Beau Rivage de Genève. Par des méthodes tout à fait condamnables, Uwe Barschel avait essayé de déstabiliser Björn Engholm, SPD, son adversaire aux élections régionales. Les services secrets ont peut-être joué un rôle dans cette sombre affaire où il était question aussi de ventes d’armes.
Le Schleswig-Holstein était le seul Land à ne pas disposer de tribunal constitutionnel régional. Cette lacune est désormais comblée depuis la fin 2006. Auparavant les différends constitutionnels étaient traités par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. En juillet 2007, le Schleswig-Holstein et le Danemark se sont entendus pour construire un pont de dix-neuf kilomètres de long entre les ports de Puttgarten et Rodbyhavn.
Par un accord avec le gouvernement fédéral et les entreprises concernées, la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Sarre ont décidé de mettre fin à l’extraction du charbon en 2018, un réexamen de la situation étant toutefois envisagé en 2012. L’activité minière, qui avait joué un rôle si important dans l’ascension industrielle de l’Allemagne, s’est considérablement réduite depuis une vingtaine d’années. Elle n’est plus assez rentable face à la concurrence étrangère. Pour une production de 21 milliards de tonnes, elle employait, en 2006, 35 000 personnes. La même année, ses recettes apparentes de 4,5 milliards d’euros étaient artificiellement gonflées par des subventions d’un montant de 2,4 milliards.
Bien que les élections régionales en Sarre ne se dérouleront qu’en 2009, l’opinion s’interroge beaucoup sur les chances d’une percée d’Oskar Lafontaine, ancien ministre-président du Land, devenu co-président de Die Linke en 2007. Déjà aux élections fédérales de 2005, la WASG (Wählerinitiative Soziale Gerechtigkeit), qui rassemblait les mécontents des réformes du chancelier Schröder, avait obtenu sous son impulsion 8,5% des voix. Toujours populaire dans son Land d’origine, Oskar Lafontaine rend la vie difficile à son ancien fils spirituel, Heiko Maas, président du SPD sarrois. L’épouse d’Oskar Lafontaine, Christa Müller, se fait également remarquer par sa campagne pour le développement des crèches et pour l’attribution d’un salaire parental de 1600 euros par mois. La CDU de Peter Müller détient la majorité absolue en Sarre.
Les Länder de l’Est
La Saxe est celui des cinq Länder de l’Est qui a fait le plus parler de lui, mais en termes peu flatteurs. Des rumeurs circulent sur l’existence d’un réseau criminel composé de personnalités de la vie économique, politique et judiciaire, soupçonné de corruption, d’abus de pouvoir, de malversations immobilières et de prostitution. Le président de l’Office régional de protection de la constitution a dû démissionner en juin 2007. Le groupe parlementaire CDU s’oppose à la création d’une commission d’enquête. Le chef du gouvernement régional Georg Milbradt dirige une grande coalition CDU-SPD. Au temps de son premier ministre-président, Kurt Biedenkopf, CDU (56,9% aux élections de 1999), la Saxe passait pour un Land exemplaire. En 2004, Georg Milbradt l’emporte avec 41,1% des voix ; en août 2007 un sondage ne donnait plus que 38% des intentions de vote pour la CDU. Le SPD ayant toujours été très faible dans ce Land depuis 1990, ces affaires pourraient profiter à Die Linke. Les élections communales de 2008 fourniront à ce titre un test intéressant. Il se pourrait que Thomas de Maizière, CDU, ancien ministre de l’Intérieur de Saxe et actuel chef des services administratifs de la chancellerie à Berlin, revienne en Saxe comme ministre-président.
La Saxe-Anhalt s’est distinguée lors des élections communales du 22 avril 2007 par le taux de participation le plus faible de toute l’histoire de la République fédérale (36,5%) et un taux important de voix nulles (3,2%). Il est vrai que ces élections, qui ne concernaient pas la totalité du Land , se déroulaient dans le cadre d’une réforme très impopulaire des structures communales et régionales, accompagnée par des suppressions d’emplois dans la fonction territoriale.
Bien que le projet de fusion entre Berlin et le Brandebourg ait échoué, les deux Länder se sont enfin entendus, après 15 ans de querelles, pour construire l’aéroport Berlin-Brandebourg International (BBI), sur l’emplacement de Schönefeld, l’ancien aéroport de la RDA, au sud de Berlin. Coût de l’opération : 2 milliards d’euros. Prévu pour accueillir entre 22 et 24 millions de passagers par an, le BBI viserait même ultérieurement 40 millions. Il deviendra le troisième aéroport d’Allemagne.
Après des années de querelles et de tergiversations, pour des raisons qui touchent à la fois à la mémoire et aux finances, le gouvernement fédéral et la ville de Berlin ont annoncé le 23 avril 2007 la décision de reconstruire le château royal situé au centre de Berlin, bombardé pendant la guerre et détruit par le régime communiste de la RDA. Le futur « Forum Humboldt » se consacrera à la culture (musique, théâtre, manifestations) et accueillera des collections des musées de Dahlem. Coût de l’opération : 480 millions d’euros, dont 32 à la charge de la ville de Berlin, le reste devant être couvert par l’Etat fédéral et par des dons. Avec un endettement public de 61 milliards d’euros, les finances de Berlin vont mal. La Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe a toutefois rejeté, le 19 octobre 2006, la plainte du Land, déposée en 2003, afin d’obliger l’Etat fédéral à aider davantage la ville. La Cour a jugé que Berlin ne se trouvait pas dans une situation dramatique, son problème n’étant pas celui des recettes, mais plutôt des dépenses publiques mal maîtrisées.
Le Nord et le Sud
Les Länder méridionaux, qui obtiennent d’excellents résultats économiques, vivent mieux que ceux du Nord, la Bavière et le Bade-Wurtemberg offrant le degré le plus élevé de sécurité. Les habitants de ces Länder seraient moins menacés par la pauvreté et la criminalité. Les mêmes constatations valent pour les revenus et l’emploi. Ce sont les conclusions d’une étude de la Fondation Bertelsmann qui paraît pour la quatrième fois depuis 2001.
Länder et gouvernements régionaux
Onze Länder dirigés par la CDU (CSU)
Land Chef du gouvernement (depuis…) Gouvernement Elections
Bade-Wurtemberg Günther Oettinger, CDU (2005) CDU-FDP 2011
Basse-Saxe Christian Wulff, CDU (2003) CDU-FDP 27.1.2008
Bavière Günther Beckstein, CSU (2007) CSU 28.9.2008
Hambourg Ole von Beust, CDU (2001) CDU 24.2.2008
Hesse Roland Koch, CDU (1999) CDU 27.1.2008
R.du N.-Westph. Jürgen Rüttgers, CDU (2005) CDU-FDP 2010
Sarre Peter Müller, CDU (1999) CDU 2009
Saxe Georg Milbradt, CDU (2002) CDU-SPD 2009
Saxe-Anhalt Wolfgang Böhmer, CDU (2002) CDU-SPD 2011
Schlewig-Holstein Harry Carstensen, CDU (2005) CDU-SPD 2010
Thuringe Dieter Althaus, CDU (2003) CDU 2009
Cinq Länder dirigés par le SPD
Berlin Klaus Wowereit, SPD (2001) SPD-PDS 2011
Brandebourg Matthias Platzeck, SPD (2002) SPD-CDU 2009
Brême Jens Böhrnsen, SPD (2005) SPD-Verts 2011
Mecklembourg-P.a. Harald Ringstorff, SPD (1998) SPD-PDS 2011
Rhénanie-Palatinat Kurt Beck, SPD (1994) SPD 2011
Les législatures durent quatre ans dans trois Länder (Brême, Hambourg et Saxe-Anhalt) et cinq ans dans tous les autres.
* Professeur à Paris III – Sorbonne Nouvelle et directeur du Centre universitaire d’Asnières.
Actualité politique et sociale, octobre 2007
octobre 2007
Ces derniers mois, le débat public en Allemagne a porté sur les problèmes de cohabitation de la grande coalition, ce qui n'est pas nouveau. Les dissensions autour du maintien de l’agenda 2010 continuent à agiter les esprits. Le mouvement social des cheminots, déjà évoqué dans le numéro précédent d’Allemagne d’aujourd’hui, n’a toujours pas trouvé d’épilogue, bien qu’on semble s’acheminer vers une solution acceptable par les deux partis en conflit. Les trente ans de « l’automne chaud » de la RAF, associés à la recrudescence d’attentats terroristes ont été repris dans les médias, de même que le hiatus ressenti entre l’amélioration de l’économie que reflètent les statistiques et le constat que la situation de l’Allemand moyen, notamment celle des enfants, se dégrade.
La pauvreté des enfants s’accroît
Cet été, c’est la pauvreté des enfants qui a fait la une des médias. Le rapport sur la pauvreté et la richesse en Allemagne présenté par Karl Josef Laumann, ministre de l’Emploi en Rhénanie du Nord - Westphalie, ainsi que les chiffres publiés par la fédération de protection des enfants (Kinderschutzbund) ont trouvé un large écho auprès du public. Bien que les chiffres avancés par les différentes instances ne concordent pas complètement, il ne fait pas de doute que de plus en plus d’enfants vivent dans la pauvreté. Environ 2,5 millions d’enfants seraient concernés actuellement, c’est-à-dire un jeune de moins de 18 ans sur quatre, 100 000 de plus que l’année dernière. Ce chiffre est en hausse constante : alors qu’en 2003, la pauvreté touchait 13,5 % de la population, elle en touche désormais 14,3 %. Une famille est considérée comme pauvre, si le niveau de ses revenus, d’après la définition de l’OCDE, est égal ou inférieur à 60 % du revenu médian national ; celui-ci est de 3 148 € brut par mois en 2007. La situation semble paradoxale. Le chômage ne cesse de reculer. Il est passé de près de 5 millions de chômeurs en 2006 à environ 3,7 millions cet été, et le gouvernement s’attend à ce que la baisse se poursuive, en dépit du ralentissement économique – le « trou d’air » pudiquement évoqué par les milieux politiques – prévu pour les mois à venir. Or, le nombre d’Allemands vivant des aides sociales, 7,4 millions, n’a jamais été aussi élevé.
Une des raisons les plus fréquemment avancées pour expliquer la montée de la pauvreté des enfants est l’appauvrissement des familles fragiles introduites par les mesures de la réforme Hartz. Un rapport récent de l’institut de Brême BIAJ (Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugend-berufshilfe) a indiqué que presque 2 millions d’enfants vivent dans des familles dites Hartz IV, soit 17% des enfants allemands. Il s’agit de familles qui perçoivent l’allocation chômage II versée aux chômeurs de longue durée. Son montant est censé couvrir les besoins du minimum vital. Il correspond grosso modo au RMI français. Dans ce cadre, un enfant de moins de 14 ans perçoit un versement de 208 €, l’allocation est portée à 278 € pour un mineur plus âgé. Même si on y ajoute les allocations familiales (145 € par enfant) et le versement du loyer et du chauffage prévu par Hartz IV, de nombreuses familles vivent dans une pauvreté telle qu’elles sont réduites à emmener leurs enfants à la soupe populaire. Depuis quelques années, de nombreuses cantines gratuites se multiplient en Allemagne, notamment à Berlin, qui servent une soupe populaire aux enfants et aux adolescents. Sont tout particulièrement touchés les enfants vivant dans des familles nombreuses, monoparentales, immigrées ou dont les parents sont au chômage.
Le gouvernement d’Angela Merkel est conscient de la situation précaire faite à de nombreux enfants, et ce dans un pays qui souffre déjà d’une natalité très insuffisante. Au mois d’août, à l’issue de son séminaire de rentrée, le gouvernement a indiqué qu’il prendrait des mesures en faveur des enfants pauvres : augmentation des allocations familiales versées aux petits salaires, hausse des indemnités de chômage pour les familles nombreuses, accroissement important du nombre de places en crèche. L’annonce de ces mesures a toutefois suscité un certain scepticisme, car la plupart des acteurs sociaux estiment qu’il serait préférable de s’aligner sur l’expérience française et de financer des prestations (maternelle gratuite, p.ex.) qui profitent directement aux enfants plutôt que de verser de l’argent aux parents dont on ne sait pas si les enfants en bénéficient vraiment.
Stagnation des salaires
Le quotidien Bild, le journal allemand à grand tirage le plus lu dans le pays, a initié un grand débat au mois de septembre qui n’est pas sans rappeler celui du printemps portant sur l’introduction ou non d’un SMIC à l’allemande, question qui continue de diviser la grande coalition au pouvoir. Se basant sur des statistiques du ministère du Travail, le journal a affirmé sous le titre « Der Netto-Lohn-Skandal » que les salaires des Allemands stagnent depuis le milieu des années quatre-vingt. Pire : ils stagnent, dit-il, parce que l’Etat, par le biais des cotisations sociales et des impôts sur le revenu, met de façon éhontée la main dans la poche du petit salarié. Les journalistes de Bild affirment que le salaire annuel s’élevait à 15 845 € nets par an en 2006, contre 15 785 en 1986, ce qui reviendrait à 1320 € net par mois en 2006 et presque autant, à savoir 1315 € en 1986. Net signifie en Allemagne ce que le salarié voit arriver sur son compte en banque, après versement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu effectué par son employeur. Le salaire moyen des Allemands aurait même baissé, puisqu’il était de 17 251 € en 1992. En 2006, l’Etat aurait prélevé 9 291 € sur les salaires sous forme d’impôt et de cotisations sociales, un record historique, affirme Bild, qui compare ce chiffre aux 5 607 € perçus par l’Etat en 1986. Les prélèvements en monnaie courante ont donc augmenté de 66%, alors que les salaires n’ont grimpé que de 48% pendant le même laps de temps.
Cette démonstration a immé-diatement suscité des réactions, tant de la part du gouvernement que des autres médias en Allemagne. Le ministère du Travail fait observer qu’on ne peut comparer les chiffres de 2006 et de 1986, puisque le premier s’applique à l’Allemagne unifiée, alors que le second ne concerne que l’ancienne Allemagne de l’Ouest. En outre, si les prélèvements ont augmenté, le rapport entre salaire net et brut, lui, n’aurait pas varié, ce qui dément une ponction accrue de la part de l’Etat. Le ministère concède toutefois que les accords salariaux – un plus de 4,1% en cinq ans – sont restés à la traîne par rapport à l’inflation qui a grimpé de 7,1% pendant le même laps de temps. D’autres voix se sont fait entendre pour s’inscrire en faux contre l’analyse du Bild. Constatant que le pouvoir d’achat est resté le même en vingt ans, elles se félicitent de la modération salariale qui aurait permis d’améliorer la compétitivité de l’Allemagne et de conforter son rang de premier exportateur du monde.
Cette polémique a toutefois conforté les prises de position des sociaux-démocrates, qui ont une nouvelle fois plaidé pour l’introduction d’un salaire minimum généralisé, qui n’existe pour l’instant que dans quelques branches. Le vice-chancelier Franz Müntefering, SPD, a souligné le déséquilibre entre travail et capital en demandant à ce que l’évolution salariale « profite à nouveau davantage de l’essor économique ». Il est vrai que les récentes remises en cause d’acquis sociaux – versement des primes de Noël et de vacances, allongement de la durée du travail sans compensation salariale – ont contribué à la stagnation des rémunérations.
Trente ans après « l’automne chaud », la RAF traumatise encore les Allemands
L’affrontement entre l’Etat et le terrorisme de la RAF (Rote Armee Fraktion), qui a connu son paroxysme lors de « l’automne » chaud » en 1977, a donné lieu à de vifs débats à la rentrée, trente ans après les faits. Il a commencé le 5 septembre 1977, lorsque Hanns Martin Schleyer, président de l’association patronale allemande, a été enlevé par des membres de la RAF dans une équipée sanglante où le chauffeur et les gardes du corps ont tous été tués. Le lendemain, le « commando Siegfried Hausner » exigea la libération de onze « prisonniers de conscience », dont Andreas Baader et Gudrun Ensslin, contre la vie de Hanns Martin Schleyer. Celui-ci aurait pu être libéré très vite, si le rapport d’un policier qui avait repéré l’appartement où il était séquestré, ne s’était pas perdu dans les méandres de l’administration. Les autorités n’ayant pas cédé au chantage, l’affaire s’est terminée par un détournement d’avion un mois plus tard. Le 13 octobre, la RAF organisa, avec l’aide de sympathisants du Front populaire de libération de la Palestine, le détournement d’un avion de la Lufthansa pour obtenir la libération des onze membres emprisonnés à Stammheim et de deux Palestiniens en prison en Turquie. Après une longue odyssée à travers le Moyen Orient, les quatre pirates de l’air décidèrent de se poser à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Le 18 octobre, un commando des forces spéciales allemandes prit d’assaut le Boeing 737 et libéra les passagers après avoir tué trois des preneurs d’otages.
Quelques heures après l’échec de la prise d’otage, Baader, Ensslin et Raspe étaient retrouvés morts dans leurs cellules de la prison de haute sécurité de Stammheim. Le rapport d’enquête a conclu au suicide. Ils se seraient tués avec des armes introduites dans la prison par un de leurs avocats. Un jour plus tard, le cadavre de Hanns Martin Schleyer était découvert dans le coffre d’une voiture à Mulhouse. Au total, l’organisation terroriste a assassiné 34 personnes, dont le procureur fédéral Siegfried Buback. Elle s’est officiellement dissoute en 1998.
Le trentième anniversaire de cet enlèvement particulièrement brutal a soulevé une vaste polémique, parce qu’il coïncide avec la sortie de prison de deux membres de la RAF, Brigitte Mohnhaupt et Eva Haule, condamnées à la détention à perpétuité. Christian Klar, condamné à la même peine, s’est vu refuser la grâce par le président de l’Etat allemand Horst Köhler, non sans avoir alimenté les critiques par sa décision de l’entendre en prison. Christian Klar, qui doit rester en prison au moins jusqu’en janvier 2009 et Birgit Hogefeld, condamnée en 1996, elle aussi à la perpétuité, sont les derniers à être encore en prison. La libération de Mohnhaupt et de Haule est très contestée, tant dans les milieux politiques que dans l’opinion publique. Si certains, comme l’ancien ministre libéral des Affaires étrangères Klaus Kinkel, estiment que « tout le monde doit avoir une chance de se retrouver au sein de la société », d’autres, notamment au sein de la CDU et de la CSU, y sont très hostiles. Une hostilité partagée par la majorité de la population. Un sondage publié par le magazine Der Spiegel a révélé que 71% des Allemands étaient opposés à une mesure de grâce si les anciens terroristes de la RAF ne faisaient pas publiquement montre de remords. C’est peut-être pour cette raison que certains des huit membres de la RAF libérés depuis le début des années quatre-vingt-dix ont préféré changer de nom pour réintégrer la société, qui en tant que photographe ou journaliste, qui dans l’enseignement ou l’humanitaire.
Avec seulement deux anciens militants de la RAF encore derrière les barreaux – sans oublier les quatre en cavale – cet épisode sanglant devrait normalement être clos, même dans la perception du public, s’il n’y avait pas actuellement cette crainte d’une recrudescence du terrorisme en Allemagne qui amène l’opinion publique à faire l’amalgame entre deux phénomènes très différents.
Attentat islamiste déjoué
L’Allemagne est de façon croissante la cible de terroristes. Début septembre, trois suspects ont été arrêtés avant qu’ils aient pu passer à l’acte. Il s’agit de deux Allemands convertis à l’islam et d’un Turc installé depuis longtemps outre-Rhin. Ils s’étaient procuré du matériel leur permettant de construire des bombes dont la charge aurait largement dépassé celles des attentats de Madrid le 11 mars 2004 et de Londres le 7 juillet 2005, capables de faire des centaines de victimes. Selon Monika Harms, procureure fédérale, il s’agirait « de la plus grave tentative d’attentat » à laquelle l’Allemagne ait dû faire face jusqu’à présent. Au moment où la police allemande a mis la main sur les trois terroristes présumés, qui s’apprêtaient à fabriquer des bombes dans un appartement à Medebach-Oberschledorn, petite ville en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ils n’avaient pas encore choisi de cible précise ; aux dires des enquêteurs, ils visaient probablement des établissements américains tels que la base militaire américaine de Ramstein, l’un des points d’appui logistique de l’armée américaine pour ses opérations en Irak et en Afghanistan, ou l’aéroport international de Francfort. Il n’est pas exclu qu’ils aient voulu marquer la date anniversaire de l’attentat de New York en faisant exploser leurs engins le 11 septembre.
Monika Harms a indiqué que les trois hommes arrêtés, qui seraient passés par un camp d’entraînement au Pakistan, appartiennent à une cellule allemande de l’Union islamique du djihad, un groupe sunnite créé en 2003, originaire d’Ouzbékistan et lié à Al-Qaida. Depuis 2005, il figure sur la liste des groupes terroristes établie par le gouvernement américain. Mise en garde par Washington à l’automne 2006, l’Allemagne se savait en ligne de mire de cette organisation. C’est l’engagement croissant de soldats allemands de la Bundeswehr à l’étranger et le stationnement de troupes en Afghanistan qui ont fait de l’Allemagne une cible privilégiée pour les terroristes. En juillet 2006 déjà, deux Libanais avaient tenté de faire exploser deux bombes déposées dans des trains. Cette tentative d’attentat n’a pas été déjouée par hasard. Les trois hommes avaient été placés sous surveillance de la police criminelle fédérale (Bundes-kriminalamt), qui a mobilisé un nombre important de fonctionnaires – entre 300 et 600, selon les sources – depuis la fin de l’année 2006, ce qui fait dire à certains que les pouvoirs publics ont trop tardé à intervenir.
Les enquêteurs sont inquiets du profil des suspects : deux d’entre eux sont nés en Allemagne et non issus de l’immigration, le troisième est probablement Turc, deux origines qui, jusqu’à présent, n’étaient guère impliqués dans ce genre d’attentat. Dans la mesure où plusieurs milliers d’Allemands se convertissent chaque année à l’islam, les experts redoutent que certains d’entre eux soient tentés par l’action violente. Des membres du gouvernement, notamment le ministre de l’Intérieur Wolfgang Schäuble (CDU), réclament un renforcement de l’arsenal antiterroriste, en particulier dans le domaine de la surveillance informatique.
Durcissement de la législation anti-terroriste : l’espionnage informatique en débat
L’attentat islamiste déjoué en septembre a rallumé le vif débat autour de la protection souhaitable et nécessaire dans un Etat de droit. Cette discussion qui se focalise actuellement sur la possibilité de fouiller à distance les ordinateurs de terroristes souhaitée par le ministre de l’Intérieur Wolfgang Schäuble, a été initiée après l’attentat manqué à la valise piégée contre deux trains régionaux au mois d’août 2006. A la suite de cette tentative d’attentat, dont les auteurs présumés ont été repérés grâce à la vidéo-surveillance, le gouvernement a décidé de créer un fichier antiterroriste central. Mesure tardive comparée à d’autres pays, cette mise en commun de données, effective depuis le mois d’avril 2007, a toujours été proscrite, de peur de raviver le souvenir de la Gestapo.
Pour Wolfgang Schäuble, c’est un pas dans la bonne direction, mais il estime que cela ne va pas assez loin. Il veut que la police criminelle fédérale (Bundes-kriminalamt) obtienne le droit d’accéder à distance aux ordinateurs de terroristes présumés et de fouiller leurs disques durs à leur insu. Actuellement, une telle mesure est interdite. Le 5 février 2007, la Cour fédérale de justice a rendu une décision déclarant « illégale » la perquisition par la police d’un ordinateur privé à l’insu des intéressés. Elle avait été saisie par le parquet, qui voulait utiliser les données informatiques obtenues de cette manière dans une enquête antiterroriste. La Cour relève que l’espionnage d’un ordinateur s’apparente à la perquisition d’un domicile qui peut être menée à l’improviste, mais seulement en présence des intéressés. Les partisans d’une protection des données personnelles se sont félicités de cette décision, estimant que le piratage informatique par la police constitue une atteinte à l’autodétermination en matière d’information.
Wolfgang Schäuble ne l’entend pas de cette oreille. Après la décision de la Cour fédérale de justice, il a annoncé que le gouvernement présenterait bientôt un projet de loi au Bundestag pour réformer le code de procédure pénale et autoriser l’intrusion de la police dans les ordinateurs des particuliers. Il estime que l’informatique est devenu une « véritable université parallèle et en même temps un camp d’entraînement pour apprentis terroristes ». En outre, cette mesure est déjà appliquée dans le cas de personnes suspectées d’appartenir à une organisation criminelle. L’idée du ministère de l’Intérieur est d’accéder à l’ordinateur d’un suspect, notamment à ses courriels, sans qu’il s’en rende compte, ou de suivre en temps réel son activité. Les experts du Bundeskriminalamt prévoient de recourir à des « chevaux de Troie », des espèces de virus à introduire dans l’ordinateur par le truchement d’un E-mail en provenance d’une institution officielle anodine. Pour rassurer l’opinion publique, le BKA s’applique à minimiser le projet : ce piratage n’interviendrait que « cinq à dix fois par an » et ne serait possible qu’avec l’aval de la police.
Si Peter Schaar, le responsable du gouvernement pour la liberté informatique, s’oppose avec énergie à ce projet de Wolfgang Schäuble, CDU, les réactions des sociaux-démocrates sont plus mitigées. Ils se souviennent sans doute de l’époque où Otto Schily, leur ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Schröder, avait lui-même autorisé les services secrets à procéder à de telles perquisitions à distance. Wolfgang Schäuble, quant à lui, n’a pas l’intention d’en rester là : en dehors de l’espionnage informatique , il souhaite étendre la vidéo surveillance, élargir les pouvoirs de la police, voire autoriser des interventions militaires dans le pays même. L’Etat policier en marche, selon ses détracteurs.
- Brigitte LESTRADE -
Brigitte.Lestrade@u-cergy.f
Chronique culturelle et littéraire
Cet automne, le cinéma allemand s'est de nouveau invité à Paris, au cinéma l’Arlequin. Une belle tradition qui permet au public français de découvrir les productions les plus récentes, présentées à la Berlinale en février, ou sorties depuis sur les écrans en Allemagne. Parmi les films remarqués à Berlin, on trouve Yella de Christian Petzold (D, 2007, 89’) et Ferien de Thomas Arslan (D, 2007, 91’). Yella, interprétée par Nina Hoss qui a été couronnée pour ce rôle avec l’ours d’argent, est l’histoire d’une jeune femme de l’Est de l’Allemagne qui, après un mariage raté, va s’installer à l’Ouest pour trouver du travail. Depuis que son mari a essayé de l’entraîner dans la mort et qu’elle s’est échappée de justesse des flots de l’Elbe, Yella vit comme dans un rêve. A l’Ouest, elle a rencontré Philipp et découvre avec lui, à présent son assistante, le monde des finances et du capital à risques. Une profonde connivence lie ces deux êtres et elle se sent à l’aise dans sa nouvelle vie. Mais les bruits et les voix du passé envahissent constamment le présent, le traumatisme qu’elle a vécu la poursuit. Yella est déchirée entre la réalité et le rêve, elle est rattrapée tantôt par l’une, tantôt par l’autre. Un film prenant, avec des prises de vue denses, qui a été qualifié « d’énigme cinématographique d’une profondeur philosophique ».
Avec Ferien de Thomas Arslan, l’actuel cinéma allemand traite, à l’instar de la littérature – nous y reviendrons – des questions liées à la famille. Pendant un été, les différentes branches d’une famille recomposée se retrouvent dans une maison de campagne où, peu à peu, les conflits sous-jacents et les tensions accumulées éclatent au grand jour. Pour caractériser son film, le réalisateur renvoie, lors d’un entretien, à Tolstoï, selon lequel les familles heureuses se ressemblent, mais que chaque famille malheureuse l’est à sa façon. Entre moments heureux et vérités fâcheuses, ce film, avec Angela Winkler dans le rôle principal, sonde les « nuances du vivre ensemble » sans porter de jugement sur tel ou tel comportement.
Parmi les films documentaires présentés au festival à Paris, on trouve Der rote Elvis (D, 2007, 90’) de Leopold Grün, un portrait du chanteur et acteur Dean Reed, devenu une idole rock en RDA dans les années 1970. Cet Américain du Colorado avait ses premiers succès musicaux en Amérique du Sud, devançant Elvis au hit-parade. C’est là que la prise de conscience de la pauvreté et de l’inégalité le conduisait à la politisation. Après une série de concerts en Union soviétique en 1966 – il y fut le premier chanteur américain – et une courte carrière d’acteur en Italie, il se rend en 1970 au Festival International du film documentaire à Leipzig. Il y rencontre sa future femme et s’installe définitivement en RDA en 1972 où il continuait sa carrière de chanteur et d’acteur.
Le documentaire tente de reconstituer les différentes étapes de la vie de cette star rock et country qui séduisait les jeunes derrière le Mur, depuis son succès en Amérique latine jusqu’à son suicide en 1986. Il essaye d’éclairer les raisons de son engagement, montre les différentes facettes de star et interroge sa position en RDA où le pouvoir politique l’instrumentalise en tant que « chanteur de la paix ». Le réalisateur convoque des témoins de l’époque, ses amis, ses ex-femmes, sa biographe américaine, ainsi que Armin Müller-Stahl qui décrit sa position (réticente) dans l’affaire Biermann ou encore Egon Krenz, à l’époque responsable de l’organisation de la jeunesse. Dans l’ensemble, se dégage l’image d’un personnage pris dans ses propres contradictions, qui, avant tout, s’aime voir en star – indépendamment du contexte idéologique dans lequel il s’inscrit – et qui vit mal le déclin de son succès dans les années 1980, où il est tout simplement un être anachronique. On reste toutefois avec une certaine insatisfaction, avec l’impression que le portrait ainsi dégagé manque d’épaisseur. Peut-être est-ce le personnage lui-même qui en manque, peut-être l’existence de documents provenant de lui-même auraient été en mesure d’éclairer ses positions de manière plus convaincante.
Un des moments forts du festival fut le film de clôture de Fatih Akin, Auf der anderen Seite (D, 2007, 122’). Ici les destins se croisent incessamment, entre l’Allemagne et la Turquie, entre différentes générations, entre hommes et femmes, entre engagement politique et vie ordinaire. Il y a Ali, le vieil immigré turc et Yeter, venu s’installer comme prostituée à Brême pour financer les études de sa fille Ayten. Les deux se lient. Il y a Nejat, le fils d’Ali, professeur de littérature à l’Université. Il part en Turquie à la recherche d’Ayten suite au décès de Yeter, accidentellement tué par son père Ali. Ayten, de son côté, était venue en Allemagne. Faisant partie d’un réseau politique clandestin, elle est recherchée et doit partir avec un faux passeport comme seul bagage. Lotte, l’étudiante, rencontrée à l’Université, l’héberge chez elle et prend conscience du combat d’Ayten. Alors que Susanne, la mère de Lotte, est plus réticente par rapport à l’aide illégale procurée par sa fille et par rapport à la politisation croissante de cette dernière. Hanna Schygulla interprète magistralement ce rôle d’une mère effacée d’abord, puis combattante elle aussi, qui, à la fin du film, fera un plaidoyer pour le pardon, après avoir perdu sa fille Lotte tuée accidentellement à Istanbul.
Dans ce film, tous les personnages sont intimement liés entre eux, souvent à leur insu. Leurs chemins se croisent, leurs destins aussi, mais rien n’est prévisible, le réalisateur déjoue constamment les attentes du spectateur. Le personnage qui concentre les fils des différentes intrigues est Nejat, exemple d’une immigration absolument réussie. Mais lorsqu’il change son poste à l’Université contre une petite librairie allemande à Istanbul, la question complexe de son appartenance et de la « Heimat » se fait jour (dans une scène touchante où le libraire allemand avoue son « mal du pays » et l’envie de rentrer chez soi). Sans jamais être trop explicite, le film construit un réseau de signes porteurs de sens : alors que Nejat fait un cours magistral sur Goethe et parle de la position réticente du poète vis-à-vis de la Révolution française, Ayten, engagée dans un combat révolutionnaire, dort sur les derniers rangs de l’amphi. Et les propos cités par Nejat refont sens quand on voit la mère de Lotte critiquer le combat politique d’Ayten et avancer les avantages d’une intégration de la Turquie à l’Europe. Un film très fin qui sonde les questions de la vie entre amour et deuil, résignation et espoir.
Évoquons un dernier film, malheureusement absent du festival : Du bist nicht allein de Bernd Böhlich (D, 2007, 90’). Au Kino International de Berlin, il a fait salle comble à toutes les séances à sa sortie à la mi-juillet. L’intérêt d’une ville, d’un quartier, d’une certaine couche de population pour cette tragi-comédie sociale ? A regarder les personnages du film, on pense d’abord à ces Allemands de l’Est quinquagénaires qui, presque vingt ans après la chute du Mur, sont toujours les habitués des ANPE, qu’ils soient physicien, actrice, vendeuse ou peintre. Bien que l’intention du film fût de cibler la population « Hartz IV » en général.
Le scénario existe depuis 2001, les acteurs Axel Prahl et Katharina Thalbach furent pressentis déjà à l’époque pour figurer le couple Moll, au centre du film. Mais à l’époque, personne ne voulait investir de l’argent dans un tel sujet et ce furent les deux acteurs qui ont gratuitement tournés un teaser de 10 minutes pour montrer qu’on pouvait traiter la misère sociale de façon divertissante. Hans, peintre et chômeur de longue durée, utilise les murs tristes et mornes des balcons de son appartement HLM comme écrans de projection d’une vie sereine pour ses modestes fresques. Alors que sa femme retrouve enfin un emploi comme vigile, et avec l’uniforme un brin de confiance en elle, il rend ses services de bricoleur à Evgenia, une Russe fraîchement débarquée à Berlin avec sa fille. Il s’attache à elle, l’aide financièrement dans le dos de sa femme alors que chaque euro est compté chez eux. Et preuve absolue de l’amour naissant de son voisin, Evgenia hérite du caoutchouc familial des Moll lors de sa crémaillère. Grâce au jeu magistral des acteurs, ce film dépeint finement une réalité sociale entre laisser-aller et regain d’espoir, entre stagnation et créativité. Un monde où le travail est encore synonyme de vocation et porteur de sens, et non pas une occupation alimentaire. Frau Moll s’effondre lorsqu’elle découvre que le hangar qu’elle surveille est vide. Au technicien qui lui dit d’être heureuse d’avoir un job, elle rétorque qu’elle veut un véritable travail. Le dernier plan s’ouvre sur un peu d’espoir. Alors que Hans est parti au Pays-Bas pour trouver un boulot, la mère Moll apprend à nager. Et à se libérer pour un instant des contraintes qui pèsent sur elle, du poids d’une société qui n’arrive pas à l’intégrer et qui apparemment n’a pas besoin d’elle.
Si les liens de famille ont une certaine importance dans l’actuel cinéma allemand, il y a une évolution semblable en littérature. En témoignent l’engouement, depuis quelques années, pour le roman familial ou le roman générationnel. Deux courts romans parus cette année ne visent pas le grand récit générationnel ou le panorama familial, mais ils ont en commun, avec beaucoup d’autres romans de ce courant, la structure d’une quête et un rapport conflictuel au père. « Jamais je n’ai pensé tuer mon père. Pendant ces jours de l’été dernier, ça ne m’est pas venu à l’esprit, pas une seconde. C’est ma mère seulement qui m’a suggéré cette possibilité ». Abwesend est le titre du dernier roman de Gregor Sander, connu pour son premier recueil de nouvelles Ich aber bin hier geboren (Rowohlt, 2002). Le personnage principal, Christoph, retourne dans la maison de son enfance à Schwerin pour garder pendant quinze jours son père, tombé dans le coma après une attaque cérébrale. Cette situation qui le désempare – l’idée de donner des soins à son père l’insupporte – fait émerger les souvenirs d’enfance et incite Christoph à revenir sur l’histoire de sa famille. Celle-ci faisait partie de l’intelligentsia en RDA, le père ayant été professeur en génie civil à l’Université technique de Wismar. Enfant de refugiés de Poméranie, il doit son ascension professionnelle à l’État et lui reste loyalement reconnaissant en tant que membre du Parti. Cependant l’autre versant de sa famille, la branche maternelle, y fait contrepoids. Issue d’une vieille famille commerçante de Schwerin, la mère de Christoph maintient les valeurs bourgeoises et y apporte un certain confort matériel. Fait inhabituel pour la RDA, elle ne travaille pas pour élever ses trois enfants. La maison familiale – avec la seule piscine individuelle à Schwerin – devient un ilot à l’intérieur de la société est-allemande. Le seul défaut de cette enfance a priori heureuse est l’absence du père qui, pendant les rares moments qu’il passe chez lui, reste inaccessible et froid. Pendant que Christoph, trentenaire et architecte fraichement renvoyé de son poste, se laisse aller dans ses considérations, une lettre de Suisse adressée au père bouscule l’apparente tranquillité. Le fils découvre une facette inconnue de son père qui, lors d’un séjour de recherche à Zurich dans les années 1980, avait une liaison amoureuse dont serait issue une fille. Christoph se rend en Suisse à la recherche de sa demi-sœur inconnue. Au retour, il se rapproche pour la première fois de son père, toujours absent dans le coma, pour lui raconter son voyage et parler de lui-même aussi.
Dans son roman, Sander procède par des retours en arrière qui lui permettent d’ouvrir, en dehors du conflit familial, une multitude de trames et de capter des bribes de vie très variées de la génération de son protagoniste : les relations amoureuses, les tentatives d’affirmation dans le monde du travail, l’amitié. L’ensemble est reflété par le contexte historique entre le déclin de la RDA, la chute du Mur et la période de transformation. C’est un livre très personnel qui tente également, du moins c’est l’impression qui s’en dégage, de faire une sorte de bilan de certaines expériences vécues par l’auteur.
Dans le dernier roman de Barbara Bongartz, Der Tote von Passy (Dittrich Verlag, 2007), l’interrogation sur les liens de famille et la filiation joue également un rôle central. Comme chez Sander, le récit s’ouvre sur l’idée du parricide : « Longtemps je souhaitais la mort de mes parents. Je les aimais et cette envie me faisait honte. Mais sa réalisation semblait être pour la fille que j’étais le seul sauvetage pour notre famille. » Le livre de Bongartz se présente comme une mystérieuse quête d’identité où le lecteur se transforme en détective pour assembler les différents éléments concernant la vie de la protagoniste. Celle-ci se rend à Paris, après avoir reçu une lettre anonyme qui l’informe que son nom de famille n’est pas celui qu’elle porte, et qui l’invite à assister à l’enterrement de son père, Alphonse Steiner, à Passy. Elle le fait, se rend à la maison de Steiner, essaie de comprendre qui était cet homme. Un des petits-fils la prend pour la maîtresse de son grand-père, une employée de la maison lui suggère qu’elle est peut-être sa fille illégitime. La protagoniste soupçonne alors que sa mère avait une relation avec cet homme qui est à mettre en rapport avec des séjours réguliers qu’elle a passés au Negresco de Nice dans les années 1950.
En suivant un récit où différents niveaux temporels se chevauchent et où les incohérences apparentes dans le discours de la narratrice s’expliquent après coup, le lecteur entre peu à peu dans l’histoire de celle-ci qui, en fait, a été adoptée par ses parents. Dès sa petite enfance elle est témoin des dissensions dans le couple qu’elle n’arrive à s’expliquer qu’une fois mise au courant de son absence d’dentité. La narratrice se meut entre la réalité et son image d’elle-même, sans cesse elle rêve « ce rêve de famille, le rêve d’appartenance ». Alors que la narratrice avait fini par retrouver sa véritable mère et qu’elle suit les traces de sa famille maternelle dans les vieux quartiers de Berlin, le personnage de son père reste énigmatique et continue à provoquer des fantasmagories et à maintenir l’incertitude sur son identité. Barbara Bongartz a écrit un roman dont la protagoniste s’appelle Barbara Bongartz, profession : romancière. Un certain nombre d’éléments autobiographiques jalonnent le récit et en font un bel exemple d’autofiction. Selon Barbara Bongartz, la fictionnalisation était nécessaire pour sortir d’une situation d’impuissance, pour tourner et retourner un sujet autobiographique jusqu’à ce que, devenant un sujet littéraire, il lui permette d’écrire et d’agir. Peu importe, pour le lecteur, qu’il s’agisse d’éléments strictement autobiographiques. Ce livre pose de façon insistante la question de l’identité et, en passant, donne un aperçu éclairant de l’imaginaire franco-allemand de la génération de l’auteure, née en 1957.
Notre dernier livre, Mara Kogoj de Kevin Vennemann (Suhrkamp, 2007), ne s’inscrit pas dans le courant décrit auparavant, bien qu’une relation père – fils y joue également un rôle important. Après son remarquable premier roman Nahe Jedenew (Suhrkamp, 2005) qui paraîtra prochainement en français (dans la traduction de Barbara Fontaine chez Gallimard), Vennemann continue, avec l’investigation formelle qui lui est propre, à traiter des sujets liés au national-socialisme. Cette fois, dans toute leur actualité. L’auteur nous emmène en Carinthie, dans le Sud de l’Autriche, où s’effectue une étude basée sur des interviews biographiques au sujet du rapport à la « Heimat » et au passé. L’un des interviewés est Ludwig Pflügler, journaliste et homme politique né en 1945, animateur de diverses associations et revues de « protection de la patrie » et connu pour ses positions antisémites et xénophobes. Mara Kogoj et Tone Lebonja, deux Autrichiens appartenant à la minorité slovène et qui sont de la même génération que Pflügler, sont censés mener les entretiens, ce que Pflügler ne cesse de considérer comme une humiliation. Alors que Lebonja se transforme en patient auditeur qui laisse partir Pflügler dans des tirades extrémistes dont il est lui-même la première cible, Maja Kogoj se retire, feint l’indifférence pour ne pas devoir se sentir concernée. Lebonja dont on apprend qu’il avait connu Pflügler dans sa jeunesse, tente en revanche de comprendre comment celui-ci est venu à ses positions. Il se documente, prend des notes, tente d’élucider le lien entre Pflügler et son père accusé de crime de guerre. Et il essaye notamment de savoir si le père de Plügler était impliqué dans l’un des plus grands massacres perpétrés par des SS contre la population civile en Carinthie, l’extermination de deux familles au Peršmanhof, une base de soutien aux partisans.
Au niveau formel, Vennemann demande, comme dans son premier roman, une attention particulière de son lecteur. Systématiquement les voix et récits des trois protagonistes se succèdent, s’entrecoupent et se mêlent dans un incessant flux de la parole. La ponctuation inhabituelle reflète le caractère oral de la situation d’entretien, le texte se meut souvent en boucle comme pour représenter les allers-retours de la mémoire.
Ce texte complexe est une vive dénonciation des activités de l’extrême droite en Autriche, des toujours actuelles célébrations et manifestations politiques à la « Heimkehrergedenkstätte » sur l’Ulrichsberg près de Klagenfurt aux dernières revendications électorales de Jörg Haider en faveur d’une Carinthie monolingue. Il rappelle à la fois des événements historiques volontiers oubliés et souligne le déséquilibre, dans l’espace public, entre la commémoration du combat des partisans et celle, de loin la seule visible, des soldats autrichiens. Mais c’est avant tout une réflexion sur le pouvoir d’interprétation de l’histoire, sur le rapport entre victimes et bourreaux et la violence symbolique exercée par ces derniers, représentée ici par la situation de l’entretien. Par ailleurs, Vennemann livre nombre de réflexions théoriques sur la transmission générationnelle de la mémoire, menées ici à travers le personnage de Lebonja et son analyse du comportement de Pflügler. En revanche, avec le personnage de Mara Kogoj, qui reproche à Lebonja d’être compréhensif là où il faudrait tout simplement ressentir du dégoût, Vennemann réclame une position singulière dans l’actuel discours sur la victimisation. Il s’oppose clairement à un quelconque retournement de perspective, en dénonçant l’inversion victime – bourreau perceptible dans le discours public.
- Carola Hähnel-Mesnard -
Simone Barck
(1944 – 2007)
Simone Barck nous a quittés cet été, le 17 juillet 2007, à Berlin, après quinze jours de maladie. Avec elle disparaît une chercheuse qui a eu d’énormes mérites dans l’évaluation, après la chute du Mur, de la littérature de RDA et de ses conditions d’existence, une instigatrice de nombreux projets qu’elle a menés à bien avec ses équipes, une irremplaçable conseillère qui, indépendamment de ses thèmes de recherche, pouvait donner des recommandations précieuses sur tout ce qui avait de près ou de loin trait à la littérature de RDA. Simone Barck laisse une place vide, humainement, scientifiquement.
Germaniste et slaviste, elle a travaillé de 1970 à 1991 en tant que chercheuse au « Zentralinstitut für Literaturgeschichte » à l’Académie des Sciences de RDA. Ses recherches portaient sur Johannes R. Becher, sur l’exil en Union soviétique et sur la littérature socialiste dans une perspective historique, travail dont est issu en 1994 le Lexikon sozialistischer Literatur. Ihre Geschichte in Deutschland bis 1945, chez Metzler.
Depuis 1992, Simone Barck était chercheuse au Zentrum für Zeithistorische Forschung de Potsdam. Son intérêt portait à présent sur les conditions d’existence de la littérature en RDA, sur la définition de l’espace public, sur l’impact de la censure, élucidé notamment dans l’étude Jedes Buch ein Abenteuer. Zensursystem und literarische Öffentlichkeit in der DDR bis Ende der 60er Jahre (avec M. Langermann et S. Lokatis, Akademieverlag, 1997). D’autres chantiers ouverts par Simone Barck (et loin d’être clos) étaient le paysage des revues en RDA (Zwischen « Mosaik » und « Einheit ». Zeitschriften in der DDR, avec M. Langermann, S. Lokatis, Ch. Links Verlag, 1999) et celui de l’édition (Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages Volk & Welt, avec S. Lokatis, Ch. Links Verlag, 2003).
Avec son importante étude sur le discours antifasciste en RDA (Antifa-Geschichte(n). Eine literarische Spurensuche in der DDR der 1950er und 1960er Jahre, Böhlau, 2003), Simone Barck interroge la supposée homogénéité de ce dernier et invite à revisiter non seulement le canon littéraire à ce sujet, mais aussi à découvrir nombre de textes et de discours quasiment inconnus jusque-là. Conjointement à l’histoire de l’antifascisme, Simone Barck s’intéresse également à la réception des grands témoignages littéraires de cette époque en RDA. Ainsi, elle a récemment travaillé sur la réception de Primo Levi. Et, en dehors de son activité de chercheuse, elle a eu le souci de capter la mémoire de cette époque. Ainsi, elle s’est fait la chroniqueuse de la rue où elle habitait, la Große Hamburger Straße à Berlin, cette rue où il y avait un camp de rassemblement pour les juifs avant qu’ils ne fussent déportés dans les camps d’extermination. En 1996, elle a tourné une vidéo à partir des témoignages des habitants.
Son dernier projet de recherche était consacré au « lecteur secret en RDA », celui qui, malgré la censure et nombre de restrictions et d’interdictions, arrivait à se procurer la littérature occidentale. Le colloque intitulé Der heimliche Leser in der DDR qu’elle préparait encore au début de cet été, vient d’avoir lieu à Leipzig, en hommage à elle. D’autres projets restent à présent orphelins. L’écrivain Fritz Rudolf Fries, un ami de Simone, a résumé ce que beaucoup ressentent : « De toi, on pouvait apprendre comment la passion pour la littérature nous change et devient critique, devient philosophie qui nie la mort. » Et « Simone Barck – présente ! »
C. H.-M.