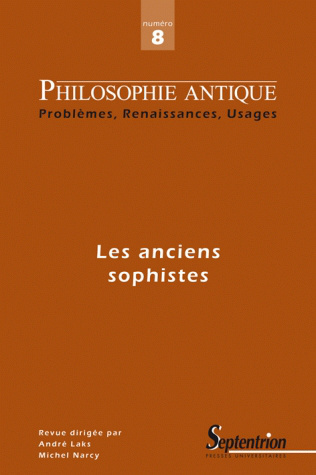Philosophie Antique n°8 - Les sophistes anciens
First Edition
Sans rouvrir l'éternel débat sur l'appartenance des sophistes à la tradition philosophique, les études rassemblées ici s'attachent aux modalités diverses d'inscription dans le champ culturel grec, en termes de techniques discursives comme de professionnalisation, de ceux que la tradition a distingués comme philosophes et sophistes. On soulignera, parmi les Varia, la révélation d’une importante découverte concernant l’histoire du texte de Platon.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Philosophie antique
- Title Part
-
Numéro 8
- Edited by
- André Laks, Michel Narcy,
- Journal
- Philosophie antique | n° 8
- ISSN
- 16344561
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Knowledge and systems of thought > Philosophy, hermeneutics, philology
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Knowledge and systems of thought
- Title First Published
- 03 December 2008
- Type of Work
- Journal Issue
Paperback
- Publication Date
- 03 December 2008
- ISBN-13
- 9782757400760
- Extent
- Main content page count : 310
- Code
- 1125
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 580 grams
- List Price
- 22.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
Présentation
Jean-François Pradeau
Réflexions sur la doctrine d'Antiphon, la révolution des Quatre Cents et la tyrannie des Trente
Jean-Marie Bertrand
Protagoras et l’art de la parole
Michael Gagarin
Un monde sans pitié : Platon à l’école de Thrasymaque de Chalcédoine
Arnaud Macé
Thrasymaque, la polis et les dieux
Mauro Bonazzi
Héraclès entre Prodicos et Xénophon
Louis-André Dorion
La sophistique, une manière de vivre ?
Michel Narcy
Le Platon de Panétius : à propos d’un témoignage inédit de Galien
Jean-Baptiste Gourinat
Platon a-t-il distingué différents emplois du verbe « être » ?
Note sur un passage controversé du Sophiste (225c-d)
Fulcran Teisserenc
Le paradoxe stoïcien : l’action déterminée et la responsabilité
Vladimir Mikeš
Le livre de Philodème Sur la colère
Voula Tsouna
Comptes rendus
Bulletin bibliographique
Excerpt
Réflexions sur la doctrine d’Antiphon, la révolution des Quatre Cents et la tyrannie des Trente
L'influence des théories philosophiques d’Antiphon, telles qu’on les connaît par le traité Sur la vérité, fut considérable durant la révolution oligarchique des Quatre Cents, en 411. Son idée, selon laquelle il faut être caché de tout regard pour vivre « selon la nature », se traduisit par une politique systématique d’obscurcissement de la cité, où personne ne savait plus qui se trouvait jouir de la pleine citoyenneté. Les Trente, au contraire, en 404, après qu’Antiphon eut été mis à mort lors de l’intermède démocratique, choisirent de publier le catalogue de leurs partisans pour qu’ils ne pussent récuser leur responsabilité dans l’installation de la tyrannie et leur complicité dans ses crimes.
Summary. Antiphon’s philosophical views, that are known to us from his treatise On Truth, had a major influence during the oligarchic revolution of the Four Hundred in 411 B.C. His idea that, in order to live « according to nature », one has to be out of every eye resulted in a systematic policy of darkening of the city, where no one knew any longer who was or not a full citizen. In 404 B.C., after that Antiphon was put to death at the time of the democratic interlude, the Thirty chose instead to publish the names of their supporters, in order that they couldn’t deny either their liability for setting up the tyranny or their complicity in its crimes.
Un monde sans pitié : Platon à l’école de Thrasymaque de Chalcédoine
La présente étude vise à tirer du témoignage platonicien la plus large information positive sur le maître de rhétorique Thrasymaque de Chalcédoine. Il s'agit en particulier d’établir la cohérence entre le propos tenu sur Thrasymaque dans le contexte de la présentation de l’histoire de la rhétorique dans le Phèdre et les propos prêtés au personnage de Thrasymaque au premier livre de la République. On avance que les thèses politiques du personnage fictif reflètent une conception de l’art oratoire fondée sur la production d’affections chez l’auditeur, en particulier de la pitié : la description des situations politiques doit faire apparaître en toute circonstance la position peu enviable du dominé, afin de justifier la plainte. Ce résultat est confirmé par la confrontation aux fragments restants de l’œuvre de Thrasymaque. On en tire dès lors une conclusion sur l’influence du Thrasymaque historique sur Platon : si le philosophe abandonne la rhétorique émotionnelle de l’orateur, il en conserve et en amplifie le pessimisme.
Summary. The aim of this paper is to draw on Platonic evidence as much positive information as possible about the rhetoric teacher Thrasymachus of Chalcedon. It is more specifically claimed that there is a consistency between what is said of Thrasymachus in the Phaedrus, as part of an outline of the history of rhetoric, on the one hand, and the words attributed to the character of Thrasymachus in Republic I, on the other hand : the political ideas of the character correspond to a conception of oratory based on generating affects, especially pity, in the audience : any account of a political situation has to show the unenviable position of the dominated in order to justify the complaint. This claim is confirmed by a comparison with the extant fragments of Thrasymachus’ works. A conclusion is also drawn in relation to the influence of the historical Thrasymachus on Plato : although the philosopher discards the emotional oratory of Thrasymachus, he keeps and even further emphasizes his pessimism.
Thrasymaque, la polis et les dieux
Une analyse adéquate de la pensée de Thrasymaque doit affronter un double problème de cohérence. Les thèses qu'il avance dans la République de Platon ont été jugées incompatibles ; en outre, elles semblent en opposition avec d’autres fragments conservés. Cet article vise à montrer qu’une lecture politique de la pensée de Thrasymaque peut rendre compte de ces difficultés. Parallèlement à son intérêt pour la rhétorique, les témoignages dont nous disposons soulignent l’engagement politique de Thrasymaque, dont le contexte fut probablement la polémique contre la démocratie athénienne. Or nombre des affirmations soutenues par Thrasymaque dans la République de Platon impliquent une attitude anti-démocratique. Deuxièmement, la plus grande importance doit être accordée au fameux témoignage sur les dieux (DK B8) qui, bien loin d’être une amère protestation contre la violation humaine de la justice, se comprend mieux comme une façon paradoxale de provoquer la moralité traditionnelle en soutenant que les dieux ne se soucient pas de l’humanité. Le fragment B8 apporte une confirmation supplémentaire du rôle stratégique de Thrasymaque dans la philosophie politique de Platon. En effet, le but principal de Platon, de la République aux Lois, est la fondation « théologique » de la justice, en opposition fondamentale avec les thèses conventionnalistes comme celle qu’assume Thrasymaque.
Summary. An adequate account of Thrasymachus’ thought has to meet a double charge of incoherence. The theses he puts forward in Plato’s Republic have been reproached for being incompatible; besides, such theses seem to contrast with other extant fragments. Aim of the paper is to show that a political reading of Thrasymachus’ thought can account for these difficulties. Along with his rhetorical interests, testimonies at our disposal point out Thrasymachus’ political engagement, probably in the context of polemics against the Athenian democracy. And an anti-democratic stance is implied in many of the claims Thrasymachus defends in Plato’s Republic. Second, and most important, the famous testimony on the gods (DK B8), far from being the bitter cry against men’s violation of justice, is better taken as a paradoxical provocation against traditional morality, arguing that the gods do not care for human beings. Fragment B8 further confirm Thrasymachus’ strategical role in Plato’s political philosophy. For Plato’s major target, from the Republic to the Laws, is the 'theological’ foundation of justice in open opposition to the conventionalist views such as the one endorsed by Thrasymachus.
Héraklès entre Prodicos et Xénophon
La fable d'Héraklès à la croisée des chemins (Mémorables, II, 1, 21-34), que Xénophon attribue expressément à Prodicos (II, 1, 21), a dernièrement fait l'objet de plusieurs articles (Sansone, Gray, Tordesillas) qui s'efforcent de déterminer si et à quel point la version rapportée par Socrate est fidèle à la version originale de Prodicos. Or on peut aisément montrer que la plupart des thèmes exposés dans l'apologue sont également développés par Socrate ailleurs dans les Mémorables, de sorte qu'il est tentant de considérer que cette version de l'apologue – celle qu'on peut lire en Mem. II, 1, 21-34 – ne doit pas grand-chose à Prodicos dans la mesure où elle a probablement été récrite de fond en comble par Xénophon.
Summary. Several scholars (Sansone, Gray, Tordesillas) have recently examined the fable of Heracles at the Y (Memorabilia, II, 1, 21-34), that Xenophon expressly assigns to Prodicus (II, 1, 21), in order to ascertain whether and how much the version told by Socrates is faithful to Prodicus' original. But it is easy to show that most of the themes displayed in the apologue are developed as well by Socrates in other passages of the Memorabilia, so that it is tempting to think that the version of the apologue that we read in Mem. II, 1, 21-34 doesn’t owe much to Prodicus, insofar as it was probably been thoroughly rewritten by Xenophon.
La sophistique, une manière de vivre ?
Le point de départ de cet article est la question de savoir quel contenu donner à la prohairesis tou biou qui distingue, selon Aristote (Metaph. G, 2, 1004b24-25), la philosophie de la sophistique. Après avoir montré qu'il s’agit du stéréotype conjuguant la définition platonicienne du sophiste comme fabricant de simulacres et la pratique censée être propre aux sophistes, de faire payer leurs leçons, on se demande si, pourquoi et à quelles conditions la pratique et l’enseignement de la philosophie par Socrate et ses successeurs échappaient à cette double caractérisation.
Summary. In Metaph. G, 2, 1004b24-25, Aristotle states that the difference between philosophy and sophistics is their prohairesis tou biou : what does really mean this statement ? I hold that it refers to nothing else than the stereotype which combines the Platonic definition of the Sophist as a semblance-maker with the practice of teaching for pay that was supposed to be specific to the Sophists. Thus I question whether, why and under which conditions Socrates and his followers succeeded in philosophizing and teaching philosophy without being characterized in the same way.
« Le platon de Panétius » à propos d’un témoignage inédit de Galien
Dans le Peri alypias de Galien, qui vient d'être redécouvert et édité par V. Boudon-Millot, Galien mentionne « le Platon de Panétius ». Étant donné le contexte, il est presque certain qu’il s’agit d’une édition de Platon par le philosophe stoïcien Panétius, édition dont on ignorait jusqu’ici l’existence.
Summary. In his Peri alypias, recently rediscovered and edited by V. Boudon-Millot, Galen speaks of "Panaetius’ Plato". Given the context, it is almost certain that this expression refers to an edition of Plato’s dialogues by the Stoic philosopher Panaetius. Until now, the existence of this Panaetian edition was unknown.
Le paradoxe stoïcien : l’action déterminée et la responsabilité
L'article aborde le sujet souvent débattu du rapport entre le déterminisme stoïcien et la morale pour rouvrir la question de la notion d’assentiment. Dans ce but, il réexamine les sources pour montrer deux choses : que les interprétations dites compatibilistes ont raison dans leur effort général pour montrer que les stoïciens restent déterministes quand ils présentent leur psychologie de l’action et défendent l’idée de responsabilité, mais qu’en même temps elles vont trop loin quand elles affirment – dans un effort de systématisation de la stratégie stoïcienne – que l’assentiment est le simple effet de la rencontre du caractère particulier de l’agent et de l’impression sensorielle. En essayant de restituer l’accent que les stoïciens ont mis sur l’assentiment, l’article indique que c’est également là que réside l’ambigüité de leur psychologie de l’action, qui a contribué au paradoxe dans l’interprétation du stoïcisme : ce dernier a été dès l’origine, d’un côté, une inspiration pour ceux qui ont voulu argumenter en faveur de la liberté de l’action humaine, et de l’autre, le sujet de la critique pour la réfutation de la liberté de l’action. Dans son ensemble l’interprétation proposée est négative dans le sens où elle veut montrer comment ne pas comprendre l’assentiment, pour ouvrir la possibilité de l’examiner de nouveau, ce qui pourrait montrer enfin que l’ambigüité mentionnée est par conséquent l’expression du plus grand potentiel philosophique de la conception stoïcienne de la raison
Summary. The article tackles the familiar problem of the intersection of Stoic determinism and morality in order to re-open the question of the Stoic notion of assent. By analysis of the known sources it heads towards a double goal: first, to show that what is referred to as the compatibilist interpretation is right in saying that the Stoics do not abandon their deterministic stance when introducing their psychology of action and defending the idea of responsibility. Secondly, that this compatibilist interpretation claims too much, however, when trying to prove – in its effort to systematize – that assent is simply an outcome of the encounter of two causes: the particular character of an agent and the sensory impression. In pointing out the original emphasis laid on assent, the article argues also that this is what is at the origin of the paradox of interpretation, namely that the Stoics served from early times as an inspiration for ideas of freedom of action, on the one hand, and yet were criticised for ruling it out as a possibility, on the other. The argument is negative in so far as it shows ways in which assent is not to be understood rather then giving its positive definition. In doing so, however, it tries to create room for a new analysis which might indicate a richer sense of the Stoic concept of reason than it is habitually seen.
Le livre de Philodème La Colère
Depuis Homère, les penseurs de l'antiquité se sont intéressés à la nature, à l’usage et au contrôle de la colère. Cet article porte sur le plus ancien ouvrage sur le sujet qui ait survécu de l’antiquité jusqu’à nous, à savoir le traité Sur la Colère de Philodème, un important philosophe épicurien, actif en Italie du Sud au 1er siècle av. J.-C. De façon générale, il s’agit dans cet article de présenter, du point de vue historique, sémantique et méthodologique, le contexte de l’analyse par Philodème de la colère, ainsi que de reconstruire l’essentiel de son argumentation contre différents adversaires. La question comporte un débat sur la bonne façon de traiter la colère ; l’explication que donne Philodème de la nature, des symptômes et des conséquences de cette émotion ; la distinction qu’il opère entre colère naturelle (orge) et non naturelle (thymos), ainsi que son affirmation, que le sage peut à l’occasion resssentir la première, mais jamais la seconde ; enfin, sa réfutation de trois arguments en forme d’epilogismos qui soutiennent que le sage ne sera pas moins sujet à la colère que n’importe qui.
Summary. From Homer onwards classical thinkers were preoccupied with the nature, use, and control of anger. This paper discusses the earlier classical work on that subject surviving in part to our day, namely the treatise On Anger by Philodemus, an important Greek Epicurean philosopher active in Southern Italy in the 1st century BC. The overall aim of the paper is to supply the historical, semantic, and methodological context for Philodemus’ analysis of anger, and also to reconstruct Philodemus’ central argument against different opponents. Topics include a debate concerning the right method of treating anger ; Philodemus’ account of the nature, symptoms, and consequences of the emotion ; his distinction between natural anger (orge) and unnatural anger (thymos) as well as his contention that the sage occasionally feels the former but never the latter ; and his refutation of three arguments in the form of epilogismos which maintain that the sage will feel no less anger than the common man.
Platon a-t-il distingué différents emplois du verbe « être » ? Note sur un passage controversé du Sophiste (255c-d)
Contrairement à ce que présupposent certaines lectures contemporaines du Sophiste, l'Étranger ne cherche pas à conférer au verbe « être » des sens différents selon le type d’énoncé dans lequel il figure, qu’il s’agisse d’un énoncé d’identité, prédicatif, ou encore existentiel. L’analyse précise d’un passage fréquemment sollicité à cet effet (255c-d), analyse qui tient compte également de l’ensemble de la partie centrale du dialogue, fait apparaître que l’Étranger n’a pas un besoin crucial d’une telle distinction et qu’elle n’est pas non plus implicitement présente dans ses autres arguments. Quant au texte litigieux de 255c-d, il se lit bien mieux comme opérant une séparation quasi catégorielle entre termes absolus et termes relatifs. Cette dernière distinction, attestée par l’Ancienne Académie comme authentiquement platonicienne, se trouve enrichir le tableau des relations entre genres que l’Étranger esquisse dans son exploration partielle de la symploke ton eidon.
Summary. Contrary to what has been suggested by some contemporary readings of the Sophist, the Stranger does not give different meanings to the verb «be» in identity, predicative and existential statements. When analysing the crucial passage of 255c-d and the central part of the dialogue, it becomes clear that the Stranger does not fundamentally need this distinction, which is not implicit either to some of his arguments. A correct reading of the problematic 255 c-d text points out a rather categorical distinction between absolute and relative terms. This last distinction, testified as a Platonic one by the Ancient Academy, enlarges the map of the relationship between genres which the Stranger outlines in his partial exploration of the symploke ton eidon.