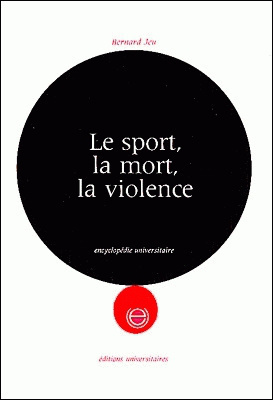Le sport, la mort et la violence
First Edition
La psychanalyse du sport révèle toute une élaboration symbolique de l'idée de mort, tout un rituel spontanément vécu de la violence valorisée, contrôlée, dépassée. Le sport se présente ainsi comme anti-tragédie (il substitue la liberté au destin), contre-religion (on sauve son âme en prenant celle de l'autre), contre-société (c'est pour s'opposer qu'on se réunit).
Le sport est affaire d'état. Il est une fête théologico-politique où la civilisation moderne redécouvre l'âme des nations. Il exprime en même temps un conflit. La contre-société sportive, négative, idéologique, existe à l'intérieur d'une société qu'elle nie pour pouvoir l'idéaliser mais dont elle a besoin matériellement pour survivre. Et de son côté, la société tend à récupérer la force que représente la contre-société sportive afin d'en faire un moyen d'encadrement (fédérations affinitaires), une médecine préventive (le sport à l'école) ou un objet de consommation (bowlings, stations de montagne).
Comment organiser une politique rationnelle du sport à l'échelle nationale? Une solution serait à chercher du côté de la formation d'animateurs socio-culturels agissant au niveau des quartiers. Cela ferait au moins cesser l'anomalie qui consiste actuellement à faire reposer la presque totalité de l'encadrement sportif de base sur un bénévolat, admirable certes, mais aléatoire et anachronique? Ce qui est inquiétant ce n'est pas que les athlètes soient professionnels mais bien que les dirigeant soient des amateurs.
Bernard Jeu, agrégé de philosophie, docteur ès lettres, enseigne la philosophie à l'Université de Lille et à l'Université de Bruxelles. A séjourné en Union Soviétique de 1961 à 1966 en qualité d'enseignant détaché à l'Institut des Langues Etrangères de Moscou, puis Attaché Culturel à l'Ambassade de France. A effectué une mission en République Populaire de Mongolie en octobre 1966. Actuellemnt président du Comité Départemental du Nord de Tennis de Table. Auteur d'un ouvrage intitulé La Philosophie soviétique et l'Occident et de divers articles, communications et comptes-rendus parus dans différentes revues. Le dénominateur commun de ses recherches est une réflexion sur le sens de l'histoire et sur la culture.
Bernard Jeu, agrégé de philosophie, docteur ès lettres, enseigne la philosophie à l'Université de Lille et à l'Université de Bruxelles. A séjourné en Union Soviétique de 1961 à 1966 en qualité d'enseignant détaché à l'Institut des Langues Etrangères de Moscou, puis Attaché Culturel à l'Ambassade de France. A effectué une mission en République Populaire de Mongolie en octobre 1966. Actuellemnt président du Comité Départemental du Nord de Tennis de Table. Auteur d'un ouvrage intitulé La Philosophie soviétique et l'Occident et de divers articles, communications et comptes-rendus parus dans différentes revues. Le dénominateur commun de ses recherches est une réflexion sur le sens de l'histoire et sur la culture.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Author
- Bernard Jeu,
- Collection
- Philosophie
- ISSN
- 1258116X
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Knowledge and systems of thought > Philosophy, hermeneutics, philology
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Knowledge and systems of thought
- Title First Published
- 01 June 1972
Paperback
- Publication Date
- 01 June 1972
- ISBN-13
- 9782757402238
- Extent
- Main content page count : 204
- Code
- 5
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- List Price
- 1.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3