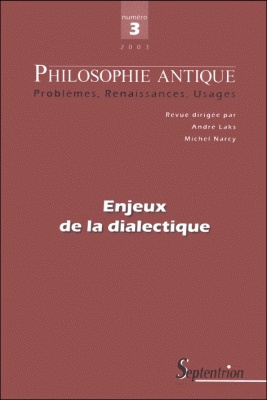Philosophie Antique n°3 - Enjeux de la dialectique
Première édition
D'une interprétation radicale de l'aporie socratique à la redécouverte de la dialectique aristotélicienne par l'humanisme renaissant, ce numéro présente une diversité d'approches de la dialectique et de ses usages philosophiques. À ce dossier s'ajoutent des études sur le concept aristotélicien de puissance, la lecture du Banquet de Platon par Marsile Ficin ou l'arrière-plan philosophique de la façon injurieuse dont le précepteur de Tibère ou celui de Néron, suivant les sources, aurait qualifié son élève.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Philosophie antique
- Partie du titre
-
Numéro 3
- Édité par
- André Laks, Michel Narcy,
- Revue
- Philosophie antique | n° 3
- ISSN
- 16344561
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée > Philosophie, herméneutique, philologie
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée
- Date de première publication du titre
- 2003
- Type d'ouvrage
- Numéro de revue
Livre broché
- Date de publication
- 2005
- ISBN-13
- 9782859399399
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 200
- Code interne
- 985
- Prix
- 16,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Sens et fonction de l'aporie socratique
Pierre Aubenque
La théorie aristotélicienne de la différence dans les Topiques
José Miguel Gambra
Lorenzo Valla et la recomposition du conflit entre la dialectique et la rhétorique
Fosca Mariani Zini
La fin du Phèdre de Platon (274b-279c) : ésotérisme et anti-ésotérisme
Yvon Lafrance
Comment bien définir une puissance ? Sur la notion de puissance des contraires (Aristote, Métaphysique, Theta, 2)
David Lefebvre
Le charme de Socrate : Ficin interprète de Platon
Marianne Massin
« Boue pétrie de sang »
Marwan Rashed
Note critique : R. Goulet, Études sur les Vies de philosophes dans l’Antiquité tardive
Stéphane Diebler
Comptes rendus
Bulletin bibliographique
Extrait
Sens et fonction de l’aporie socratique
Si l'on ramène la dialectique à son point de départ socratique, c’est-à-dire à une méthode purement interrogative, on est amené parallèlement à concevoir l’aporie en un sens radical : loin d’être due à des facteurs subjectifs tels que l’ignorance de la réponse, l’aporie, à proprement parler est une question objectivement indécidable, ce qui revient à dire, paradoxalement, qu’on ne peut la trancher que par une décision. On montre que la question du sens de l’être, au fondement de la métaphysique depuis Aristote, offre ce caractère de la manière peut-être la plus exemplaire.
La théorie aristotélicienne de la différence dans les Topiques
Cet article essaie de montrer, contre l'interprétation donnée par Morrison, que la théorie aristotélicienne de la différence est assez cohérente et unitaire. Puisque cette théorie englobe celle des modes d'être (catégories) et celle de la prédication, la première partie de l'article montre le relations qui existent entre ces deux doctrines, en analysant surtout le difficile chapitre I, 9 des Topiques. La deuxième partie essaie de résoudre les apparentes contradictions qu'on trouve dans l'exposé de la différence aux premiers traités de l'Organon.
Lorenzo Valla et la recomposition du conflit entre la dialectique et la rhétorique
Depuis la philosophie ancienne, notamment avec Aristote, la dialectique et la rhétorique se partagent le domaine de l'argumentation plausible et crédible, mais leurs stratégies de preuve aussi bien que leurs buts diffèrent. Une fois ces différences mises en lumière, il est possible de suggérer que l’humanisme n’a pas été tant un moment marqué par le renouveau de la rhétorique que d’une multiplicité de formes de décomposition et de recomposition des modalités rhétoriques et dialectiques. Cet article cherche à montrer en particulier la nature dialectique du projet de l’humaniste Lorenzo Valla dans sa « Repastinatio dialectice et philosophie », en soulignant la reprise réfléchie et novatrice de la réflexion grecque et latine sur les arts du discours.
Comment bien définir une puissance ? Sur la notion de puisance des contraires (Aristote, Métaphysique, Theta, 2)
L'opération qui définit une puissance est, pour Platon comme pour Aristote, son acte ou sa fin. Platon soutient qu’une puissance ne possède qu’une seule opération propre (conception monovalente de la puissance). Si Aristote souscrit à cette thèse, en y ajoutant quelques précisions destinées à permettre de bien définir les puissances, il semble compliquer la question en introduisant la notion de puissance des contraires qu’il élabore au chapitre 2 du livre Theta de la Métaphysique. Cependant la puissance des contraires ne doit être définie elle-même qu’en fonction de ce qui est son objet en soi, et non par accident ; en outre, on se demandera s’il est certain que la notion de puissance « accompagnée de raison », qui est au fondement de la puissance des contraires, permette vraiment à Aristote de dépasser la conception monovalente de la puissance : le logos montre-t-il bien à lui seul sa privation ?
La fin du Phèdre de Platon (274B- 279C) : ésotérisme et anti-ésotérisme
À partir d'un ouvrage récent de W. Kühn sur la fin du Phèdre de Platon (2000) et des critiques de Th. Szlezák, l’auteur met en parallèle, dans la première partie de cette étude, la lecture anti-ésotériste de Kühn et la lecture ésotériste de Szlezák du finale du Phèdre (274b-279c), pour en dégager trois antinomies herméneutiques. Dans la deuxième partie, il tente de résoudre ce conflit d’interprétations en empruntant la voie herméneutique et en faisant des observations critiques sur chacune de ces antinomies. Dans la troisième partie de cette étude, l’auteur s’attaque au fondement historique des paradigmes d’interprétation adoptés par chacun des auteurs. Le paradigme anti-ésotériste repose sur le principe herméneutique de l’autarcie des dialogues dont le fondement historique est le Corpus Platonicum, tandis que le paradigme ésotériste repose sur le principe herméneutique de l’enseignement oral de Platon dont le fondement historique est constitué par les Testimonia Platonica. L’auteur montre, après un survol des Testimonia Platonica de Gaiser (1963), de Krämer (1982) et d’Isnardi Parente (1997 et 1998), que ceux-ci ne permettent pas encore d’établir des certitudes historiques sur le contenu de l’enseignement oral de Platon.
Le charme de Socrate : Ficin interprète de Platon
Le Commentarium in Convivium Platonis de Marsile Ficin célèbre le Banquet de Platon. Mais dans cette reprise laudative, de notables infléchissements témoignent d'une réinterprétation décisive du legs du platonisme. En se centrant sur la seule réécriture du portrait de Socrate par Alcibiade, l'article met ainsi en évidence des modifications troublantes et répétées de détail en détail – la laideur du silène, l'atopie du philosophe et la puissance corybantique de ce Marsyas disparaissent au profit de l'éloge d'un Socrate qui « charme » par son éloquence supérieure et apparaît comme un verus amator. Loin d'être mineures, ces modifications répondent en fait à un remaniement métaphysique de la conception de l'amour et, conséquemment, de la « philosophie », où se perd la dimension inquiétante de la mania platonicienne. L'effroi de la dépossession est désormais circonscrit dans le circuitus spiritualis normé d'une harmonie cosmique.