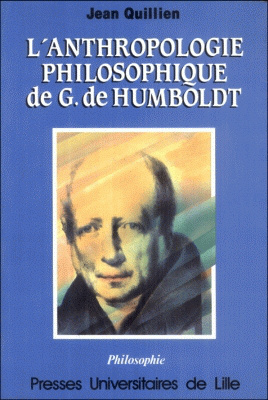L'anthropologie philosophique de G. de Humboldt
Première édition
Livre épuisé
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) est une personnalité souvent citée, un auteur peu connu, un penseur méconnu. Son oeuvre ne trouve guère place que dans les histoires de la linguistique, comme une étape dans la série des réflexions métaphysiques sur le langage ou un moment de la préhistoire d'une science, la linguistique. En vérité, sa théorie du langage ne peut se comprendre, en sa signification profonde et en sa visée essentielle, à partir des seuls écrits strictement linguistiques plus tardifs (après 1820), mais requiert la mise à jour, objet de la présente étude, de la fondation philosophique sur laquelle elle repose toute entière. Celle-ci a été construite dans la décennie 1790-1800 sur fond d'une méditation approfondie et renouvellée du kantisme puis, sur cette base théorique, à travers l'exploration méthodique, constamment appuyée sur un savoir positif considérable, de divers domaines de la connaissance et del'activité humaines. Compris comme autant d'essais pour élucider, grâce à la coopération de la spéculation et de l'empirie, la question: Qu'est-ce que l'homme?, reconnnue comme la question fondamentale de la philosophie, les écrits apparemment hétérogènes de cette période décisive révèlent alors une réelle unité. Cette pensée, ainsi dévoilée, se montre comme une tentative très originale, sans doute en son temps inactuelle, pour frayer, à partir du criticisme décelé comme le début de la modernité, une voie tout à fait autre que celle qui, de Fichte à Hegel, s'est imposée à la postérité, celle d'une anthropologie philosophique, qui effectue la transformation de la philosophie transcendantale en une philosophie de l'homme. Celle-ci, élaborée très tôt, au tournant de deux siècles, contient la clé de l'intelligibilité de ce qu'on appelle la "philosophie du langage" de Humboldt, laquelle n'est est, de fait, que l'ultime figure, celle qui achève cette transformation en découvrant le langage comme la médiation dernière entre l'homme et le monde. Dans cette optique, cette pensée authentiquement philosophique peut être appréciée comme l'origine d'une interprétation de l'univers humain qui ne trouvera sa reprise qu'en notre siècle.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- Jean Quillien,
- Collection
- Philosophie
- ISSN
- 1258116X
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée > Philosophie, herméneutique, philologie
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée
- Date de première publication du titre
- 1991
Livre broché
- Date de publication
- 1991
- ISBN-13
- 9782859393946
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 648
- Code interne
- 376
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 1136 grammes
- Prix
- 22,86 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3