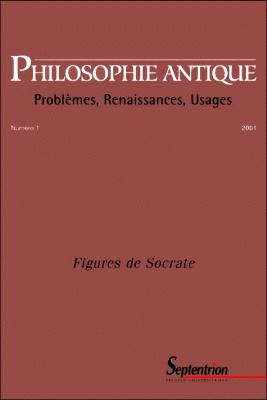Philosophie Antique n°1 - Figures de Socrate
Première édition
Attachement à la mémoire du maître, désir de prolonger ou faire renaître son enseignement, utilisation de son personnage à des fins d'exposition philosophique personnelle : c’est aux motifs les plus divers qu’obéit, dès la première génération des socratiques et aujourd’hui encore, l’évocation du philosophe au nez camus. L’ambition de ce premier numéro de Philosophie antique est, sinon d’exposer cette diversité dans toute son ampleur, au moins d’en donner un aperçu. Peut-être la « question socratique » doit-elle être tenue pour définitivement insoluble, et n’avons-nous jamais affaire, sous le nom de Socrate, qu’à des images d’un original effacé : ces images n'ont pas moins contribué que le Socrate historique lui-même à façonner l'histoire de la philosophie.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Philosophie antique
- Partie du titre
-
Numéro 1
- Édité par
- André Laks, Michel Narcy,
- Revue
- Philosophie antique | n° 1
- ISSN
- 16344561
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée > Philosophie, herméneutique, philologie
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée
- Date de première publication du titre
- 2001
- Type d'ouvrage
- Numéro de revue
Livre broché
- Date de publication
- 27 mai 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0768-4
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 314
- Code interne
- 1501
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 497 grammes
- Prix
- 26,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
- Date de publication
- 27 mai 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0802-5
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 314
- Code interne
- 1501P
- Protection technique e-livre
- Aucun
- Prix
- 19,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Liste des abréviations
Introduction
I- D.H. Lawrence : la personnalité et l'impersonnalité
II- Le Masque : de l’objet cultuel au concept poétique
1- Divers aspects de l’objet masque
2- Transposition poétique : le langage comme masque
3- Aporie de la présence / absence
4- Masque et stratégie de protection
5- Le masque : objet d’analyse poétique
Chapitre I
L’hybridité du « je » masqué.
I- L’homme masqué : une « totalité monstrueuse »?
1- L’homme et le masque sacré
2- L’homme au masque animal
II- Le masque enfantin : innocence ou régression ?
1- Langage, langues et comptines
2- Régression : le masque enfantin, un porteur d’expression négative sur le « je » adulte.
III- Le masque féminin
1- Mise en place d’un « je » féminin
2- Le motif de l’androgyne
3- Désir d’identification
4- Le masque féminin, un instrument de révélation détournée pour le « je » masculin ?
IV- Hybridation : état transgressif et interstitiel
1- Le conflit fructueux des deux entités en décalage
2- Fusion et appropriation Romantique
3- Le masque comme moyen d’être versatile
Chapitre II
Masques et « je » intertextuel
I- Particularités de l’intertexte comme porte-parole
1- Esthétisation du « je »
2- Répétitions et intertextes
3- Décontextualisation du fragment textuel : l’exemple du masque de Hamlet
II- Dire « je » par le biais de l’intertexte
1- Déplacements ludiques
2- Intertexte et rite de passage
3- Les épigraphes
4- Prendre la voix d’un autre poète ou d’une de ses personae
Chapitre III
Le masque religieux
I- Positionnement par le masque religieux du « je » poétique individuel par rapport à une croyance partagée
1- Le discours religieux, un indice de consensus ?
2- « Je » poétique et consensus religieux
3- Masque religieux : problématique signe / référent
4- Quelques « interprétations » du masque apocalyptique
II- La prière comme intertexte : un « je » poétique en « je » paroissien
1- Les titres trompeurs : des masques divertissants
2- Le masque de la prière : un recul de la subjectivité du « je » poétique ?
3- Jeux poétiques avec le masque du « je » paroissien
III- Hybridation du texte religieux et du « je » blasphémateur
1- Polyglossie : la parole unique déchue
2- Situations dialogiques
3- Utilisation subversive du discours religieux : de la violence intertextuelle à l’iconoclasme
IV- « Je » poétique et masque prophétique
1- Spécificités du prophète moderne
2- Le « je » lawrencien, un « je » prophétique ?
Conclusion
Bibliographie
Index