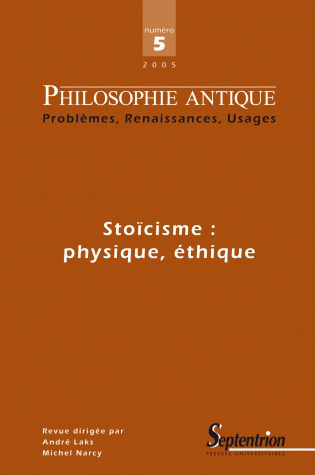Philosophie Antique n° 5 - Stoïcisme : physique, éthique
Première édition
Le thème du numéro est constitué par une question essentielle du stoïcisme : le lien entre sa conception de l'univers matériel et son éthique. Sur ce thème, plusieurs des meilleurs spécialistes français du stoïcisme présentent des analyses originales... Lire la suite
Le thème du numéro est constitué par une question essentielle du stoïcisme : le lien entre sa conception de l'univers matériel et son éthique. Sur ce thème, plusieurs des meilleurs spécialistes français du stoïcisme présentent des analyses originales, qui renouvellent l'approche de qui fut l'une des philosophies dominantes de l'Antiquité. Deux articles sur un philosophe cynique, c'est-à-dire un précurseur du stoïcisme complètent le numéro.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Marque d'éditeur
- Philosophie antique
- Partie du titre
-
Numéro 5
- Édité par
- André Laks, Michel Narcy,
- Revue
- Philosophie antique | n° 5
- ISSN
- 16344561
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée > Philosophie, herméneutique, philologie
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Savoirs et systèmes de pensée
- Date de première publication du titre
- 2005
- Type d'ouvrage
- Numéro de revue
Livre broché
- Date de publication
- 2005
- ISBN-13
- 9782859399160
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 256
- Code interne
- 962
- Format
- 16 x 24 x 1,6 cm
- Poids
- 475 grammes
- Prix
- 20,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
La dimension physique de la vertu
Thomas Bénatouïl
Le stoïcisme ou le matérialisme impossible
Jean-Joël Duhot
La prohairesis chez Épictète : décision ou « personne morale » ?
Jean-Baptiste Gourinat
« Vivre en accord avec la nature » ou « vivre en accord avec Zénon » ?
Gilbert Romeyer Dherbey
Sur les polémiques des anciens stoïciens
Daniel Babut
Cratès, la fourmi et l'escarbot : les cyniques et l’exemple animal
Olimar Flores-Júnior
Comptes rendus
Bulletin bibliographique
Extrait
Force, fermeté, froid : la dimension physique de la vertu stoïcienne
La vertu du sage stoïcien se définit non seulement par la rationalité de ses jugements mais aussi par sa force mentale, qui résulte d'une intensification de la « tension » de l’âme. Dès Zénon et sous l’influence d'Antisthène, les stoïciens conçoivent ces dimensions logiques et physiques de la vertu comme inséparables, même si Cléanthe et Chrysippe analysent différemment leurs rapports. La force d’âme du sage est aussi présente au sein même de la définition stoïcienne de la science à travers l’adjectif bebaios (« ferme »), qui désigne la résistance et la fiabilité du sage dans tous les domaines, mais aussi une solidité strictement physique. Or l’âme et la vertu sont des corps pour les stoïciens, si bien qu’ils ont probablement conçu l’acquisition de la vertu comme le résultat d’un refroidissement durcissant l’air qui compose l’âme du sage. On examine quatre problèmes posés par cette hypothèse, puis l’on montre l’originalité de la « naturalisation » stoïcienne de la vertu conçue comme tension permanente de l’âme.
Le stoïcisme : une métaphysique de l’information ou le matérialisme impossible
La philosophie s'est construite sur le dualisme. Esprit et matière, âme et corps s’opposent dans une évidence qui traverse presque toute l’histoire de la philosophie, et sur laquelle s’articule la question du matérialisme. Or il y avait une autre voie que ce dualisme qui, renouvelé par Descartes, a conduit la philosophie classique dans ses impasses : celle que les stoïciens avaient ouverte en toute connaissance de cause. L’âme est corps, la pensée est incarnée, sans que cela conduise au matérialisme, puisque l’univers est totalement finalisé. Cette solution, qui peut nous sembler artificielle, est en réalité parfaitement cohérente et s’appuie sur une métaphysique de l’information, qui permet de comprendre ce qui passait jusqu’à présent pour des subtilités plus ou moins gratuites, et dont nous pouvons aujourd’hui mesurer toute la pertinence. Le cosmos est organisé sur le modèle du langage, celui d’un sens encodé dans de la matière.
« Vivre en accord avec la nature » ou « vivre en accord avec Zénon » ?
Il existe deux témoignages divergents de la définition du telos de la vie humaine par le stoïcien Zénon : celui de Diogène Laërce et celui de Stobée. Or, ces témoignages ne se recoupent pas exactement, puisque le premier affirme que le telos est de « vivre en accord avec la nature » (formule longue), alors que le second le définit comme « vivre accordé (à soi-même) » (formule courte).
Après avoir examiné les sources, l'A. interroge l’interprétation philosophique des deux formules présentée par Joseph Moreau et, à partir de la critique de cette interprétation, tente d’établir le bien-fondé du témoignage de Diogène Laërce, c’est-à-dire de l’attribution à Zénon de la formule longue.
Sur les polémiques des anciens stoïciens
Pour élucider les motivations des stoïciens à polémiquer contre les autres écoles philosophiques, on est amené à s'interroger sur la place et la fonction de la dialectique dans le système stoïcien. Or il apparaît que, au lieu de la fonction heuristique qui est la sienne dans l’enseignement de l’Académie, la dialectique n’a chez les stoïciens qu’une fonction défensive : elle ne sert pas à découvrir la vérité par l’examen critique des arguments opposés, mais à défendre contre les objections une vérité déjà connue. Cette certitude des stoïciens de posséder la vérité se rapprocherait donc en quelque sorte d’une foi religieuse.
La prohairesis chez Épictète : décision ou « personne morale » ?
La notion de prohairesis est l'une des notions centrales du stoïcisme d’Épictète. Alors que cette notion avait dans l’ancien stoïcisme une place mineure, celle d’une forme d’impulsion consistant en un « choix avant un choix », et n’avait que rarement (notamment chez Diogène de Séleucie) un sens plus large, c’est bien à l’aristotélisme qu’Épictète paraît avoir emprunté une notion de la prohairesis comme choix préférentiel étroitement liée à celle d’eph’ hemin (« ce qui dépend de nous »). Mais Épictète a introduit de nombreuses transformations au sein de cette notion, l’étendant à toutes les facultés actives de l’âme, y compris l’assentiment, et faisant de la prohairesis la seule chose qui dépende de nous, et non pas un choix portant sur ce qui dépend de nous comme chez Aristote. Une analyse des différents sens de la prohairesis montre que cette notion apparaît à la fois comme une décision ponctuelle, comme la faculté de prendre des décisions, et, dans un sens plus particulier, comme le choix préliminaire d’un mode de vie ou d’un personnage. De ce fait, la prohairesis n’est pas à proprement parler une « personne morale », comme on le soutient souvent, mais contribue à la constituer parce que c’est elle qui constitue l’essence du bien et du mal.
En annexe de l’article figurent un tableau synthétique des occurrences du terme dans les Entretiens et le Manuel et un appendice sur l’expression eph’ hemin dans le stoïcisme avant Épictète.
Cratès, la fourmi et l’escarbot : les cyniques et l’exemple animal
En partant d'un poème de Cratès de Thèbes transmis par Julien (Or. VII, Contre Héracleios le Cynique, 9, 213a-214a et Or. IX [VI], Contre les cyniques ignorants, 17, 199c-200b), cet article se propose de montrer que les cyniques ont puisé dans le monde animal non seulement leur paradigme d’une vie kata phusin, mais aussi des contre-exemples illustrant les comportements que l’homme doit éviter.
Les écrits de Cratès de Thèbes selon Diogène Laërce (II, 118, 126 ; VI, 85-98)
Pourquoi Diogène Laërce ne rend-il pas compte de toute la production littéraire de Cratès et en traite-t-il autrement qu'il ne le fait pour Antisthène et Diogène ? Plusieurs réponses s’avèrent plausibles : soucieux d’équilibrer les différentes parties de son ouvrage, il omet volontairement des textes qui constitueraient des redites par rapport à ceux qu’il a déjà cités ; choisissant Antisthène comme fondateur du cynisme, il passe sciemment sous silence des textes de Cratès qui, le rapprochant davantage de Diogène, mettraient en relief la place prépondérante de ce dernier au sein du mouvement cynique ; enfin, cherchant à produire un nouvel ouvrage d’historiographie de la philosophie, c’est à dessein qu’il néglige les sources étrangères à cette discipline.