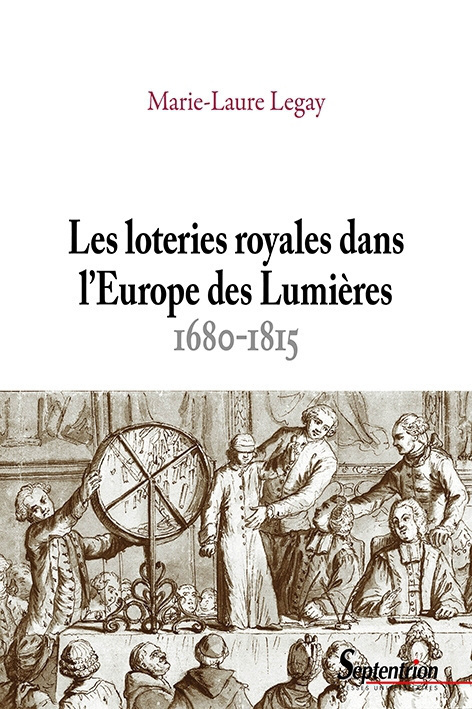Les loteries royales dans l'Europe des Lumières
1680-1815
Première édition
Un « impôt sur les imbéciles », une « friponnerie », un « jeu cruel », un « fléau inventé par le despotisme »… Les hommes des Lumières n'avaient pas de mots assez durs pour dénoncer la loterie royale, une institution que tous les Etats européens ont mis sur pied au XVIIIe siècle. Les souverains encourageaient donc la passion du jeu, l'oisiveté... Lire la suite
Un « impôt sur les imbéciles », une « friponnerie », un « jeu cruel », un « fléau inventé par le despotisme »… Les hommes des Lumières n'avaient pas de mots assez durs pour dénoncer la loterie royale, une institution que tous les États européens ont mis sur pied au XVIIIe siècle. Les souverains encourageaient donc la passion du jeu, l’oisiveté, et captaient sans vergogne l’épargne de leurs sujets ? Faire croire que l’on gagne, tandis que l’on perd toujours, n’était-ce pas le propre d’un État corrompu ?
Ou bien doit-on plutôt considérer la loterie royale comme un outil d’ingénierie financière, le fruit d’une nouvelle rationalité publique ? La loterie est incompatible avec le secret de la finance, encore défendu par les doctrines absolutismes du pouvoir. Son succès s’appuie nécessairement sur les gazettes, la publicité, la transparence, tant de la roue de la fortune hissée sur une estrade, que des comptes, car tout soupçon de fraude doit être écarté. Pour la première fois, l’État s’expose à ne pas perdre la confiance du public. Les « calculateurs », — des plus savants, comme d’Alembert ou Condorcet, aux plus aventuriers comme le jacobite John Glover ou le vénitien Giacomo Casanova —, proposent des méthodes de gains qui garantissent un revenu permanent, tandis que la croissance du XVIIIe siècle permet le développement de l’épargne populaire. Voici donc que le hasard, combiné à l’abondance, génère un revenu public, un fonds de trésorerie que tous les souverains convoitent.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- Marie-Laure Legay,
- Collection
- Histoire et civilisations
- ISSN
- 12845655
- Langue
- français
- Mots clés
- Histoire économique
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Histoire contemporaine
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Histoire moderne
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société
- Date de première publication du titre
- 01 octobre 2014
Livre broché
- Date de publication
- 01 octobre 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0788-2
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 172
- Code interne
- 1527
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 288 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
- Date de publication
- 01 octobre 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0872-8
- Illustrations
- 12 illustrations, couleur/ 3 illustrations, noir et blanc
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 172
- Dépôt Légal
- 2014-10
- Code interne
- 1527P
- Protection technique e-livre
- Aucun
- Prix
- 15,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
ePub
- Date de publication
- 01 octobre 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0869-8
- Illustrations
- 12 illustrations, couleur/ 3 illustrations, noir et blanc
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 172
- Dépôt Légal
- 2014-10
- Code interne
- 1527E
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Pack de titres multiples
- Contenu du produit
- Loteries royales dans l'Europe des Lumières (Livre broché)
9782757407882
Loteries royales dans l'Europe des Lumières (ePub) 9782757408698 - Date de publication
- 01 octobre 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0875-9
- Illustrations
- 12 illustrations, couleur/ 3 illustrations, noir et blanc
- Dépôt Légal
- 2014-10
- Code interne
- 1527L
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Première partie – Jeux d'État et morale publique
Chapitre 1 : Loteries et utilité publique
1. Un nouveau contrat moral : les guerres de Louis XIV et les loteries de charité
2. De la charité à l’utilité publique
3. « La réunion des loteries à la Finance »
4. Le danger social
Chapitre 2 : Les plans de loteries : L’État et les entrepreneurs de chance
1. Les entrepreneurs de loterie
2. Le jacobite Jean Glover et les premières loteries populaires
3. La banque italienne et les frères Calzabigi
Chapitre 3 : Loteries royales et crédit public
1. Les loteries-emprunts
2. Les loteries de remboursement : une gestion aléatoire de la dette
3. Loteries et agiotage au temps de Necker
Deuxième partie – Loteries et gouvernement des finances
Chapitre 4 : Administrer les loteries
1. Fermes ou régies ?
2. La collecte et les bureaux de recette
3. Les frais de gestion
Chapitre 5 : La part du roi
1. Limiter les risques : les opérations secrètes du castelletto
2. Constituer un fonds de trésorerie
3. Un fonds pour subventionner le clergé et la noblesse ?
Chapitre 6 : Le défi comptable : calculer le bénéfice
1. L’expérience française
2. L’expérience viennoise
3. À Bruxelles
Troisième partie – Loteries royales et espaces publics
Chapitre 7 : Guerre d’argent et guerre d’information
1. Concurrence allemande et publicité royale
2. Utiliser les journaux : information et désinformation
3. Fausses et vraies lumières : l’édition
Chapitre 8 : Loteries et opinion publique
1. Établir la confiance
2. Lutter contre la fraude et les faux-billets
3. Murmures au Palais royal, rumeurs à Bruxelles
Chapitre 9 : Loteries et esprit critique
1. Philosophie de l’espérance et vérités mathématiques : l’apport de Buffon
2. « Un impôt sur les imbéciles » ? Comportement du joueur et calcul de l’État
3. Loteries « insidieuses » et patriotisme
4. Les beaux jours de la Loterie nationale et impériale
Conclusion
Sources et bibliographie
Sources imprimées
Sources manuscrites
Bibliographie
Table des illustrations
Table des tableaux et graphiques