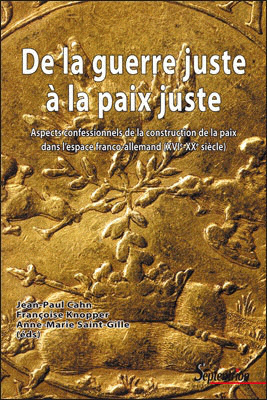De la guerre juste à la paix juste
Aspects confessionnels de la construction de la paix dans l'espace franco-allemand (XVIe-XXe siècle)
Première édition
Cet ouvrage contribue, à partir d'études de cas empruntées au passé de la France et de l'Allemagne, à une réflexion sur les problèmes que pose la transition de la guerre à la paix. Il aborde la question: comment construire la paix à partir d'un angle d'attaque qui fait la part belle à la dimension confessionnelle, dont on sait l'importance -et l'ambivalence- pour la représentation des conflits comme pour la construction de la paix dans l'espace germanique et, dans une moindre mesure, dans l'histoire de la nation française. Il retrace l'évolution qu'ont connue, au fil de quatre siècles, les réflexions sur la guerre et la paix en France et en Allemagne, et il analyse les causes intérieures et extérieures de la fragilité des paix. Un accent est d'abord mis sur les traités de paix de Westphalie qui ont comblé les lacunes de 1555 et offert des garanties juridiques fondamentales. Puis les auteurs montrent comment l'inadéquation s'est creusée, au XVIIIe et au XIXe siècle, entre les théoriciens de la paix et les chantres des conflits, l'adversaire devenant, d'hérétique ou rebelle, l'ennemi de la nation. Les divergences entre chrétiens pacifistes et adeptes d'une forte présence militaire ont alors incité certains protestants à distinguer de plus en plus la sphère privée de la sphère publique. Cette distinction se retrouvera même chez des résistants au Troisième Reich et sera également, pendant la Guerre froide, au coeur des débats entre adeptes ou détracteurs du réarmement.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Avec
- Eleni Braat, Guido Braun, Patrick Cabanel, Rémy Cazals, Mechthild Coustillac, Claire Gantet, François Genton, Hubert Guicharrousse, Bernd Hey, Hilda Inderwildi, Ekkehard Klausa, Anne Lagny, Gérard Laudin, Sylvie Le Grand, Thomas Nicklas, Jean-Marie Paul, Alain Ruiz, Christina Stange-Fayos, Thierry Wanegffelen,
- Édité par
- Jean-Paul Cahn, Françoise Knopper, Anne-Marie Saint-Gille,
- Collection
- Histoire et civilisations
- ISSN
- 12845655
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Histoire générale
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société
- Date de première publication du titre
- 22 septembre 2008
Livre broché
- Date de publication
- 22 septembre 2008
- ISBN-13
- 9782757400388
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 314
- Code interne
- 1085
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 590 grammes
- Prix
- 25,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3