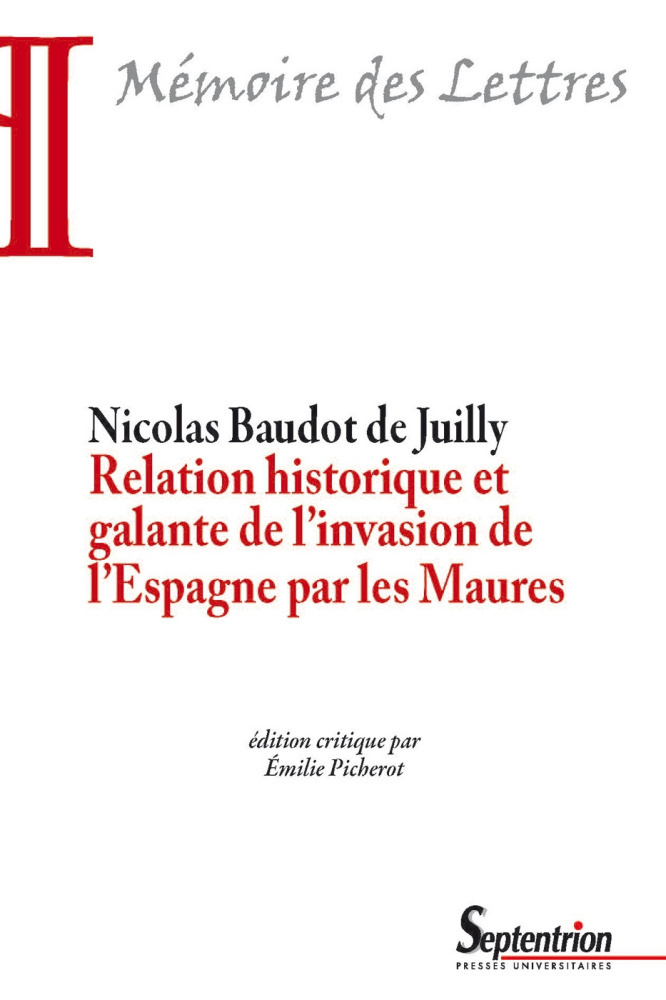Relation historique et galante de l'invasion de l'Espagne par les Maures
Première édition
Publié en 1699, ce roman retrace l'histoire de l’entrée des musulmans en Espagne et s’oppose aux historiens espagnols qui prônent la pureté de sang : le romancier français insiste sur l’importance des mariages mixtes et l’amitié nécessaire et bénéfique entre chrétiens et musulmans. Le dernier roi Goth, Rodrigue, est en fait lui-même le fruit... Lire la suite
Publié en 1699, ce roman retrace l'histoire de l’entrée des musulmans en Espagne et s’oppose aux historiens espagnols qui prônent la pureté de sang : le romancier français insiste sur l’importance des mariages mixtes et l’amitié nécessaire et bénéfique entre chrétiens et musulmans. Le dernier roi Goth, Rodrigue, est en fait lui-même le fruit d’une union mixte et la « race espagnole » ne doit sa supériorité qu’au mélange des cultures. Les combats deviennent des rencontres, favorisant l’amour et l’amitié entre les membres des deux armées. Défendant à chaque page cette spécificité de l’histoire espagnole particulièrement romanesque, le roman insiste sur les ressemblances entre chrétiens et musulmans et rappelle l’incompréhensible injustice que les chrétiens ont fait subir aux juifs en 1492 et aux descendants des musulmans par la suite. Anonyme, deux fois publié aux Pays-Bas, le roman a vraisemblablement plu aux lecteurs protestants de l’époque car le message de tolérance religieuse et de nécessaire mixité ne pouvait que rappeler la situation des victimes de la révocation de l’Edit de Nantes. Reprenant les codes du roman historique, cette Relation n’est pas sans humour et offre un récit romanesque et agréable de la naissance d’une Espagne des trois cultures qui devient l’exemple admirable et littéraire de la tolérance religieuse.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- Nicolas Baudot de Juilly,
- Édité par
- Émilie Picherot,
- Collection
- Mémoire des lettres
- ISSN
- 1761399X
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et arts > Lettres et littérature française
- Catégorie (éditeur)
- Septentrion Catalogue > Lettres et arts
- Date de première publication du titre
- 28 février 2015
Livre broché
- Date de publication
- 28 février 2015
- ISBN-13
- 978-2-7574-0880-3
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 274
- Code interne
- 1550
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 455 grammes
- Prix
- 29,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
- Date de publication
- 28 février 2015
- ISBN-13
- 978-2-7574-1129-2
- Illustrations
- 1 cartes/ 1 graphiques
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 274
- Code interne
- 1550P
- Protection technique e-livre
- Aucun
- Prix
- 21,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Préface
I. Le genre hispano-mauresque en France
II. Le choix de 711 : la légende du roi Rodrigue
III. La légende de Rodrigue avant la Relation : les sources déclarées et réelles
IV. L'auteur
V. Les différentes éditions
VI. Établissement du texte
VII. Bibliographie sélective
Relation historique et galante, de l’invasion de l’Espagne par les Maures
Tome 1
Tome 2
Tome 3
Tome 4
Annexe 1 : Les rois wisigothiques à partir de Sisebut
Annexe 2 : Carte de l’Espagne et des principaux lieux cités dans le roman