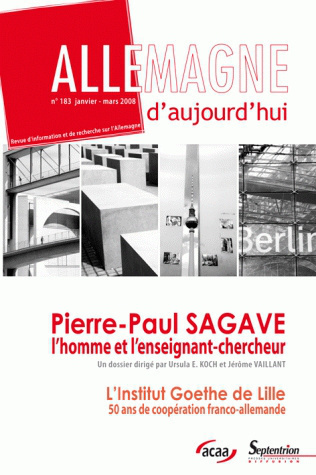Allemagne d'aujourd'hui, n°183/janvier - mars 2008
P.-P. Sagave, l'homme et l’enseignant-chercheur
First Edition
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Imprint
- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui
- Title Part
-
Numéro 183
- Journal
- Allemagne d'aujourd'hui | n° 183
- ISSN
- 00025712
- Language
- French
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations > Germanic and Scandinavian countries
- Publisher Category
- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations
- Title First Published
- 2008
Paperback
- Publication Date
- 2008
- ISBN-13
- 9782757400463
- Code
- 1095
- List Price
- 12.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
P-P Sagave, l'homme et l'enseignant-chercheur
U.E Koch et J. Vaillant
Ouverture par Ch. Deussen
Pierre-Paul Sagave, prussien, allemand et français, sa place dans les relations franco-allemandes
Un Berlinois de naissance et fier de l'être U.E. Koch – P.-P. Sagave
Du sujet prussien et ressortissant du Reich au citoyen français. La « rémigration » de P.-P. Sagave, descendant de huguenots du refuge berlinois A. Ruiz
P.-P. Sagave, un médiateur franco-allemand H. Schulte
P.-P. Sagave, spécialiste de Th. Fontane M. Thuret
L’apport de P.-P. Sagave à la recherche sur Fontane E. Sagarra
P.-P. Sagave et Th. Mann J. Darmaun
Souvenirs de P.-P. Sagave. Ses cours sur Th. Mann H. Harder
Th. Mann et le mythe du « chevalier d’industrie ès lettres » G. Valin
L’apport du chercheur en civilisation
P.-P. Sagave, collaborateur économique d’Allemagne d’aujourd’hui J. Vaillant
P.-P. Sagave, professeur de responsabilité civique Témoignages de G. Valin, S. Gouazé, B. Lestrade
Images de l’Allemagne transmises par notre père Témoignages d’I. Sagave-Bouder et de C. Sagave-André
La civilisation allemande en perspective H. Miard-Delacroix
Vie politique, économique, sociale et culturelle
Le SPD, le débat sur l’Agenda 2010 et le Congrès de Hambourg. Virage à gauche ? M. Weinachter
La réforme des diplomaties culturelles dans les années 1970 : la RFA et la France sur le même chemin ? E. Lanoë
Le Goethe-Institut de Lille : 50 ans de coopération culturelle franco-allemande *
Jérôme Vaillant
Tacheles : la construction d’une cathédrale de la sub-culture ? E. Bournizien
Actualité sociale
Brigitte Lestrade
Conjoncture allemande : dans la moyenne européenne Hans Brodersen*
Notes de lecture J-C. François
Compte rendu S. Martens
Carnet littéraire
Chantal Simonin
Excerpt
P-P Sagave, l'homme et l'enseignant-chercheur
A l'initiative d'Henri Ménudier, d'Ursula E. Koch et de Jérôme Vaillant, Allemagne d'aujourd'hui a invité le 19 octobre 2007 à la Maison Heinrich Heine, à Paris, à une journée d'étude qui rende à la fois hommage à l'homme et au germaniste que fut Pierre-Paul SAGAVE et évalue son oeuvre. Cette journée s'est déroulée en trois temps, le premier a été l'occasion de retracer le parcours de P-P Sagave, le second d'évoquer son œuvre de germaniste dans le domaine de la littérature comme dans celui de la civilisation, le troisième d'évaluer, dans le cadre d'une table ronde à laquelle ont participé H. Ménudier, H. Miard-Delacroix, B. Lestrade, J. Vaillant et Alfred Grosser les perspectives de la recherche et de l'enseignement de la civilisation allemande en France aujourd'hui. Il a été demandé à Christiane Deussen, directrice de la Maison Heinrich Heine d'inaugurer cette journée et à Hélène Miard-Delacroix de clore ce dossier.
Ouverture
Pierre-Paul Sagave fait partie de ces personnalités, qui à travers leurs recherches en germanistique nous invitent à découvrir l'Allemagne dans toute sa richesse littéraire et culturelle, mais aussi sociale et économique. Il fait partie de ceux qui ont compris très tôt que parler de l'Allemagne d'aujourd'hui ne peut se limiter à des études purement littéraires. Etudier et parler de la réalité de la société allemande, de son histoire, et de son économie fait partie intégrante de la germanistique aujourd'hui. Pierre-Paul Sagave, grand connaisseur de la civilisation allemande, est l'un des fondateurs de ce que nous appelons dans le contexte universitaire français aujourd'hui les études de civilisation allemande, concept comme vous le savez, au début mal connu et mal compris outre-Rhin.
Pierre-Paul Sagave était un véritable précurseur de cette discipline qui, à l'heure actuelle, au regard de la baisse inquiétante du nombre des étudiants en allemand, peut encore sauver l'intérêt des Français pour son voisin. Je pense que nous avons toujours beaucoup à apprendre de son approche de la germanistique qui voulait en faire une discipline proche de la réalité sociale, politique et économique, mais aussi littéraire. Peut-être le terme de « Kulturwissenschaften » très utilisé en Allemagne pourrait- il lui convenir.
Pierre-Paul Sagave était une personnalité tout à fait exceptionnelle. La multitude de ses expériences personnelles faites au cour de sa vie, son ouverture d'esprit et la richesse de son œuvre scientifique et journalistique est surprenante : de Fontane à Thomas Mann, en passant par Ernst von Salomon, la Prusse et la ville de Berlin dans ses mutations - il parle aussi de sa laideur et de sa beauté - et ensuite ses travaux sur l'économie allemande et les entreprises comme Volkswagen ou Krupp font partie d'une œvre universitaire riche et foisonnante.
Cette journée nous offre la possibilité de la découvrir grâce à des tables rondes entre spécialistes de l'homme et de la discipline. Peut-être pourrons-nous également, à la fin de cette journée, donner une réponse provisoire sur la manière de poursuivre les études d'allemand en France dans l'esprit de Pierre-Paul Sagave.
-Christiane DEUSSEN -
Actualité sociale
Le président fédéral Horst Köhler, dans son allocution de Noël, où il a appelé les Allemands à faire preuve de plus de solidarité entre les générations, s'est fait le porte-parole d'un débat qui a dominé cette fin d'année 2007. Comment protéger les enfants de la pauvreté et de la violence, violence dans les familles, dans les écoles, dans la rue ? Angela Merkel a pour l'instant refusé d'inscrire les droits de l'enfant dans la Constitution, comme le souhaite Kurt Beck, le chef de file des sociaux-démocrates. Ce débat s'inscrit dans celui plus vaste de la lutte contre la pauvreté et le maintien du pouvoir d'achat qui contribue à alimenter la controverse autour du salaire minimum. Celui des services postaux étant acquis, la question de sa généralisation continue de diviser le gouvernement. En contrepoint aux bas salaires sont aussi évoquées les rémunérations des dirigeants d'entreprise que d'aucuns souhaiteraient limiter et d'autres non.
Comment prévenir les cas de maltraitance d'enfants ?
La fin de l'année 2007 a été marquée par la découverte de plusieurs enfants morts de suites de maltraitance. Au mois de novembre, trois cadavres de bébés ont été découverts à Plauen, une ville située à l'Est, dans le Land de Saxe ; dans la région voisine du Mecklembourg-Poméranie antérieure, des parents ont laissé mourir de faim Lea-Sophie, leur fillette de cinq ans ; en décembre, deux autres bébés ont été trouvés morts dans des conditions suspectes en Thuringe. Si le nombre d'enfants maltraités dans l'ancienne RDA est plus élevé qu'à l'ouest, ce dernier vit ses propres drames : cinq petits garçons ont été trouvés morts dans leur maison à Darry dans le Schleswig-Holstein, apparemment tués par leur mère.
L'accumulation du nombre de cas de maltraitance ou de morts d'enfants pourrait faire naître l'impression que la situation est en train de s'aggraver en Allemagne, peut-être en raison du nombre croissant d'enfants pauvres dans le pays (Actualité sociale, octobre 2007). Il semblerait toutefois que le nombre de meurtres d'enfants stagne depuis de nombreuses années. Il se situerait aux alentours d'une centaine par an, sachant toutefois que certains d'entre eux ne sont découverts que par hasard ou pas du tout. C'est la sensibilité accrue de la population et le traitement préférentiel des cas découverts par les médias qui contribuent à créer cette impression. En revanche, le nombre de cas de maltraitance semblent être en augmentation. L'Agence fédérale des affaires criminelles (Bundes-kriminalamt) a relevé environ 3000 cas signalés pour 2005, sachant que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, fait confirmé par les 26 000 enfants qui ont été retirés de leurs familles en 2006, d'après une information de l'Office fédéral de statistiques.
Après des décennies de désintérêt pour la politique familiale, le gouvernement allemand se réveille enfin (voir aussi l'article suivant). La chancelière Angela Merkel a estimé que l'Allemagne a besoin « d'une culture du regard » (Kultur des Hinsehens). La position de la ministre des familles, Ursula von der Leyen, semble évoluer dans ce domaine. Persuadée que le gouvernement ne peut pas se substituer aux parents, elle ne souhaite pas introduire une loi fédérale instaurant un système prévoyant la présentation obligatoire des enfants à un contrôle médical, considérant qu'une telle loi serait anticonstitutionnelle. Elle souligne cependant l'utilité de systèmes de prévention récemment initiés dans certaines régions. En Sarre, p. ex., depuis le printemps 2007, les parents sont invités à présenter leur nouveau-né à un médecin ; s'ils ne répondent pas à la convocation, ils reçoivent la visite d'un assistant social. La Bavière fait jouer l'incitation financière : pas d'allocations ou d'inscription à la crèche, si les parents ne font pas examiner leurs enfants. La conviction prévaut en Allemagne qu'on ne peut assurer une surveillance totale des enfants, mais les médecins, les sages-femmes et les services sociaux devraient travailler davantage ensemble pour détecter les cas à problème en amont, sans oublier l'attitude des voisins qui, s'ils avaient été plus attentifs, auraient pu éviter certains drames.
Les pères intéressés par le salaire parental
Depuis le 1er janvier 2007, les Allemands ont la possibilité d'interrompre leur carrière pendant douze, voire quatorze mois pour s'occuper de leur enfant (Actualité sociale janvier 2007). Le père ou la mère bénéficie d'un salaire parental atteignant 67% de son salaire net, 1800 € au maximum et 300 € au minimum. Si un seul des parents prend le congé parental, le salaire de substitution est versé pendant 12 mois, si les deux le font successivement, la durée totale maximale est portée à quatorze mois. Le 14 décembre 2007, la ministre de la famille, Ursula von der Leyen, a tiré le premier bilan de la mise en œuvre de cette loi. S'il est vrai que, dans la plupart des cas, ce sont les mères qui prennent un congé parental, le bilan a révélé qu'un nombre plus important de pères que prévu s'est prévalu de cette possibilité de s'occuper eux-mêmes de leur nouveau-né. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2007, 9,6% du total des demandes de salaire parental émanent des pères, c'est-à-dire 37 140, dont presque la moitié, 41,1%, ont choisi de s'arrêter entre trois et douze mois, donc nettement plus que les deux mois que la plupart des observateurs avaient considéré comme la durée maximale que s'octroieraient les jeunes pères. Devant le succès imprévu de cette mesure, le ministère doit demander une rallonge budgétaire de 130 millions d'euros pour financer les indemnités.
Contrairement aux craintes initiales, les entreprises se sont montrées ouvertes à ce nouveau dispositif, non seulement les grandes entreprises, mais également certaines PME/PMI. Selon un sondage commandité à l'automne 2006, peu avant l'introduction du nouveau congé parental, un tiers des entreprises y seraient favorables, ce qui lève un obstacle majeur à la généralisation de cette mesure. Devant le succès que rencontre le salaire parental, on peut espérer qu'il redonne envie aux Allemands d'avoir des enfants. Sans être aussi catastrophique qu'en Grèce, en Italie ou en Espagne, le taux de fertilité des Allemandes est désespérément étale depuis une dizaine d'années, variant de 1,36 enfant par femme en 1998 à 1,30 en 2006. Or, pour la première fois, le nombre de naissances semble avoir légèrement augmenté en 2007. Pour les neuf premiers mois de l'année, l'Office fédéral de statistiques a recensé 3 304 nouveau-nés supplémentaires par rapport à la même période de 2006.
Reste à voir si cette tendance se confirme. L'absence pendant des décennies d'une politique familiale active a créé un climat très hostile aux mères de famille souhaitant travailler et aux enfants en général, perçus comme des éléments perturbateurs par une société vieillissante. La politique menée par le gouvernement actuel qui souhaite favoriser la conciliation travail/famille pour les mères, notamment en multipliant le nombre de places en crèche et en maternelle, et en encourageant la paternité active, est le signe d'un changement de cap inédit, trop longtemps différé.
Violence et criminalité des jeunes
Une série d'agressions commises par des jeunes, souvent issus de l'immigration, a profondément choqué les Allemands. Avant Noël, dans une station de métro de Munich, deux jeunes, un Grec et un Turc, blessent grièvement un directeur d'école à la retraite qui leur avait demandé de ne pas fumer dans le métro. Les deux agresseurs, multirécidivistes au dossier particulièrement lourd, ont été arrêtés et inculpés de tentative d'homicide. Ce passage à tabac, qui a été suivi d'autres faits de violence en Bavière, a suscité un débat vigoureux au sein de la grande coalition sur les mesures à prendre face à la montée de la violence chez les jeunes, notamment ceux d'origine étrangère. Les médias, en particulier le quotidien populaire Bild, se sont emparés de l'affaire, publiant des statistiques policières qui montrent que les habitants de nationalité étrangère, qui constituent environ 9% de la population, sont responsables de 19% des délits. Pour des crimes lourds, tels que des meurtres, leur part avoisinerait les 30%. La moitié des délits des jeunes de moins de 21 ans seraient commis par des immigrés avec ou sans passeport allemand.
La perspective des prochaines élections régionales a exacerbé le débat. Les chrétiens-démocrates ont été les premiers à s'emparer du dossier. Roland Koch, ministre-président du Land de Hesse, qui affronte les élections du 27 janvier dans une situation de relative faiblesse, en a fait son cheval de bataille. La focalisation sur ce thème lui ayant déjà réussi en 1999, où son opposition à la double nationalité a contribué à son élection, il s'est saisi du sujet avec vigueur. Son plan contre la criminalité des jeunes prévoit entre autre un emprisonnement d'intimidation de plusieurs semaines de mineurs condamnés à la prison avec sursis, l'application obligatoire, et non pas facultative, de la législation pénale pour adultes à ceux âgés de 18 à 21 ans, le relèvement de la peine maximale pour mineurs de 10 à 15 ans ainsi que la reconduite dans leur pays d'origine d'immigrés ayant été condamnés à un an de prison ferme, au lieu de trois ans actuellement. Même la création de camps de rééducation fermés, à l'instar des « boot-camps » américains, est envisagée. Angela Merkel, restée un peu en retrait au départ soutient désormais la position de Roland Koch, afin de renforcer ses chances dans les élections régionales de Hesse qui apparaissent de plus en plus comme un test national, au risque de paraître droitiser son discours.
Les sociaux-démocrates, parte-naires d'Angela Merkel dans la grande coalition, sont quelque peu ennuyés par ce débat. Kurt Beck, le président du parti social-démocrate, garde le silence. Il ne souhaite pas alimenter un débat sur la criminalité des étrangers qui sert les partis de la droite. La ministre de la justice, Brigitte Zypries, dénonce pour sa part les propositions de la droite, notamment la création de camps de redressement, incompatibles, selon elle, avec la dignité humaine, même si elle admet qu'un séjour dans une institution où les jeunes s'habituent à un emploi du temps structuré et à des règles de comportement claires pourrait être bénéfique. La chancelière a de son côté convenu qu'une réflexion sur un durcissesment de l'arsenal législatif était nécessaire, mais que cela prendrait du temps. Sans attendre que le gouvernement fédéral bouge sur le dossier, certains Länder prennent les devants. Le gouvernement de Saxe a constaté que la nouvelle loi sur les établissements pénitentiaires pour mineurs autorise la fondation de maisons de correction ouvertes aux jeunes voulant éviter la prison. Le Bade-Wurtemberg prépare lui aussi des maisons correctionnelles. La violence des jeunes est devenu un sujet sensible pour les responsables politiques. Ils savent que le public est de moins en moins disposé à supporter les violences physiques assorties de violences verbales, telles que Scheißdeutscher, lancée au visage du retraité par les deux immigrés qui l'ont presque battu à mort à Munich avant Noël.
La revendication du salaire minimum généralisé rebondit
Si, à la faveur de plusieurs faits divers sanglants, la violence des jeunes accapare les médias à l'approche des élections régionales en Hesse et Basse-Saxe, au début de l'année 2008, le débat sur le salaire minimum rebondit, lui aussi. Alors que les conservateurs de la CDU/CSU se sont emparés du thème de la sécurité, demandant des mesures de protection accrues pour la population contre les agressions de bandes de jeunes de moins en moins contrôlables, les sociaux-démocrates du SPD poursuivent l'offensive dans le domaine du pouvoir d'achat. Ces élections régionales sont en effet le premier test électoral pour les deux grands partis de la coalition gouvernementale. Les deux chefs de file ne s'y trompent pas, Angela Merkel soutenant le discours sécuritaire de Roland Koch, premier ministre CDU du Land de Hesse, et Frank-Walter Steinmeier, vice-chancelier SPD appuyant la demande de son parti d'instaurer un salaire minimum pour tous.
Actuellement, un SMIC à l'allemande n'existe que dans le secteur du bâtiment. En juin 2006, à l'initiative des sociaux-démocrates, le gouvernement avait convenu d'étendre la législation sur le salaire minimum en vigueur dans le bâtiment à d'autres branches. Les fédérations de branches ont jusqu'au 31 mars 2008 pour négocier un salaire minimum, qui serait par la suite validé par le gouvernement fédéral. Un premier résultat a été obtenu fin novembre dans la branche postale après de longs mois d'âpres négociations. Dès le mois de janvier 2008, les facteurs allemands toucheront au moins entre 8 et 9,80 euros de l'heure de travail. La Deutsche Post est satisfaite du résultat. Elle y voit un moyen de se débarrasser de ses concurrents qui ont pris 10% du marché depuis son ouverture pour les lettres de plus de 50 grammes. Ses concurrents, notamment la société Pin, deuxième du secteur, qui paient à leurs salariés un salaire horaire ne dépassant pas 7,50 euros, estiment toutefois que l'accord constitue une entrave à la concurrence, destiné à conforter le monopole de la Deutsche Post. Dans la foulée de l'accord gouvernemental, Pin a annoncé le licenciement de 900 personnes en Allemagne, un dixième du total de son personnel outre-Rhin.
Les sociaux-démocrates sont satisfaits de ce premier résultat. Ils ont décidé de le consolider par une pétition en Hesse en faveur de l'introduction d'un salaire minimum généralisé. Déjà dans la perspective des élections législatives de 2009, Kurt Beck, le président du SPD, a souligné que le sujet resterait en tête de l'agenda politique en 2008. Les chrétiens-démocrates, eux, sont très partagés. Certains économistes, tel que Hans Werner Sinn, président de l'Institut munichois Ifo, regrette que la CDU ait accepté de considérer le salaire minimum comme une revendication négociable, la modération salariale outre-Rhin ayant puissamment contribué à combattre le chômage. D'autres experts, dont le professeur Bert Rürup, président d'une commission chargée de conseiller le gouvernement en matière économique, souhaite que la CDU instaure un SMIC généralisé, mais il le met à 4,50 euros de l'heure, bien en deça des 7,50 euros préconisés par les sociaux-démocrates et les syndicats. D'un autre côté, les responsables du parti de droite savent pertinemment que le public est en faveur de cette mesure défendue par le SPD, comme en témoigne la popularité du combat des conducteurs de locomotives qui tentent depuis plusieurs mois d'obtenir de meilleurs salaires. Dans un contexte social, où le nombre de salariés incapables de vivre du fruit de leur travail monte inexorablement, où le hiatus entre riches et pauvres s'accroît de façon visible, le gouvernement se doit de trouver une solution pour renforcer le cohésion sociale. Même le patronat s'y met : les fédérations patronales des entreprises de surveillance et de sécurité, de traitement des déchets et du travail temporaire - tous des domaines où les salaires horaires sont particulièrement bas - ont réclamé des minimums salariaux.
Le salaire des patrons fait polémique
Le débat actuel sur le salaire minimum généralisé qu'une majorité d'Allemands appelle de ses vœux, se double d'une polémique sur les rémunérations des patrons, jugées excessives par la plupart des responsables politiques, tant de gauche que de droite. La discussion a été relancée par le président de la République, Horst Köhler, qui a dénoncé une aliénation entre les entreprises et la société. Les chiffres qui circulent dans les médias sont en effet de nature à alimenter la polémique : Klaus Zumwinkel, président de la Deutsche Post, a exercé ses options sur actions pour un montant de presque 5 millions d'euros, au moment où le titre profitait de l'annonce par le gouvernement d'un salaire minimum pour les services postaux, renforçant le monopole de fait de l'ancienne entreprise d'Etat. Chez Porsche, où les actionnaires des familles Piëch et Porsche n'ont rendu publique que la rémunération collective du directoire, le président Wendelin Wiedeking est crédité de 60 millions d'euros pour 2006. A ces rémunérations jugées abusives par la majorité des Allemands s'ajoute, pour un nombre importants de patrons, des retraites plus que confortables, avec attribution d'un secrétariat et d'une voiture de fonction avec chauffeur à vie.
Ce qui est considéré comme particulièrement choquant par le public, ce sont d'une part l'absence de responsabilité financière des patrons et, d'autre part, le maintien des salaires et primes exorbitants, même en cas de management défaillant. L'exemple de Jürgen Schrempp est particulièrement frappant. Il a quitté l'entreprise germano-américaine Daimler Chrysler il y a deux ans en empochant une cinquantaine de millions d'euros, tout en ayant réduit la valeur boursière de l'entreprise de dizaines de milliards. Des exemples de ce type, certes moins spectaculaires, abondent.
Les média soulignent que le salaire des patrons ne connaît qu'un mouvement, celui de la hausse. Alors que la rémunération moyenne des salariés stagne depuis des années - + 2,8% en cinq ans - celle des PDG des trente sociétés cotées au Dax a augmenté de 62%. Angela Merkel s'est saisie la première de ce sujet, pointant du doigt les dirigeants qui encaissent des indemnités fantaisistes, même en cas d'échec, et qui minent de ce fait la confiance dans l'équilibre social du pays. Le SPD, pour une fois pris de vitesse sur ce sujet éminemment symbolique, lui a emboîté le pas. Les sociaux-démocrates ont créé un groupe de travail chargé de réfléchir aux mesures susceptibles de freiner cette dérive. Si certains d'entre eux vont jusqu'à envisager une nouvelle loi pour créer des plafonds salariaux pour les patrons - proposition favorablement accueillie par 65% des Allemands -, la CDU préfère la voie de l'engagement volontaire des responsables économiques. Le frein que représente la publication des rémunérations individuelles existe déjà, mais les actionnaires peuvent décider de passer outre et de ne publier que l'ensemble des salaires des membres du directoire, comme dans le cas de Porsche. Ce débat, comme celui autour du salaire minimum, est exacerbé par l'imminence des élections régionales. Une fois ces échéances passées, sera-t-il enterré, où rebondira-t-il dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale ?
(Janvier 2008)
<Brigitte.Lestrade@u-cergy.fr>
Carnet littéraire
Caustiques et poignants: les derniers poèmes de Robert Gernhardt
Später Spagat, c'est le titre que Robert Gernhardt a donné à son dernier recueil de poèmes, paru immédiatement après sa mort survenue le 30 juin 2006 à l'âge de 68 ans. Un titre sportif comme celui des deux parties du recueil, Standbein et Spielbein, et qui désigne une figure acrobatique, celle du grand écart. Dans un petit texte servant d'avant-propos à son livre rédigé quelques jours avant sa mort, l'auteur explique qu'il a choisi ces images parce qu'elles lui semblent caractériser au plus juste l'ensemble de son oeuvre faite de virtuosités verbales où l'humour, le rire, la dérision et le sarcasme côtoient le sérieux, la profondeur et la gravité.
R. Gernhardt est né en 1937 à Tallin en Estonie. Son père meurt à la guerre, sa mère s'enfuit en 1945 et s'installe à Hannovre avec ses trois enfants. Plus tard, R.Gernhardt a suivi à Düsseldorf et à Berlin une formation dans le domaine des Lettres et des Beaux-Arts. Il se fait connaître à Francfort dans les années 60, où il fait partie d'un groupe d'auteurs satiriques et non-conformistes qui se propose de reproduire en littérature l'entreprise critique de l'Ecole de Francfort des années 20 et 30 - le groupe s'appellera plus tard « Neue Frankfurter Schule »- en développant une nouvelle forme de satire intellectuelle et ambitieuse. A partir de 1962, il publie le magazine pardon, journal innovant dans sa partie littéraire où brille le talent de Robert Gernhardt, mais pas vraiment subversif sur le plan politique. La revue s'affadit au début des années 70, puis disparaît au profit de Titanic où se retrouvent les talents les plus audacieux. Ignorés par les germanistes, les écrivains de la revue pardon récusent les auteurs canonisés par l'Allemagne de l'après-guerre, surtout en matière de lyrisme (Paul Celan, Nelly Sachs, Günter Eich, qu'ils ne trouvaient pas très gais) et se méfient de la solennité de la « grande littérature ». Ils privilégient dans leurs propres œuvres le nonsense, l'humour, l'absence d'effets et de sérieux et se réclament d'auteurs comme Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz.
Interrogé sur sa collaboration à pardon dans les années 60, R.Gernhardt déclare: « On avait l'impression au cours de cette décennie qu'il y avait énormément à rattraper. C'était simple de s'y retrouver, il n'y avait pas grand-chose. Très tôt, j'ai découvert Arno Schmidt. Nous n'aimions pas Böll, ni Hesse. Nous avions du respect pour Thomas Mann et Gottfried Benn, c'était déjà une pointure au-dessus. Nous avions bien sûr lu Brecht. Ce n'était pas encore l'auteur incontournable des manuels scolaires, dont on vous gave aujourd'hui. » En 1973, R. Gernhardt fait la connaissance de l'artiste comique Otto Waalkes (Otto) qui porte au théâtre, et surtout à la télévision, quelques-uns de ses textes et pour lequel il écrit des sketches et des scénarios de films. C'est à cette collaboration qu'il doit sa célébrité, une chance qui lui inspire la rime fameuse « Mein Sechser im Lotto war Otto ».
Dans la seconde moitié de sa carrière, sa popularité n'a cessé de croître. D'abord perçu comme un joyeux luron, il accède à la fin de sa vie à la réputation d'un classique. Son talent comique, sa virtuosité verbale, son art du coq-à-l'âne, ses pirouettes extravagantes, ses associations inattendues de rimes, d'idées et de mots lui ont acquis un vaste public, et on le considère aujourd'hui en Allemagne comme l'un des auteurs les plus importants de la seconde moitié du vingtième siècle. Peintre et caricaturiste doué, il laisse une œuvre immense, des recueils de poèmes surtout, mais aussi des nouvelles, des textes théoriques sur la peinture et la littérature et des livres illustrés pour enfants. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix Brecht pour l'ensemble de son œuvre, le prix Erich Kästner, le prix Heine et le prix Wilhelm Busch à titre posthume .Quant à l'idée qu'il se faisait de lui-même et de son métier, la voici résumée dans ce poème cocasse écrit à la va-vite: Selbstfindung/ ich wei_ nicht, was ich/ bin./Ich schreibe das gleich/ hin/. Da hab'n wir den Salat:/ Ich bin ein Literat.
Robert Gernhardt a souffert longtemps du cancer qui l'a emporté. Les poèmes de ses dernières années sont des armes qu'il brandit contre la terrible maladie. Usant d'une virtuosité intacte, il lui oppose avec panache et l'énergie d'un désespoir croissant son besoin irrésistible de narguer l'inéluctable en ciselant de petits-chefs d'œuvre formels. De ce point de vue, la couverture de Später Spagat est éloquente (R.Gernhardt desssinait toujours lui-même les couvertures de ses livres): un personnage stylisé, représenté debout, dressé sur de hautes jambes écartées qui figurent les deux branches d'un compas, une prouesse d'équilibre.
De maladie, il était déjà question dans un recueil de poèmes paru en 1996, Herz in Not, écrit suite à un séjour en hôpital nécessité par une maladie cardiaque où R. Gernhardt avait failli perdre la vie. Il en est aussi question dans son avant-dernier recueil, paru en 2004 sous le titre lapidaire Die K. Gedichte. Une consonne qui, outre qu'elle fait penser au Herr K. de Brecht et au Josef K. de Kafka, allitère avec le K. de Komik, ce talent comique dont R. Gernhardt disait dans un de ses esssais sur la poésie qu'il avait été le levier grâce auquel il avait pu mettre son œuvre sur pied; et qui évoque le K. de Krebs et le K. de Krieg (la guerre contre la maladie et, accessoirement, la guerre en Irak, évoquée à travers quelques sonnets auxquels l'auteur a donné le titre générique « Krieg als Schwindle): deux thèmes graves, contrairement à ce que laisse présager la couverture bleu azur du mince volume. Pour effacer ou du moins atténuer l'effet de tristesse, R. Gernhardt a inventé d'autres associations et rajouté à la fin du recueil un texte en prose intitulé « Kunst als Küchenmeister » et un quatrain où il est question de « Käse ».
Evoquant le parcours du combattant qui le mène de salle d'opération en perfusions, en analyses et en bilans angoissants, à Francfort où il vit et en Toscane où il possède une villa, R. Gernhardt le compare à une expédition scientifique: « Si la vie est un voyage, alors la maladie est un continent qu'il faut explorer... Moi, par exemple, j'ai exploré la presqu'île du Cœur et je m'apprête à voir de plus près le continent Cancer »...écrit-il au début de sa chimiothérapie... La partie du livre qui évoque sa maladie est intitulée « Krankheit als Schlangse » : ici, l'auteur se cite lui-même, le néologisme « Schlangse » rimant avec « Tour de Frangse » utilisé dans l'un de ses poèmes où il évoque le coureur cycliste Lance Armstrong qui, après avoir vaincu son cancer, a remporté cinq fois de suite le tour de France. Comme quoi cancer et comique peuvent aller ensemble. En dépit de cette thématique sombre, R. Gernhardt, qui connaît son métier, réussit à faire rire le lecteur par quantité de trouvailles cocasses et bien sûr, une bonne dose d'humour macabre.
Später Spagat, auquel l'auteur a mis la dernière main sur son lit d'hôpital quelques jours avant sa mort, est paru le 22 juillet 2006, trois semaines après sa disparition. La tonalité générale est encore plus sombre, très sombre. Comme dans Die K.Gedicte, l'auteur a tenté d'éclaircir l'ensemble en opposant à la première partie qui traite de la maladie et de la mort une seconde partie enjouée (Spielbein), où il renoue avec l'humour, la verve et l'entrain qu'on lui connaît. A côté de quelques textes qui font directement penser à Ringelnatz, évoqué dans l'un d'entre eux, on y trouve de petits riens délicieux comme ce Walderkenntnis : « Ein Männlein steht im Walde/ ganz still und stumm./ Wenn ich es nicht umfahre,/ dann fahre ich es um.", ou encore Mächtig was los: „Auf einem Baum, blattlos/ Sitzt ein Vogel, federlos/ Singt ein Lied, tonlos/ Hörts ein Mann, haarlos/ Fragt seine Frau, hirnlos/ Sagma-wasn hier los? ", ou des poèmes joyeusement polémiques où l'auteur distribue quelques coups de patte à ses collègues écrivains, à Peter Hacks par exemple, « dem dünkelhaftesten von Preu_ens Kommunisten », et à tous ceux qui se mêlent de peindre ( Finger weg ), mais comparés aux poèmes de la première partie à la gravité bouleversante, ces textes sont accessoires.
Les quatre premiers poèmes de Später Spagat évoquent la Toscane tant aimée. Le tout premier, Povera Toscana 199,8 est antérieur à l'ensemble du recueil qui rassemble les textes des trois dernières années. Arrivant en septembre en Toscane, l'auteur se demande à la vue de la nature calcinée qu'il découvre au lieu de la splendeur attendue s'il na va pas faire demi-tour. D'abord révolté, puis apitoyé, puis admiratif devant la résistance de ce pauvre automne qui réussit à s'affirmer ça et là et qui lui vaut le qualificatif de « stilvoll », il s'en retourne en effet, plein de regrets, mais fait volte-face l'instant d'après pour laisser place au rire : « Cara Toscana !/ Die Bäume so blattlos/ Die Trauben so saftlos/ Die Hänge so farblos/ Und das im September ! Doch alte Liebe rostet nicht!/ oder liebt da ein rostender Alter ? » La tonalité du poème suivant, Toscana 2002, que quatre ans séparent du premier, est bien différente. Aigri, agacé, R. Gernhardt ne retient de la nature environnante que la vue de cyprès en train de dépérir. L'horizon s'est rétréci, la nature, inaccessible au malade cloué sur son lit et devenue le miroir de son propre déclin, le renvoie à la mort toute proche qu'il écarte avec impatience: « Zypressen mu_ ich nicht haben/ nicht welche, die sichtbar vergehen./ Was stehen sie in der Landschaft rum./ Das vergehen mu_ ich nicht sehen/... das zieht sich ganz schön, dieses Sterben/... Zypressen mu_ ich nicht sehen/ was nicht da ist, kann keiner vermissen./ Warum mich das alles so total nervt? All das mu_ ich wirklich nicht wissen."
Ces ultimes poèmes qui parlent de la part la plus intime de l'homme, son face- à- face tragique avec la mort, sont, comme l'ensemble de l'œuvre, dépourvus de toute sentimentalité. Pas question de s'apitoyer sur soi-même. Si l'auteur a presque envie de pleurer lorsqu'il voit les dégâts que l'homme inflige à la nature, (Wierdesehen und Abschied, Am 27 Juni 200), un pastiche de Willkommen und Abschied), la maladie et la mort, partout présents, sont magistralement tenus à distance. Exprimés avec un dépouillement glacial, bridés par le laconisme de la langue et le carcan du vers, sublimés par la virtuosité avec laquelle R. Gernhardt jongle avec les formes poétiques et les références littéraires, la peur, l'angoisse, le désespoir, les accès de révolte du mourant, sa douleur de devoir quitter ce monde sont passés par le filtre d'une perfection formelle qui leur donne des accents déchirants. Ne pas dire pour mieux dire un désespoir qui glace le cœur: Ich bin viel krank./ Ich lieg viel wach./ Ich hab viel Furcht./ Ich denk viel nach:/ Tu nur viel klug!/. Bring nicht viel ein./ War einst viel Glück. Ist jetzt viel Not./ Bist jetzt viel schwach./ Wirst bald viel tot. (Viel zu viel).
L'élégance et la concision de la forme accentuent la brutalité atroce du contenu. Il est rare que l'on rie franchement en lisant ces poèmes qui s'acharnent à dire l'indicible. La causticité, parfois, vient au secours du malade comme dans Abschied und Willkommen, un poème qui reprend, comme beaucoup d'autres, la forme du Volkslied et dans lequel R. Gerhnhardt, sur le point de quitter Francfort, la ville natale de Goethe, de nouveau pastiché ici, apprend « la mauvaise nouvelle » - on notera la litote - et où, à son retour, l'attend, non pas l'épouse habituelle, mais le diagnostic récemment tombé qui le nargue férocement: « Es war in Frankfurt./ Mir gings gut, wie einem, der verreisen tut./ Ich packte gleich die Koffer mein, da traf die schlechte Nachricht ein./ Ich reiste ab und hatte Glück :/ die schlechte Nachricht blieb zurück. Vier Tag lang lag sie hinter mir,/ jetzt fahr ich heim. Das meint: Zu ihr. Noch sitz ich in der Eisenbahn,/ bald wird die Haustür ausgetan. Und mich lacht als wie ihren Mann/ die treue schlechte Nachricht an./ „
Partout, c'est la lucidité crue qui l'emporte, le besoin forcené de s'en tenir aux faits pour dire l'horreur et le grotesque, de mettre en mots la maladie, le quotidien misérable qui l'accompagne, le chemin jusqu'à l'hôpital pour la séance de chimiothérapie qui distille du poison dans le corps souffrant: « Durch die Auen/ durch die Triften/ reise ich, mich zu vergiften » (Krebsfahrerlied oder Auf dem weg zur Chemiotherapie im Klinikum Valdarno oder Die Hoffnung stirbt zuletzt ), les kilos perdus à toute allure, telle opération des intestins où le patient en ressort tellement mal recousu que le nombril a bougé de plusieurs centimètres (Asymmetrie), la débâcle du corps qui lâche « du sang, de la merde et des larmes », le malade grabataire coupé de la vie, le va-et- vient entre l'espoir et le désespoir jusqu'à ce que l'évidence vous saute à la gorge: »Die Krankheit greift den Menschen an :/ Hierhin.Dahin/ Bis er es nicht mit ansehn kann:/ Dies hierhin. Dies dahin./ Bis er sich nicht mehr ansehn kann:/ Nicht hierhin. Nicht dahin. Bis er begreift: Bin abgetan/ Bin hierhin.Geh dahin./ (Strategien).
Dans ces textes âpres et denses, férocement travaillés derrière leur apparente banalité, se joue un duel violent avec la mort. Le poème Gedenken évoque comme un « travail » et un « dernier duel » la mort d'un ami dessinateur à laquelle R. Gernhardt a assisté : „Nie werd ich den sterbenden Fritz vergessen./er hatte uns zum Abschied gebeten,/ Pitt und mich / So sahen wir dem steten/ Tod eine Weihe beim Arbeiten zu./ Nun also dieses letzte Duell./ Pitt und ich auf Zeit Sekundanten, /Zeugen des Endes, die sehend erkannten:/ Tua res agitur./ „( Gedenken.). R.Gernhardt mobilise toutes les ressources de son immense talent pour terrasser cet adversaire coriace qu'il n'hésite pas à narguer: « Gut schaust du aus !/ -Danke ! Werds meinem Krebs weitersagen./ Wird ihn ärgern." (Dialog). Le lecteur est tenté de penser que c'est peut-être bien lui, en effet, qui a eu le dernier mot. Une semaine après sa mort, un grand nombre de ses amis ont assisté à une lecture organisée à sa mémoire à la Maison de la littérature de Francfort: ils en sont ressortis pliés de rire. Quoiqu'il en soit, ce dernier volume de vers où la puissance verbale de l'auteur atteint des sommets nous livre une belle leçon de courage.
Le récit navrant d'une émancipation ratée : Fraülein Paula Trousseau de C. Hein
Cela commence comme un thriller. Alors qu'il met à jour son fichier d'adresses électroniques, Sebastian Gliese, résidant à Berlin, tombe deux fois sur le nom d'une certaine Paula Trousseau, une artiste peintre âgée d'une quarantaine d'années qu'il a perdue de vue depuis vingt ans. Après vérification, il s'aperçoit qu'il a effacé sans le vouloir les deux adresses identiques. Six mois plus tard, il reçoit la visite de Michael Trousseau, qui lui apprend le suicide de sa mère retrouvée noyée dans un bras de la Loire et lui demande de bien vouloir venir chercher les tableaux que celle-ci lui a curieusement légués. Le lecteur intrigué se demande à la fin du premier chapitre quel mystère plane sur cette destinée tragique. Pourquoi donc ce suicide en France, pourquoi ce legs inattendu à cette lointaine connaissance dont on apprend qu'il n'aime pas ses tableaux qu'il juge sinistres ? Et qu'en est-il de ce manuscrit que la défunte destinait à sa fille qui a refusé de le lire et qui atterrit dans les mains de son frère Michael ? Rompant brutalement avec ce chapitre introductif, le livre bascule ensuite dans un long récit à la première personne qui reproduit sans doute le fameux manuscrit. Christoph Hein, désormais absent, choisit de donner la parole à son personnage qui, sans distance aucune, raconte sa vie, une vie jalonnée d'échecs grossiers conduisant au suicide.
C'est un cas bien étrange que celui de cette Paula Trousseau. Les premiers chapitres nous la montrent sous un angle plutôt favorable. Jolie comme un cœur, super-douée pour le dessin au point que très jeune, elle nourrit l'ambition de devenir une artiste, elle n'est pas sans atouts qu'elle a le chic de retourner contre elle. « J'aurais préféré n'être qu'une fille quelconque, qui ne soit ni jolie, ni douée et qui n'ait surtout pas de rêves », écrit-elle dans la lettre d'adieu adressée à son fils. Elevée dans une famille petite-bourgeoise dans la RDA provinciale des années cinquante, la jeune Paula, fiancée à un architecte de Leipzig plus âgé qu'elle qui lui garantira un train de vie confortable, a le courage de braver l'autorité tyrannique de son père, déjà relayée par celle de son futur époux : alors que son mariage est imminent, elle réussit à en repousser la date pour aller passer à Berlin l'examen d'entrée à l'Ecole des Beaux-Arts qu'elle réussit haut la main.
Tout semble bien parti pour cette jeune femme douée et déterminée qui rêve d'un avenir brillant dans lequel elle pourra s'épanouir. Mais au lieu d'assister à l'éclosion d'une personnalité qui se construit, s'enrichit à travers les aléas de la vie, le lecteur est contraint de suivre, pendant quelque cinq cents pages s'il en a la patience, un parcours qui ne peut être que raté et répétitif parce qu'obstinément voulu par la narratrice qui a décidé de faire fi de tous ceux qui l'entourent pour ne « penser qu'à elle », c'est-à-dire à son art. Impossible de s'apitoyer sur le sort lamentable de cette femme égoïste et narcissique, qui a décidé une fois pour toutes de « ne pas être sentimentale » et qui court à sa perte en affichant un féminisme simpliste.
Cela se traduit, on l'imagine, par une vie amoureuse (le mot est fort, les hommes qui jouent un rôle dans sa vie lui plaisent, sans plus) caricaturale. Le mariage repoussé a bien lieu, bien que Hans, le futur mari, ait déjà été identifié par elle comme un butor qui la traite comme un objet sexuel. Les choses s'aggravent lorsqu'elle s'aperçoit qu'en dépit des précautions qu'elle a prises, elle se retrouve enceinte. Mystère. Là, Christoph Hein n'y va pas avec le dos de la cuillère, on apprend en même temps que Paula que ce salaud de Hans, outre qu'il souhaite en bon conservateur fonder une famille au plus vite, veut contrecarrer la vocation d'artiste de se femme par une grossesse. Et donc, vite fait, bien fait, il échange sa pilule et le mal est fait. Qu'à cela ne tienne, Paula, horrifiée par le « plan diabolique » de son mari, songe d'abord à avorter, puis décide, dans un sursaut de révolte, de garder l'enfant et de mener de front sa grossesse et ses études aux Beaux-Arts. Fière d'être l'objet d'égards particuliers de la part de ses professeurs et de ses camarades d'études, elle se pavane avec son gros ventre et accepte même de poser nue... Une fois sa petite fille née, elle constate qu'elle n'éprouve pour elle aucun sentiment maternel d'autant que cet enfant est le fruit d'un « viol ». Ce qui ne l'empêche pas de s'exhiber aux Beaux-Arts, son enfant sur les bras, convaincue que son statut de jeune mère lui procurera de bonnes notes. Lorsqu'elle demande le divorce quelques années plus tard, elle est soulagée de ne pas obtenir la garde de l'enfant.
Après ce premier échec, Paula devient la maîtresse d'un de ses professeurs qui l'entretient dans sa somptueuse villa. Il l'introduit dans les milieux artistiques en vue de Berlin, fait avec elle des voyages normalement interdits par le régime et lui offre des cours de piano, car Paula est aussi douée pour la musique. Tout ce faste se paie. Ca n'est pas toujours une partie de plaisir, elle doit subir au lit les étreintes laborieuses du vieil homme, affronter au dehors la jalousie et les sarcasmes de ses condisciples, et Paula quitte son partenaire une fois ses études achevées. Ensuite, elle a quelques aventures, dont une qui lui procure un enfant, un fils qu'elle décide cette fois de garder, simplement pour ne pas répéter son échec avec sa fille, sans que le sentiment maternel y soit pour quelque chose. Elle devra au contraire apprendre à aimer son fils dont elle décide qu'il ne connaîtra pas son père, pourtant attaché à Paula... Heureusement, il y a les femmes. Paula aura avec certaines d'entre elles des relations sexuellement plus épanouissantes qu'avec les méchants bonshommes aux instincts bestiaux (ici aussi, on est dans le cliché), sans pour autant vivre jamais une relation d'amour authentique...
Sur le plan professionnel, Paula cherche aussi à s'émanciper. L'un des moments forts du roman (il y en a peu) est lié à une « toile blanche », inspirée de la peinture moderne que la RDA qualifiait de « décadente » et que Paula, pour une fois évoquée dans son activité de peintre et d'artiste inspirée, réalise en bravant avec entêtement le chantage que lui fait subir son protecteur que cette modernité révulse. Mais, une fois ses études terminées, une fois largué son dernier compagnon, un gentil garçon qui la trouvait « arrogante » et auquel son fils Michael était très attaché, elle vit de maigres contrats et s'enfonce toujours plus dans une solitude et un état dépressif qui la rendent étrangère à elle-même. C'est dans une sorte d'hébétude qu'elle vit, à la fin du roman, l'effondrement du mur et la fin de la RDA.
Quel livre bizarrement ficelé ! Qui donc est responsable de ce fiasco ? Aucune réponse n'est donnée par l'auteur qui promène son personnage sans jamais l'éclairer. Une seule fois, un professeur de Paula tente de la mettre en garde en émettant l'idée que chez elle « l'art a remplacé le sentiment ». Une piste qui reste inexploitée. Paula Trousseau est-elle victime de son milieu familial étroit, de son père redouté, directeur d'école alcoolique et coureur qui lui a seriné pendant toute son enfance qu'elle et sa sœur étaient les filles d'une « idiote infantile », de sa mère dépressive et alcoolique elle aussi, qui l'a privée d'un modèle maternel positif, de la société, des hommes, du régime ? On pense ici évidemment au texte le plus connu de Hein, la nouvelle Der fremde Freund (Drachenblut) parue en 1972. L'auteur y livrait aussi un portrait de femme insensible, barricadée contre toute intrusion de l'extérieur mais auquel il donnait une crédibilité et une densité particulière en l'insérant dans une réalité politique concrète dont elle était le produit, celle de la RDA des années 70. Ici, la RDA ne joue aucun rôle dans le roman, elle est mentionnée de façon allusive, sans plus. Toutes ces questions tombent à plat. Seule la volonté inflexible de Paula Trousseau de se soustraire à tout élan vers les autres au nom d'une hypothétique vocation artistique en fait sinon un monstre, du moins un personnage peu crédible, dépourvu d'humanité et profondément antipathique. Si l'on ajoute que souvent, C. Hein pèche par négligence et qu'il multiplie les dialogues creux, rédigés dans une langue terriblement banale, on aura la mesure du plaisir que l'on prend à le lire.
Références
Gernhardt, Robert, Die K. Gedichte, Fischer, Frankfurt a.M. 2004,102 p.
-Später Spagat, Fischer, Frankfurt a.M, 2006.120 p.
-Gesammelte Gedichte 1954-2004, Fischer 2006, 600 p.15 euros.
Hein, Christoph, Fräulein Paula Trousseau, Suhrkamp, Frankfurt a. Main 2007, 537 p.